Gregory Crewdson, Eveningside
22.02 ... 18.05.2025
Téléchargez le dossier presse ici

Inauguration : samedi 22 février à 11 h
Exposition organisée en partenariat avec la galerie Templon.
Commissariat : Sylvain Besson
Le musée remercie Gregory Crewdson, la galerie Templon, en particulier Anne-Claudie Coric, directrice générale, Yorgos Kotsakis, Les Amis du musée Nicéphore Niépce.

Si la photographie nous apparaît comme une évidence, composée d’une succession de signes qui nous « parle » alors qu’il est toujours plus facile de produire des clichés, Gregory Crewdson [né en 1962 à Brooklyn] nous inonde d’indices pour mieux nous perdre, nous piéger, nous obliger à regarder et à nous questionner.
Conclusion d’une trilogie initiée avec Cathedral of Pines [2014] et poursuivie avec An Eclipse of Moths [2018-2019], Eveningside [2021-2022] achève un cycle centré sur les lieux où Gregory Crewdson a grandi et dont ils connaissent chaque recoin. Comme pour ses travaux antérieurs, Crewdson déploie dans ces trois séries d’importants moyens techniques, ceux habituellement mis au service du cinéma. Fort d’une équipe de près de vingt personnes, le photographe propose des scénarios, élabore des mises en scène savamment orchestrées, use de nombreux effets spéciaux [lumière, fumée, etc.] pour renforcer les atmosphères qu’il souhaite créer. La longue phase de postproduction achève de donner à ses séries leur ambiance singulière, leur cohérence, leur caractère implacable. Invariablement, les photographies de Crewdson interrogent et ne s’offrent pas au regardeur: « Je tiens à ce que la question reste toujours ouverte. Sans réponse. D’une certaine manière, c’est le cas pour n’importe quelle photographie: jamais aucune photo ne révèle entièrement sa signification ».1
Le temps semble comme suspendu, un arrêt sur image où Crewdson condense tous les éléments d’un film dans une seule photographie: «Ce que je veux, c’est que le spectateur soit immergé dans un univers, celui de l’image, comme dans un bon film ou dans n’importe quelle œuvre d’art » 2 . Dès lors, Crewdson installe le regardeur dans la position du photographe voire du voyeur: le format, les détails, les symboles qui se répondent d’une photographie à l’autre, d’une série à l’autre invitent à l’observation, à l’immersion, à chercher du sens tout en se tenant en retrait.
Le fil de conducteur de la trilogie est la distance: celle de l’être humain avec la nature, celle entre les êtres et celle de ces derniers avec la société. Série en couleurs, Cathedral of Pines, inaugure l’ensemble et est la plus intime. Réalisée à Becket, là où Crewdson a grandi et vit désormais avec sa compagne, Cathedral of Pines montre des êtres sidérés devant la déliquescence de la société qui les entoure, ces villes moyennes du Nord-Est des États-Unis à la limite de la ruralité. Si les moyens sont ceux du cinéma, les compositions évoquent la peinture classique, en particulier les scènes d’intérieur. La nature est omniprésente et semble reprendre ses droits sur une civilisation en déliquescence. Toujours en couleurs, la série suivante, An Eclipse of Moths, multiplie les références à la littérature [Moby Dick notamment] et fait écho, à travers le nom des rues, à plusieurs présidents américains. Les prises de vues sont réalisées à Pittsfield, à 20 km de Becket, où a grandi la compagne du photographe, ville profondément marquée par la fermeture des usines et les scandales de pollution des sols. L’échec du mythe du Progrès et du rêve américain est patent: les êtres errent comme des fantômes, sont comme absents, perdus, atterrés par les promesses non tenues de leurs dirigeants. Avec Eveningside, les nombreux effets de miroirs et de reflets, les jeux de regards, le titre même des photographies concourent à aborder plus frontalement le rapport des êtres en société. La ville est factice, Becket et Pittsfield sont photographiés, décomposées puis « créées de toute pièce en postproduction. Le terrain est donc familier, mais légèrement décalé, ajoutant du trouble au trouble. Les êtres sont comme identifiés à leur fonction, résignés dans leur condition. Pour le critique Jean-Charles Vergne, « Les individus d’Eveningside, cette ville « du côté du déclin », forment une société sans même en prendre conscience. […] Eveningside constitue l’ultime strate d’un subtil dégradé de l’intime vers le sociétal où le consensus a été vaporisé par un consentement forcé »3 . Le noir et blanc ajoute à la nostalgie d’un idéal égaré en chemin, même si chaque crépuscule appelle le renouveau du jour à venir et que certains clichés évoquent, sinon l’optimisme, du moins l’espoir d’une « échappée » 4 .
Pour cette exposition, le musée Nicéphore Niépce a fait le choix de montrer la série Eveningside aux côtés d’une photographie de chaque série qui la précède dans la trilogie, rendant compte ainsi de la cohérence du corpus et la continuité dans les œuvres de Crewdson entre 2014 et 2022. Si, dans chaque photographie, le temps semble suspendu, voire quasi absent, il n’en est rien: les lieux sont les mêmes, mais les modèles sont récurrents et vieillissent d’une série à l’autre. De fait, une mécanique temporelle est bien à l’œuvre dans la production du photographe, alors même que Crewdson place ses sujets dans « un moment de tergiversation, d’attente, un entre-deux entre un « avant » et un « après ». Une forme de paralysie psychologique » 5. Avec Gregory Crewdson, la photographie a tous les atours du documentaire: elle nous happe par les détails omniprésents, les compositions soignées, le cadrage précis, la lumière. Elle invite à la contemplation. Pourtant, elle n’est que fiction et rapidement le piège se referme: abreuvés de signes discrets, nous ne pouvons que créer des liens, inventer de nouvelles fictions dont les photographies de Crewdson seraient la source, démontrant, si cela était encore nécessaire, la puissance évocatrice du médium.
1. Interview de Gregory Crewdson par Cate Blanchett, in Alone in the Street, Éditions Textuel, Paris, 2021 2. Op. cit. 3. Jean-Charles Vergne in Eveningside, Gallerie d’Italia, Skira, Milan, 202 4. Op. cit.

Gregory Crewdson est né en 1962 à Brooklyn, New York. Il vit et travaille à New York et dans le Massachusetts. Il est diplômé de SUNY Purchase, New York, et de la Yale School of Art, New Haven, où il est maintenant professeur et directeur d’études supérieures en photographies. Figure majeure de la photographie américaine, il met en scène ses photographies comme des films avec acteurs, décors, accessoiristes, storyboards, maquilleurs comme une manière d’évoquer la face noire du rêve américain, mais aussi ses propres drames psychologiques.

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Will Write Soon
Photos postales du "nouveau" monde
22.02 ... 18.05.2025
vernissage : samedi 22 février à 11h
Téléchargez le dossier presse ici

Exposition réalisée par Archive of Modern Conflict [AMC] et le Centre d’Art GwinZegal
Commissariat de l’exposition: Luce Lebart [AMC]
Scénographie, montage : équipe du musée Nicéphore Niépce
Toutes les images: © collection privée – AMC
Publication aux éditions
GwinZegal et AMC
Will Write Soon
par David Thomson
17 x 24 cm
couverture souple
184 pages
30 €
ISBN : 9791094060452
_____
C’est dans les méandres de la vie quotidienne des villages et des campagnes d’Amérique du Nord au début du XXe siècle que nous entraînent ces centaines de photographies issues d’un registre insolite. En anglais, on les appelle « real photo postcard » [RPPC] et en français, « carte photo ». Elles sont à mi-chemin entre photographie argentique et cartes postales. Ce sont des tirages originaux [de vraies photographies et non pas des images imprimées] dont le verso comporte un espace pour y apposer une adresse, un timbre, ainsi que, à partir de 1907, quelques mots. Avant cette date, seule l’adresse était autorisée au dos des cartes, et les messages étaient alors écrits directement sur l’image ou bien autour d’elle.
Envoyer une image de chez soi, une photographie que l’on a faite soi-même ou dont on a fait l’acquisition auprès d’un photographe de passage ou de celui du village : cette pratique connaît un engouement populaire extraordinaire entre 1905 et 1915 dans les zones rurales de l’Amérique profonde. Ce boom de la carte photo est triplement favorisé : par la simplification de l’accès à la pratique photographique, par la baisse remarquable des coûts d’envoi, et enfin par la modernisation et la gratuité des livraisons postales. Les livraisons sont fréquentes, ce dont témoignent les cachets postaux. Ainsi, une carte envoyée d’un village à l’autre pouvait parvenir à destination le jour même ou le lendemain. À un moment où les foyers américains sont loin d’être tous équipés de téléphone, les cartes photo deviennent les liens visuels et verbaux entre des générations d’Américains, qui, souvent nouvellement installés, vivent loin des grandes villes.
« Je serai de retour jeudi si tout se passe bien. » ; « Le chien est malade. Il a dû être éthérisé. » ; « C’est là que je passe la plupart de mon temps. » ; « Comment sont ces photos que tu as prises de nous ? » ; « Là où il y a une croix, c’est mon cousin. » ; « La tempête est passée pas loin mais elle nous a épargnés. ».
L’exposition Will Write Soon met en avant les qualités esthétiques et documentaires de près de 250 photographies qui ont le plus souvent été prises par des amateurs. La matérialité de ces souvenirs timbrés du quotidien est soulignée, et le dos des images est donné à voir.
L’exposition Will Write Soon repose sur la collection de cartes photographiques constituée par le collectionneur et auteur David Thomson, qui en livra une première vision originale dans son livre Dry Hole publié en 2022 chez Morel Books et AMC. Will Write Soon prolonge cet ouvrage en proposant cette fois une rencontre avec les images « telles qu’elles sont ».

Bureau de poste
« Post office ». Ces mots sont peints en lettres majuscules blanches sur le toit d’un baraquement de fortune, une construction en bois posée à même le sol en terre battue. Sous l’appentis et à quelques mètres d’écart l’un de l’autre, un homme et une femme − deux employés du service postal ? — ont pris une pose improvisée.
Semblant tout droit sorti d’un western, ce bureau de poste ressemble à ceux que l’on rencontrait dans les petits villages ou bien encore aux croisements de routes traversant des terres moins peuplées. Ceux-ci restèrent pendant longtemps les maillons forts des liens entre les ruraux et l’extérieur. On s’y rendait à pied, à dos de mule ou à cheval, pour y chercher et y apporter son courrier.
En 1903, année de l’introduction par Kodak de son appareil spécifiquement conçu pour les cartes photos, environ 7,5 millions de cartes postales ont été envoyées aux États-Unis. En 1906, les cartes postales à 1 penny, et parmi elles les cartes photo, ont généré une augmentation de 35% du volume du courrier envoyé par voie postale dans le pays.

Waiting for U
Postée le 30 novembre 1906 depuis le petit village d’Ansonia, dans le comté de Darke, à l’ouest de l’Ohio, cette carte photo a parcouru plus de 2000 kilomètres à vol d’oiseau pour rejoindre le Colorado. Au dos de la carte, le nom et l’adresse du destinataire « Mrs H. Wolf, 1820 Hill Street, Boulder » apparaissent sous le timbre et les mentions d’usage « Côté réservé à l’adresse » et « Carte postale ».
À côté de la photographie, les quelques mots sans fioritures sont bien à l’image de ceux qui jalonnent les correspondances privées des cartes photo. En lien avec des images du quotidien et plus particulièrement de « chez soi », s’y expriment l’attente d’êtres proches, comme le désir de se voir ou de se revoir: « Maman envoie ses meilleures salutations et dit qu’elle t’attend » ; « Tu reviens quand? » ; « Venez nous rendre visite ».
Souvent rédigés à la hâte et dans des espaces limités, les écrits des cartes photos ressemblent à ceux des SMS contemporains [Short Message Service]. Les mots eux-mêmes sont raccourcis et remplacés par des lettres: « You » devient « U » dans « Watling for U » de cette carte d’Ansonia.

Home Sweet Home ?
Les messages courts, injonctions, assertions ou exclamations qui complètent les images, en infléchissent parfois la lecture. C’est le cas d’une carte photo d’une plaine aride qui, photographiée depuis un point de vue légèrement en hauteur, semble s’étendre vers l’infini. En son centre, trois éléments contrastent avec sa platitude: une maison en bois semblant encore en construction, une grange et une calèche sans cheval. Aucune âme qui vive dans ce paysage hivernal. Le propriétaire est absent, et pour cause, il est probablement en train de prendre la photographie, à moins qu’elle n’ait été arrachée au temps et à l’espace par un opérateur de passage?
Une chose est sûre, l’ajout sous l’image d’un point d’interrogation à la locution « Home Sweet Home? » rappelle l’âpreté des situations auxquelles sont confrontés ceux qui s’installent. L’origine de cette formule idiomatique, qui évoque la douceur du foyer domestique, remonte aux paroles de la chanson [1823] du poète et acteur américain John Howard Payne. La formule apparaît régulièrement sur les cartes photo, au moins autant que le « J’habite ici maintenant » mais pas aussi fréquemment que la promesse répétée du « Je t’écris vite ».


« Ici » et « là»
S’il est un sujet qui revient régulièrement dans les correspondances photographiques, c’est bien ce que l’on vient de faire, ou bien ce que l’on s’apprête à faire, le tout étant lié à l’endroit où on est et où on vit à ce moment même, c’est-à-dire quand on s’écrit: «C’est là que je passe la plupart de mon temps», «C’est ici que je vis désormais».
Dans les images, un signe en forme de croix, manifestation visuelle des adverbes de lieu « ici » et « là», les remplace. « Là où il y a une croix, c’est mon cousin. » La flèche joue parfois le rôle de la croix, comme dans cette carte dessinée au dos de la photographie d’une cabane en rondins perdue entre l’Idaho et le Dakota du Sud, dans une forêt du Wyoming. Sur la carte, la flèche désigne ici l’endroit où la photographie a été prise: « Photo prise ici ».

Trophées
Une paire de souliers semble sortie d’une des peintures de Van Gogh réalisées trente ans plus tôt. Ou bien annonce-t-elle celle dont Charlot fera son souper deux décennies plus tard dans La Ruée vers l’or ? Difficile de ne pas penser au photographe Robert Frank en regardant cette image dans laquelle l’écrit et l’image fusionnent. Les mots « Vendues », « Deux ans de service » ont été inscrits sur le négatif. Ici, la gélatine argentique a été creusée grâce à une pointe et ils apparaissent en noir. Là, ils ont été dessinés avec un vernis opaque qui obstrue le passage de la lumière et fait apparaître les lettres en blanc sur le tirage.
Ces godillots sans lacets, chaussures de travail épuisées faites de bosses et de creux, ont été usés jusqu’à la corde. La photographie n’évoque pourtant pas la misère mais plutôt la fierté, on exhibe ces chaussures comme des trophées, hommage au courage face à la dureté des conditions de vie et du travail agricole ou de la mine, hommage encore à ceux qui sont sur les routes et se déplacent. Encore un exemple qui rappelle combien les cartes photo ne reflètent pas la vie ni le quotidien de la haute société, mais plutôt des catégories sociales moins privilégiées, classes moyennes ou populaires qui n’ont que peu d’accès ou de liens avec d’autres types d’imageries ou de moyens de communication.

Une pratique féminine
Plusieurs cartes photo témoignent d’une pratique féminine répandue au tout début du XXe siècle dans les zones rurales d’Amérique du Nord. Telle image envoyée par « Elisabeth » à sa « Cousine Sarah » a parcouru près de 5000 kilomètres. Elle a été envoyée de Concord en Californie sur la côte ouest, à Vermont, à l’autre bout du pays, sur la côte nord-est. Dans l’espace vierge réservé sous l’image, Elisabeth explique qu’il s’agit de son premier essai de carte photo faite entièrement par elle. Comme l’inventeur de la photo Nicéphore Niépce quatre-vingts ans plus tôt, la jeune femme a photographié ce qu’elle voit depuis sa maison, « c’est la vue juste devant notre maison ». Elle promet ensuite d’envoyer aussitôt une image montrant cette fois la maison elle-même. La photo[1]graphe a ici utilisé un papier cyanotype produisant des images bleues. Ces papiers cyanotypes furent proposés comme alternative aux teintes gris-noir des papiers gélatino-argentiques. Les cyanotypes postaux restèrent populaires jusque dans les années 1920. Ils étaient simples à produire, leur traitement se réduisant à un rinçage.

Désastres
Les événements funestes sont une manne pour certains photo[1]graphes, qui en tirent profit en les produisant en quantité avant de les commercialiser. Chacun peut ainsi les partager avec des proches plus ou moins lointains. Ici, l’incendie d’un garage ou celui d’un immeuble; là, le déraillement d’un train ou encore les dégâts matériels ou humains causés par un cyclone, une tornade, une tempête ou une avalanche.
Lorsque l’engouement pour les cartes postales photographiques s’empare de l’Amérique rurale au début du XXe siècle, les images photographiques commencent tout juste, grâce à la similigravure, à s’immiscer dans les textes des journaux. À la même époque, en 1905, les services postaux mettent en placent un tarif extrêmement favorable à l’envoi de cartes photos [de l’ordre de un penny]. À cette mesure s’ajoute la généralisation, en 1906, du principe de rural free delivery.
Pour accéder à leur courrier, ceux qui habitent loin des villes n’ont désormais plus nécessairement à se rendre au bureau de poste lointain qui leur est attribué. On peut désormais recevoir des images postales chez soi. C’est alors le moyen le plus rapide de faire parvenir de l’information, de « l’actualité en images » dans les campagnes. Les photographes en eurent l’intuition lorsqu’ils stimulèrent l’utilisation de la carte photo dans ce sens, bien avant que la radio ne pénètre les foyers.

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English

Prix impression photographique des Ateliers Vortex :
Prune Phi, Bottoms up
22.02 ... 18.05.2025
vernissage : samedi 22 février à 11h
Téléchargez le communiqué de presse ici

Dans un travail mixant sculptures, objets et photographies, Prune Phi explore les traces, les points d'ancrage, les lacunes de ce qui fait mémoire. L'interpénétration de souvenirs individuels et collectifs, de photographies de famille, d'imagerie officielle et d'objets exotisants devenus ordinaires, matérialise la complexité d'un récit de l'immigration vietnamienne.
"Bottoms up" (2025) est une installation composée d’étagères, d’un vaisselier, de verres à saké, d’images personnelles et d’archives collectées au Musée Nicéphore Niépce abordant l’invisibilisation des corps et des récits liés aux diasporas vietnamiennes dans le sud de la France.
La Rizière
était le nom du restaurant de mes grands-parents dans l’Aude. Je me souviens des bols en porcelaine aux motifs bleus reposant sur les tables, de l’odeur chaleureuse du riz cuit se mêlant à la nausée des haleines imprégnées de saké. Là, le riz est consommé non seulement comme aliment, mais aussi comme objet de fétichisation et de rituel. Les plats sont associés à de l’alcool de riz, servi dans des verres à saké ornés d’images kitsch de corps asiatiques cachés — reflétant le regard occidental tout en déformant leur signification culturelle.
Pendant ma résidence, j’ai exploré les archives liées aux origines des rizières en France, le rôle des travailleurs forcés indochinois dans l’introduction de la riziculture lors de la Seconde Guerre mondiale en France. La recherche m’a emmené plus loin, je me suis intéressée aussi à ce qui fait écho : les plats à base de riz et l’alcool de riz, les croyances liées à cette céréale, les écosystèmes aquatiques de la rizière et à leurs organismes vivants, ainsi qu’aux représentations des hommes et femmes asiatiques vues d’un point de vue occidentalisé. J’ai collecté des verres à saké que j’ai réparé en remplaçant les images de nu·es par les images collectées. Ces verres réparés deviennent des témoins résistants, reflétant une mémoire recomposée qui interroge l’effacement des corps et des récits. »
Prune Phi
Ce projet photographique, primé et produit par Les Ateliers Vortex et le musée Nicéphore Niépce, s'inscrit dans le cadre de neuvième édition du Prix Impression photographique soutenu par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English

Benoît Henri Tyszkiewicz,
Entre Lituanie et France
09.11.2024 ... 19.01.2025
vernissage : vendredi 22 novembre à 10 h
Téléchargez le dossier presse en français, et en anglais.

Le comte de Raudondvaris Benoît Henri Tyszkiewicz [1852-1935] est l’un des pionniers de la photographie d’art en Lituanie. Orphelin à l’âge de huit ans, il est emmené de Lituanie par son grand-père pour vivre à Paris en 1862. Bien qu’il ait vécu en France, puis dans d’autres pays, il n’a cessé de revenir en Lituanie et d’enrichir régulièrement sa résidence à Raudondvaris de livres et d’œuvres d’art ramenés de ses voyages. En tant que représentant de l’une des familles aristocratiques les plus célèbres et les plus riches de Lituanie, le comte avait la possibilité d’utiliser les meilleures technologies de l’époque et fut l’un des premiers à acquérir toutes les nouvelles innovations photographiques.
Membre de la Société française de photographie dès 1884 et du prestigieux Photo-club de Paris en 1898, il participe à partir de 1894 à des expositions et ses photographies sont éditées dans les publications importantes aux côtés des plus célèbres photographes pictorialistes français de l’époque, Constant Puyo, Robert Demachy, etc. On estime que les vingt années de pratique de Tyszkiewicz composaient un fonds d’environ 20000 tirages et négatifs. Longtemps restée inconnue, on pensait sa production en grande partie disparue, détruite pendant la Première Guerre mondiale. Mais en 1993, le musée Nicéphore Niépce acquiert 86 tirages du photographe. Depuis, plus de sept cents photo[1]graphies ont été découvertes et sont actuellement conservées en Lituanie. En 2024, ce sont neuf albums reliés de photographies de Tyszkiewicz qui ont été achetés par un collectionneur lituanien, deux de ces exemplaires sont présentés dans l’exposition. Les photographies de Tyszkiewicz rassemblent des autoportraits, des portraits de sa famille et de son cercle d’amis, de leurs loisirs et de leurs voyages à l’étranger et de ses lieux de résidence en France et en Lituanie. L’œuvre de Tyszkiewicz correspond pleinement aux tendances photographiques européennes de l’époque et n’a pas d’équivalent en Lituanie.
Cette exposition est organisée dans le cadre de la Saison de la Lituanie en France 2024. Elle réunit 101 planches comprenant 333 photographies, ainsi que deux albums et des ouvrages, provenant des collections du musée Nicéphore Niépce, de collectionneurs privés et de quatre musées lituaniens.
Commissariat de l’exposition:
Dainius Junevičius
Emmanuelle Vieillard
Audrey Lebeault
Scénographie, montage: équipe du musée Nicéphore Niépce
Coordination: Vilija Ulinskytė-Balzienė
Laura Auksutytė
Coproduction:
Musée Nicéphore Niépce
Kauno Rajono Muziejus
Aušros Muziejus, Šiauliai
Prêteurs:
Kauno Rajono Muziejus, Kaunas
Fotografijos Muziejus,
Aušros Muziejus, Šiaulia
Gražina Petraitienė, Vilnius
Dominykas Šaudys
& Regina Šemiotaitė, Kaunas
Lietuvos Nacionalinis
Dailės Muziejus, Vilnius
Kretingos Muziejus, Kretinga
Musée Nicéphore Niépce
Chalon-sur-Saône

La saison de la Lituanie en France 2024
Se voir en l’autre/Kitas Tas Pats
Décidée par les présidents français et lituanien, la Saison de la Lituanie en France se déroulera du 12 septembre au 12 décembre 2024. Point de départ d’un renouveau des échanges culturels franco[1]lituaniens, la Saison de la Lituanie en France présentera au public français la Lituanie contemporaine et sa culture à travers les formes les plus diverses: performances, expositions, spectacles, projections, débats, conférences, gastronomie… Elle a aussi pour objectif d’initier des coopérations de long terme entre les institutions et créateurs lituaniens et leurs partenaires français.
À travers trois grandes thématiques — Voisinage global, Diversité et identités, Imagination débridée — la programmation de la Saison couvrira un large éventail de phénomènes culturels contemporains, de media et de thèmes d’actualité, en suscitant des explorations créatives et une réflexion sur le passé, le présent et les futurs possibles et en abordant les valeurs essentielles de l’Europe: la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, les droits humains, la créativité et la résilience face au changement climatique. Portée par l’idée que « l’autre est toujours différent mais jamais complètement autre» comme l’a écrit le philosophe lituanien Viktoras Bachmetjevas, la Saison de la Lituanie en France a pour ambition de réunir nos deux pays pour mieux se comprendre et d’offrir une programmation collaborative et inclusive qui encourage chacun d’entre nous à se voir en l’autre.
Commissaire Générale:
Madame Virginija Vitkienė [Lituanie],
docteur en histoire de l’art et critique d’art,
commissaire d’expositions d’art contemporain [2004-2022],
directrice artistique de la Biennale de Kaunas [2009-2017],
directrice générale de Kaunas 2022 – Capitale européenne de la culture [2018-2023]




![Benoît Henri Tyszkiewicz Paris [?], Benoît Henri Tyszkiewicz en costume tyrolien 1893 © musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône Benoît Henri Tyszkiewicz Paris [?], Benoît Henri Tyszkiewicz en costume tyrolien 1893 © musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/benoit-henri-tyszkiewicz/image-62/65194-1-fre-FR/image-6_smartphone.jpg)

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Jean-Christian Bourcart
La vie est un rêve et les images en sont la preuve
09.11.2024 … 19.01.2025
vernissage : vendredi 15 novembre à 18h45
Télécharger le dossier presse

La photographie est en constante mutation depuis son invention au début du XIXe siècle. De l’artiste-auteur revendiqué à l’amateur qui saisit son quotidien, de la captation compulsive au portrait de studio, les photographes ont su s’emparer des évolutions successives du médium photographique pour tenter de saisir leur réel et partager leurs visions. Le phénomène s’est accéléré avec l’émergence du «numérique», la démocratisation du smartphone et le développement des réseaux. Aujourd’hui l’intelligence artificielle remet profondément en cause le métier de photographe et crée de nouveaux types d’imaginaires. Tandis que le musée Nicéphore Niépce défend l’idée qu’il y a autant de pratiques photographiques qu’il y a de praticiens, accompagner des photographes dans leur cheminement, étudier leur archive et les exposer au public éclaire le rapport que nous entretenons tous avec la photographie, alors que les apports croissants des technologies de génération d’images remettent en cause nos certitudes.
Jean-Christian Bourcart a confié son fonds photographique au musée Nicéphore Niépce en 2016: négatifs, planches contacts, tirages d’exposition, archives de différentes natures. Ce fonds est exemplaire à plus d’un titre tant il est riche de diversité, de points de vue, de formes, de pratiques, tandis que Bourcart a traversé les époques en quelque quarante ans de carrière. Sans jamais cesser de porter un regard à la fois attentif et critique sur le médium et son évolution. Sans jamais s’enfermer dans une voie ou dans une autre.
Photographe de mariage, photographe de presse, photographe corporate, indépendant ou diffusé en agence [Rapho, Getty], artiste n’hésitant pas à faire cohabiter images photographiques et images animées, Bourcart a expérimenté les évolutions technologiques de son temps [transition argentique/ numérique, cinéma, réseaux sociaux, algorithmes] tout en s’interrogeant constamment sur les modes de production des images, leur destination, leur circulation, leur réemploi et leur réception. Depuis ses débuts à Libération dans les années 1980, le photographe a inlassablement testé les certitudes et les a priori autour de la photographie et expérimenté ses multiples possibilités de déploiement.
Ses différentes séries, qui ont progressivement quitté les pages imprimées des magazines pour s’exposer sur les cimaises des galeries et des musées, reflètent les réflexions de l’auteur quant aux images photographiques, leur rapport au réel et leur perception par le public. Photographe voyeur [cf. l’exposition que le musée lui a consacré en 2018, Une excuse pour regarder], Jean-Christian Bourcart a prélevé le réel, accumulé, organisé, réorganisé, tenté de trouver du sens et interrogé les sens, les siens et ceux des autres: «Au début, je croyais que je devais aller quelque part, que j’avais des choses à accomplir. Mais on se trompe toujours sur les motifs. J’oublie que je cherche juste à me souvenir. Quelque chose autour du non-sens primordial. L’espace entre deux lignes, deux vies, deux mots. »1
Tandis que le photographe semble errer sans but, cet apparent détachement est mis au service d’un questionnement permanent de son activité de photographe [de son statut] et de la perception du réel qu’elle induit ou génère, par lui et pour les autres. Il en résulte une œuvre extrêmement cohérente, en dépit d’une apparente hétérogénéité, explorant les limites du photographique, au point qu’elle semble parfois avoir été réalisée par différents auteurs: « Je me reconnais bien dans la phrase de Marcel Duchamp: ‘Je me suis forcé à me contredire pour éviter de me conformer à mon propre goût.’ J’assume le côté paradoxal de ma production, je laisse le spectateur tirer ses propres conclusions, voir où ça le touche, où ça le séduit, où ça le gêne, où ça l’ennuie. Évidemment, on ne fait jamais n’importe quoi et quelque chose se construit. On essaie d’y lire une cohérence et ce qui se révèle, c’est peut-être le portrait protéiforme de quelqu’un d’ordinairement complexe à travers une époque qui change vite. »2
1. J.-C. Bourcart, Naître sans cesse, L’Écailler, 2024
2. Art Press nº526, novembre 2024, entretien avec Étienne Hatt
Points de jonction entre les époques, les carnets new-yorkais de Bourcart sont les traces matérielles les plus concrètes de sa recherche constante de formes nouvelles pour interroger à la fois le réel et sa transcription en photographies. Alors que le photographe s’installe à New York au début des années 2000, que la photographie risque de devenir qu’un simple pis-aller alimentaire trop formaté, il s’en va déambuler dans la ville photographier ce qui l’entoure. Ainsi, pendant sept ans, il accumule et range les images produites dans des petits albums plastifiés, comme une façon d’appréhender la ville tentaculaire et ses habitants: « Ce ne sont pas là des albums, auxquels l’on réserve communément le privilège de figurer une vie familiale ritualisée, dont les étapes se succèdent nécessairement, ne laissant paraître que le meilleur, que l’on confond d’ailleurs avec le plus mémorable. Les carnets de Bourcart tiennent un peu de la forme-atlas mais n’en sont pas à proprement parler; c’est plutôt à force d’images, à force de rassemblements d’images qu’ils s’en approchent, mais ils n’ont pas la prétention totalisante – quoique toujours en échec – dont se parent les atlas sur les sujets dont ils traitent. […] Précisément, de ce grand répertoire d’images qu’a formé Bourcart dans ses années new-yorkaises, comme un archéologue aurait tenu son carnet de fouille, s’impose quelque chose comme un abécédaire visuel pour enfant, singulier et hérétique, dans les marges de l’alphabet et de tout ce que le langage appelle de normes, préparé pour un enfant à qui on ne saurait mentir et à qui on aurait donc tout dit. […] Ces carnets, produits sans but et pourtant offerts à qui de droit et à qui veut bien, dessinent ainsi les galeries d’une mine, parce qu’on y descend dans les bas-fonds grouillants de l’activité humaine, qui nous sont suggérés ou exposés dans leurs aspects les plus sombres; mais en fin de compte, ils nous conduisent aussi aux origines du volcan qu’ils façonnent […] parce qu’en rejaillissent systématiquement des instants de grâce volés à la crudité du réel. »3
Considérés ainsi, ces carnets redécouverts à l’occasion de la donation du fonds de l’auteur au musée Nicéphore Niépce, apparaissent comme la quintessence de sa démarche, une accumulation qui ne se contente pas d’exister pour elle-même. Plus seulement l’avatar d’une pratique ô combien commune de catalogage visuel du monde, mais bien la poursuite d’un programme [in]conscient d’interrogation des images photographiques et de leur destinée: «Ainsi vont les carnets de Bourcart qui, de proche en proche, en prélevant presque compulsivement des fragments d’un réel par définition partagé et singulier à la fois, dessinent une multitude d’intentions qui s’alimentent entre elles. Ils commencent à faire œuvre, non pas comme l’œuvre qu’on attend de la carrière d’un artiste, mais ils commencent à œuvrer à quelque chose: à inaugurer un récit, une façon de phraser le monde par les images. Le fragmentaire finit par cimenter une unité, et des éléments épars catalysent un regard, mais qui n’aurait rien d’autoritaire ni de surplombant: un regard polymorphe, incertain, dubitatif et inquiet, un regard sensible à ce qu’il voit, un regard toujours troublé par ce qu’il voit et qui lui donne le désir d’en voir toujours plus, c’est-à-dire de risquer toujours plus gros. »4
Placés à l’entrée de l’exposition, une rétrospective qui ne dit pas son nom, les carnets new-yorkais de Jean-Christian Bourcart donnent des clefs de lecture de son œuvre, tout en brouillant les pistes. Ils sont comme un entre-deux, à l’instar d’un songe où illusions et réalité s’entremêlent. De l’observation du réel à la captation, de l’agglomérat d’images rassemblées en carnets à leur recomposition en séries factices, sources potentielles de nouveaux corpus, c’est le cheminement du photographe qui transparaît, à la fois flottant et déterminé. Derniers avatars de sa pratique argentique, les carnets ne sont pourtant pas le point final. Nous ne sommes pas obligés de croire Bourcart lorsqu’il affirme: « J’aime toujours ce médium, son pouvoir extraordinaire de se saisir de l’instant, de le sauver et de le tuer en même temps, même si je reconnais rationnellement son artificialité, sa qualité de leurre absolu mais je n’ai plus besoin de tout ‘saisir’ compulsivement comme ça a pu être le cas. » 5
Depuis 2020, sa compulsivité a trouvé écho dans les possibilités infinies des algorithmes d’I.A. Ses posts réguliers sur les réseaux sont là pour en témoigner. Les dernières recherches de Bourcart avec les intelligences artificielles sont comme de nouveaux carnets, «qui semblent vouloir garder la mémoire de ce qui a été rêvé au cours d’une nuit – d’une vie, somme toute – agitée, confuse, tentaculaire. Ils accumulent les images comme on rédigerait un mémorandum, parce que ‘la vie est un rêve et les images en sont la preuve’. »6
3. Guillaume Blanc-Marianne, in Les carnets new-yorkais, Atelier EXB, Paris, 2024
4. Guillaume Blanc-Marianne, in Les carnets new-yorkais, Atelier EXB, Paris, 2024
5. Art Press nº526, novembre 2024, entretien avec Étienne Hatt
6. Guillaume Blanc-Marianne, in Les carnets new-yorkais, Atelier EXB, Paris, 2024 L’ouvrage Carnets new-yorkais [Atelier EXB, à paraître le 7 novembre 2024] accompagne l’exposition. Cette édition a bénéficié du soutien des Amis du musée Nicéphore Niépce
Commissariat de l’exposition:
Jean-Christian Bourcart
Guillaume Blanc-Marianne
Sylvain Besson Scénographie, montage: équipe du musée Nicéphore Niépce
Remerciements:
Les Amis du musée Nicéphore Niépce
Canson
La Maison Veuve Ambal
Charlotte Boudon Philippe Artières
Nathalie Chapuis
C.O. Jones

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Oscura
Une pratique collective du sténopé
29.06...29.09.2024
inauguration : samedi 29 juin à 11h
Téléchargez le dossier presse ici

Commissariat de l’exposition :
Elisabeth Towns et Jean-Michel Galley, Oscura
Brigitte Maurice-Chabard, musée Nicéphore Niépce
Scénographie, montage: équipe du musée Nicéphore Niépce
Le musée remercie
Le Bec en l’Air
La société des Amis du musée Nicéphore Niépce

Fondée au début des années 1990, l’association Oscura fait œuvre collective autour de la pratique du sténopé. Procédé photo[1]graphique aisé à mettre en œuvre [une boîte, un trou, une surface photosensible], plus simple déclinaison de la camera oscura des anciens, le sténopé est l’occasion pour Oscura de créer du lien par l’entremise d’une centaine d’ateliers organisés un peu partout, de Saint-Denis à Bamako, du Havre à Sarajevo depuis près de 35 ans.
Chaque intervention d’Oscura repose sur sept caractéristiques présentées dans l’exposition: «Mise en boîte», «Lieux à prendre», «Courants d’air », «Le corps pose», «Les loges de la lenteur », «Trans-Plantations», «Souffles frontières». Déclinées au sein des ateliers, ces caractéristiques interrogent notre rapport au monde et sa représentation.
Tandis qu’aujourd’hui, il n’a jamais été aussi simple de faire des photographies, que le numérique offre la «perfection» pour reproduire le réel, qu’une simple pression du doigt sur l’écran d’un smartphone «standardisé» saisit ce que l’on voit au plus près, Oscura renouvelle la question de la production des images photographiques. Chaque participant aux ateliers d’Oscura fabrique sa propre chambre photographique, choisit le positionnement du trou et se confronte au temps long, à la réflexion quant au positionnement de la boîte, à l’expérimentation des déformations de l’image induites par la forme de son «appareil ».
Les préoccupations d’Oscura rejoignent celles du musée Nicéphore Niépce: la photographie ne saurait se réduire à une pratique, à un protocole, à des certitudes. Mais elle est manifestement un formidable moteur d’histoires, singulières et collectives.
Oscura : sept apprentissages
1 . Mise en boîte
La photographie au sténopé est une pratique contemporaine. À l’inverse des pionniers de la photographie qui cherchaient à gagner du temps, l’association Oscura prend le parti de la lenteur dans un monde pressé. Toutes ces images-temps sont collectives; elles affirment la coexistence de l’autre et de soi-même, elles explorent l’aura d’une nouvelle liberté en photographie. Le sténopé, c’est aussi une histoire de petit trou et de boîte. On peut bien sûr l’acheter, mais Oscura a toujours préféré fabriquer ses chambres avec une boîte en fer résistant au soleil et à la pluie. Se mettre en quête d’une boîte, c’est déjà découvrir un territoire et ses habitudes. Biscuits, boutons et boulons seront délogés. La taille de la boîte déterminera celle du négatif papier et donc de l’image. On met du temps à choisir l’endroit où percer le sténopé: au flanc ou sur le couvercle? Moment crucial. Commence l’expérimentation de la lumière. Une vignette, un reflet, du hasard au calcul, chaque essai personnalise les chambres.
2 . Lieux à prendre
Après la quête de la boîte vient le moment d’apprivoiser les lieux. Avant la prise de vue, il faut tourner avec sa boîte, la suspendre, l’accrocher, la renverser ou la scotcher. Elle peut aussi rester dans les mains, le flou s’invite et déplace les lignes. Faire une image au sténopé, c’est avoir fait tout le tour d’un espace pour trouver où nicher la boîte. C’est chercher le soutien d’un bâton ou d’une pierre, l’hospitalité d’une branche, d’un rebord de mur ou d’une barrière. À chaque fois, il faut évaluer la direction possible ou imposée, la souplesse et la résistance d’un perchoir, la force du vent et les parcours de l’ombre ou des courants. Pourtant rien n’est exclu tout à fait, ni une rafale, ni une chute, ni un choc, une dérive des éléments du dedans et du dehors.
3 . Courants d’air
En sténopé, pas de réglage de l’ouverture. Une fois percé le petit trou, seule l’intensité de la lumière et l’émulsion peuvent varier. Pour mieux partager l’acte photographique Oscura a choisi de travailler avec du papier photo[1]sensible [noir et blanc] comme négatif. Ces facteurs induisent de longs temps de pose. Souvent, le corps qui veut être photographié ne mesure pas bien l’effort qui lui sera demandé. Habitué à l’instantané entre le clic et le clac du déclencheur, il prend la pose et s’étonne de ne pouvoir la garder. Les baskets neuves, le rouge à lèvres, les belles tenues du dimanche, n’y peuvent rien: le corps glisse, se décale, tressaille et se tend. Quand il s’en rend compte, poser devient pour lui un bras de fer contre le temps. Il est souvent trop tard. L’épreuve gardera la trace de cette lutte.
4 . Le corps pose
Puis la pose devient pause. Qui cherche un portrait va devoir s’accoutumer aux longues secondes au cours desquelles les muscles s’allongent ou se tendent dans une parenthèse temporelle. On s’éloigne de l’instantané pour que l’image de soi éclose d’une durée. La pensée s’assemble dans un étrange dialogue avec soi Oscura: sept apprentissages 3 ou avec ce qui est déjà un peu le devenir d’un autre. Le corps cherche le confort, prend appui, s’adosse ou se couche. Il se repose. Il est prêt pour une traversée face au temps. Commence un voyage dans l’obscurité de la chambre ouverte sur la persistance du cœur et du corps. Les lieux mêmes dans lesquels se déploient ces pauses s’affranchissent du quotidien.
5 . Les loges de la lenteur
Au fur et à mesure, les risques de la durée deviennent un besoin, une aventure bouleversant les limites de la conscience et de la perception. Pendant des heures d’ouverture du sténopé, les corps ont pu se fondre dans les lignes et les surfaces, dans la confusion des nuits et des jours. Après avoir délicate[1]ment posé sa boîte sur l’armoire, un corps ouvre le lit et rêve à l’inscription sympathique d’un désir silencieux, et au matin referme la couverture comme celle d’un livre qui continuerait de s’écrire, sans auteur. Dans la cave, le jour passe à écouter des feux follets dont on ne sait ni d’où ils viennent, ni où ils se cachent quand gronde la fermentation. Tandis que lève la pâte du boulanger, seule l’obsession des machines évoque les heures du travail de l’aube tandis que dans l’angle d’un cloître, toutes les prières s’amoncellent pour que le temps s’évanouisse enfin.
6 . Trans-plantations
C’est le rapport entre le volume de la boîte et la taille du sténopé qui fait varier la profondeur de champ et offre la multitude des plans possibles. Au départ, Oscura voulait calculer au mieux cette relation fondamentale et harmonieuse afin de générer le meilleur diaphragme possible. Il est dit que poussée à l’extrême cette relation permet à certains astronomes de bénéficier de profondeurs de champ infinies, ouvrant à des observations inacces[1]sibles aux meilleurs télescopes. Les premiers pas furent souvent dédiés à cette quête d’exactitude, Du grand horizon, Oscura s’est rapproché du lieu pour découvrir les profondeurs plus intimes, de l’étroite rue de Naples, de la cour fermée à Mopti, ou de la fragile caravane de Shutka. Un sténopé pour se laisser voguer vers d’étranges champs et perspectives.
7 . Souffles frontières
Par le sténopé, le jeu des plans en arrive à une confusion entre le dehors et le dedans. Et comme par un baiser impossible entre deux mondes qui devaient se tenir éloignés, les proportions sont abolies. Étonnement. Ici la pierre s’est faite chair. On dévale une main, on escalade un pied, on saute de doigt en doigt pour arriver à une feuille qui lui servira de hamac. Ce monde-là sait faire du grand avec du petit. Il ne déforme rien, il exagère. La cartographie du sténopé ignore la boussole et l’échelle métrique des distances à franchir. Distorsion et pliage de l’espace, en s’approchant à l’excès on ne s’éloigne jamais aussi bien du connu. Un sténopé pour passer de l’autre côté du miroir de la photographie.
Jean-Michel Galley & Élisabeth Towns Association Oscura
Un livre accompagne l’exposition:
Oscura
éditions le bec en l’air
ISBN 978-2-36744-190-0
36 euros
Cette édition a bénéficié du soutien de la Ville de Chalon-sur-Saône et du ministère de la Culture.
Commissariat de l’exposition :
Elisabeth Towns et Jean-Michel Galley, Oscura
Brigitte Maurice-Chabard, musée Nicéphore Niépce
Scénographie, montage: équipe du musée Nicéphore Niépce
Le musée remercie
Le Bec en l’Air
La société des Amis du musée Nicéphore Niépce

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English

Demain est un autre jour
Grande commande pour le photojournalisme
29.06...29.09.2024
inauguration : samedi 29 juin à 11h

Commissariat de l’exposition:
Sylvain Besson, musée Nicéphore Niépce
Scénographie, montage: équipe du musée Nicéphore Niépce
Le musée remercie la Bibliothèque nationale de France, en particulier Sylvie Aubenas, Héloïse Conésa et Emmanuelle Hascoët et la société des Amis du musée Nicéphore Niépce

Tandis que la France se remettait plus ou moins facilement de la pandémie de COVID, deux cents photographes, à l’occasion d’une Grande commande pour le photojournalisme, dans le cadre de France Relance et sous l’égide de la Bibliothèque nationale de France, se lançaient dans une aventure sans précédent, avec un seul objectif: rendre compte de la remise en route du pays, qui comme le reste de la planète s’était retrouvé brutalement à l’arrêt des mois durant.
Face à la stupéfaction, l’inimaginable, le deuil, le boule[1]versement de nos habitudes et de nos certitudes, deux cents propositions, deux cents reportages couvrent la France entre 2021 et 2022, telle une «Radioscopie de la France». Vaste programme, dont il n’est pas aisé d’identifier une cohérence d’ensemble ou d’extraire des séries qui se dégageraient des autres par leur puissance d’évocation. La force de cette commande réside justement dans cette hétérogénéité de regards, dans cette œuvre collective qui prélève durant deux années des morceaux de France et de la vie des Français, sans omettre un seul territoire [de Métropole et d’Outre-mer] tout en s’efforçant de n’oublier personne [dans la mesure du possible tous les âges et toutes de catégories sociaux-professionnelles] même si avec 200 reportages «seulement », il est impossible d’être exhaustif.
Ce temps long offert aux photo[1]graphes est celui du reportage photojournalistique, qui autorise à s’approprier un sujet, identifier et rencontrer les bonnes personnes [témoins, chercheurs…], choisir sa méthode, réfléchir à une narration puis produire une forme de restitution qui fait sens, informe et questionne. Cette Radioscopie de la France illustre, ô combien, la formidable capacité de la photographie à raconter, témoigner, éclairer, interroger. Chacun des 200 auteurs sélectionnés a pu prendre le temps de prendre son temps [une année chacun] pour construire son essai photographique, loin des impératifs de l’urgence de l’actualité et imaginer la configuration la plus efficace pour transmettre ses prélèvements du réel.
Le musée Nicéphore Niépce a choisi d’accompagner la Grande commande pour le photojournalisme par la présentation des travaux de 14 photographes: Ed Alcock, Jean-Michel André, Aurore Bagarry, Sylvie Bonnot, Julie Bourges, Céline Clanet, William Daniels, Hélène David, Pierre Faure, Marine Lanier, Olivier Monge, Sandra Reinflet, Sarah Ritter, Bertrand Stofleth. Alors que le musée Nicéphore Niépce tend à l’exhaustivité, collectant, étudiant, exposant toute la photographie, sous toutes ses formes, de l’invention du procédé à nos jours, ces quatorze propositions traduisent autant d’approches singulières qui accompagnent le musée dans sa réflexion sur le médium tout en traitant d’enjeux actuels, ceux du monde post-COVID. Pour l’exposition, le musée a choisi d’offrir aux photographes la possibilité d’aller au-delà de leurs premiers choix, de revisiter avec eux les corpus plus larges produits durant leur année de prise de vue. Ces propositions originales offrent une réflexion renouvelée de ces travaux.
La pandémie a remis au goût du jour des problématiques encore latentes avant son apparition et les a exacerbées. Le creusement des inégalités et la situation désastreuse de trop nombreux territoires sont explorés par Pierre Faure avec des prises de vue sobres et humbles en argentique tandis qu’Aurore Bagarry recueille les souvenirs de personnes âgées, détentrices d’une mémoire qui s’efface mais dont elle garde trace en regard de leur portrait et des paysages qu’ils habitent.
Avec la pandémie, la prépondérance du numérique dans notre quotidien fut patente. Elle a éclaté au grand jour, ainsi que son versant indispensable, les Datas Centers, ces grandes « fermes» à serveurs sécurisées où sont stockées et transitent toutes nos données numériques. Olivier Monge y a eu accès et en révèle à la fois le clinquant et la désincarnation.
La désindustrialisation française est effective dans de nombreux domaines et la pandémie nous a placés face à ce constat. Jean-Michel André interroge les territoires où cette désindustrialisation est la plus évidente, alternant paysages lunaires et portraits de descendants d’ouvriers des bassins miniers, quand Sarah Ritter explore les Archives nationales du monde du travail pour évoquer avec poésie ce que fut cette histoire.
Lors de la pandémie, la nature a repris ses droits et plusieurs photographes ont interrogé la nécessité de se reconnecter à la nature, notamment Julie Bourges et ses portraits de femmes marin pêcheurs ou Hélène David, par un savant assemblage de prises de vue et d’images d’archives, de recueils de témoignages divers et de propositions scénographiques complexes. De son côté, Céline Clanet s’est aventurée dans des espaces naturels protégés, jalousement conservés à l’abri des promoteurs et des exploitants. Lorsque la photographie rime avec engagement.
Engagement toujours, lorsque Sandra Reinflet oppose photographies de militants à Bure manifestant contre l’enfouissement des déchets et vues d’infrastructures « idylliques» mais désespérément vides, fruits des subventions destinées à faire accepter cet enfouissement. La production d’énergie nucléaire est également au cœur du travail d’Ed Alcock qui questionne le paysage et le mode de vie des habitants résidant autour des dix-huit centrales nucléaires françaises.
Les effets du changement climatiques ne sont plus contestés aujourd’hui, la pandémie a fait office de révélateur. L’approche documentaire de Sylvie Bonnot sonde la complexité des relations nature/industrie dans le cadre de l’exploitation forestière et des modifications du climat. Quand Bertrand Stofleth et William Daniels se confrontent frontalement aux effets de ces dernières sur la côte Atlantique, la Loire et la Gironde. De son côté, Marine Lanier collabore avec des chercheurs qui œuvrent à remédier au change[1]ment climatique au sein du jardin du Lautaret et multiplie les proposi[1]tions formelles pour restituer leurs efforts.
Chacun à leur manière, les photographes de la Grande commande nous racontent des histoires, éclairent notre regard et éveillent notre conscience. Ce faisant, ils gardent traces de notre société postpandémie.
Pour l’histoire.
Sylvain Besson

Retrouvez une biographie des photographes ainsi qu'une description de leurs projets sur le site : Grande commande photojournalisme [culture.gouv.fr]

Ed Alcock
(né en 1974, Royaume-Uni)
Après un doctorat en mathématiques, Ed Alcock devient correspondant à Paris, pour The Guardian et The New York Times. Il collabore aujourd’hui, entre autres, avec Le Monde
, L’Obs
, Elle
, Télérama
, Madame Figaro
, The Observer Review
. Ses sujets de prédilection sont l’intime, l’identité et le territoire. Il a notamment travaillé sur la relation fusionnelle mère-fils, les ravages des secrets de famille, le Brexit, le confinement. Son travail est régulièrement exposé en Europe et il est membre de l’agence Myop.
Zones à risque
Dans un contexte de relance de l’énergie nucléaire, Ed Alcock documente le quotidien des habitants des « zones à risque », ces territoires situés dans un rayon de 5 kilomètres autour des dix-huit centrales françaises. Il cherche à comprendre s’ils appréhendent le danger qu’ils encourent ou si le discours rassurant du secteur et la richesse des communes où ils vivent les confortent dans leur choix de vie.
Jean-Michel André
(né en 1976).
Diplômé de l’École des Gobelins, Jean-Michel André poursuit un travail reposant sur une vision politique et poétique du territoire, dont il interroge les limites, la mémoire et les évolutions. Il explore aussi la notion de circulation, celle des flux économiques, financiers et migratoires, comme dans son dernier projet, « Borders » publié par Actes Sud et exposé aux Rencontres d'Arles en 2021. Lauréat de la bourse du Talent en 2017, du Cnap en 2022 et du Prix Maison Blanche en 2023, son travail est publié et régulièrement exposé.
A bout de souffleRésident des Hauts-de-France depuis 2013, Jean-Michel André s’intéresse à la patrimonialisation et à la transition environnementale menées dans le Bassin minier, notamment grâce aux actions des associations et collectivités, et, plus récemment, à un grand plan national pour le renouveau du territoire. Les paysages qu’il photographie sont parfois lunaires, voire mystérieux, peuplés de chevalements, de terril de schiste noir mais aussi d’une faune et d’une flore qui reprennent leurs droits. Ils sont complétés par les portraits des enfants et petits-enfants de mineurs, habitants des cités minières, exilés aux vingt-neuf nationalités, arrivés par vagues successives pour travailler à la mine, dans cette région qui est également une terre d’accueil.
Aurore Bagarry
(née en 1982)
Diplômée en 2004 de l’École des Gobelins et, en 2008, de l’École nationale supérieure de la photographie, Aurore Bagarry propose une lecture personnelle du paysage composée d’un inventaire de formes, parfois fragiles bien que monumentales telles que « Glaciers », « Roches », « Les Formes de l’eau ». En 2020, elle était lauréate de la commande « Regards du Grand Paris ». Elle a publié Roches
avec Gilles A. Tiberghien en 2020 et Glaciers
avec Michel Poivert et Luce Lebart en 2022.
Le voyage immobile
Pour ce reportage, la photographe a réalisé, à la chambre 4 x 5 inches, une série de portraits de personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, en relation avec des paysages des Pyrénées. Les sujets photographiés résident à Prats-de-Mollo-la-Preste, village situé sous le dernier col conquis par Franco pendant la guerre d’Espagne, le col d’Ares. Avec ces portraits, Aurore Bagarry interroge les vestiges d’une mémoire qui s’évanouit petit à petit.
Sylvie Bonnot
(née en 1982)
Diplômée de l’École nationale d’art de Dijon, Sylvie Bonnot développe une recherche qui engage la nature de ses sujets et la matérialité de l’image en s’appuyant sur l’expérience physique de paysages souvent extrêmes. L’historique de l’image vient ensuite contribuer au devenir des résultats photographiques bidimensionnels, en volume ou in situ. Elle est régulièrement exposée et collabore avec la presse.
L’Arbre-machine (échos des canters)
Cette enquête photographique suit la piste des forêts françaises à travers une série de fragments collectés en métropole et en Guyane. Les grands écarts qui les caractérisent sont ici rapprochés pour témoigner d’une complexité paysagère et industrielle, entre la forêt primaire d’Amazonie guyanaise et les futaies monospécifiques de métropole.
Julie Bourges
Les eaux-fortes (High water)
Camille Brigant.
This is Camille at work on the VaFiAn. She has been working on the boat for four years. She studied business at maritime school but after a work experience stint on the fishing boat, she changed her career path. She mainly fishes for spider crabs and scallops when in season.
© Julie Bourges / Grande Commande Photojournalisme
Céline Clanet
(née en 1977)
Diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie, Céline Clanet s’intéresse aux lieux reculés ou secrets, aux paysages sauvages et à leurs occupants. Elle est lauréate du prix Critical Mass Award en 2010 pour « Máze », sur un village sámi en Laponie, de la bourse Reporters in the Fields de la Robert Bosch Foundation pour « Pasvik, the river that tell the High North » en 2019. Exposée en Europe et à l’étranger, elle a publié plusieurs ouvrages.
Les ilots farouches
Céline Clanet a exploré les espaces naturels les plus protégés de France métropolitaine. Sur ces territoires, potentiellement exploitables ou habitables mais dont personne ne peut disposer, toutes formes d’installation, de chasse ou de pêche, d’agriculture, de pâturage ou de prélèvements sont interdites. La présence humaine y est généralement proscrite et seulement concédée aux scientifiques venus observer, écouter, compter, mesurer. Ces espaces de protection radicale, dits en « libre évolution », représenteraient entre 1 et 2% du territoire métropolitain.
William Daniels
(né en 1977)
William Daniels commence sa carrière en 2002 après une formation au centre Iris à Paris. Son premier reportage, « Les petits fantômes de Manille », remporte le prix de la photographie sociale et documentaire en 2004. En 2007, avec « Faded Tulips », il explore la république du Kirghizistan et, en 2013, s’intéresse au Centrafrique. Il collabore notamment avec National Geographic
. Il a reçu plusieurs prix, dont deux World Press Photo et un Visa d’or.
Un climat français
William Daniels documente les stigmates des évènements climatiques extrêmes dans l’Hexagone. Depuis la France, la crise climatique semblait diffuse et lointaine jusqu’à 2022 qui s’est avérée être l’année la plus chaude et la sèche jamais enregistrée. En s’intéressant aux conséquences des épisodes de grande chaleur et de sécheresse, le photographe a exploré les bords de la Loire asséchée, les glaciers alpins qui perdent du terrain et n’alimentent plus suffisamment les nappes phréatiques des plaines, ou la Gironde, qui fut le théâtre de mégafeux cet été-là. Il a fait le choix de photographier des paysages vides d’humains, avec lenteur, dans des zones où les territoires subissent une transformation rapide et très visible.
Hélène David
(née en 1971)
Diplômée de l’École nationale supérieure Louis-Lumière, Hélène David cherche à renouveler les représentations de nos relations au vivant en associant la photographie documentaire à des pratiques comme la collecte d’archives et l’écriture. Son dispositif d’enquête invite volontiers d’autres auteurs, habitants ou institutions. Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions.
Autochtones, secrètes connivences avec le sol
Selon la mythologie basque, l’énergie qui féconde le monde surgit des profondeurs de la terre. Dans un contexte contemporain de crise écologique, ces récits archaïques nous invitent-ils à renouveler nos représentations du sol, ce socle vivant ? En partant de cette hypothèse, Hélène David arpente les reliefs des Pyrénées-Atlantiques à la rencontre d’intercesseurs paysans, archéologues ou chasseurs. Son travail d’enquête documentaire aborde ainsi la terre basque comme un continuum organique, un espace de porosités et d’interactions entre humains, animaux, plantés, éléments et ancêtres. La matière issue du terrain – photographie ou recueil de paroles - , tout comme la collecte d’images d’archives, peuvent alors enrichir sa recherche narrative : une partition chorale venue de l’enfoui.
Pierre Faure
(né en 1972)
Après des études en sciences économiques, Pierre Faure se tourne vers la photographie en 2010. Ses premières séries, dans lesquelles l’abstraction et les évocations organiques occupent une place centrale, jouent avec les notions d’échelle et de perspective. En 2011, il aborde la question sociale avec son travail sur les Tziganes d’Ile-de-France, puis s’attache au quotidien des personnes en grande précarité (« Les Gisants » en 2013, « Le Bateau » en 2014). Il est membre de Hans Lucas.
France périphérique
Cette série photographique s’inscrit dans un travail entrepris en 2015 afin de documenter la pauvreté en France. En parcourant l’ensemble du pays, Pierre Faure consacre environ deux cents jours par an à ces prises de vue. Celles-ci témoignent des conditions de vie de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans la région Nouvelle-Aquitaine, et de leur façon de faire face à la situation sanitaire. Le photographe tente de saisir dans ce quotidien les figures d’une humanité blessée.
Marine Lanier
(née en 1981)
En 2007, Marine Lanier est diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie. Issue d’une famille d’horticulteurs et de marins, sa recherche est centrée autour des questions du vivant, de la structure clanique, du lien, de l’aventure. Son approche relève de la fable documentaire et du réalisme magique. Elle a publié Nos feux nous appartiennent
(Poursuite)
(2016) et Le Soleil des loups
(2023). En 2018, elle était lauréate du Cnap pour son projet « Les Contrebandiers ». Elle expose en France et à l’étranger.
Le jardin d’Hannibal
Animée par notre rapport organique à la nature et aux éléments, Marine Lanier observe le comportement des plantes, l’activité des jardiniers, des scientifiques et des chercheurs au jardin du Lautaret, le plus haut d’Europe. Abritant les plantes et les essences alpines du monde entier, celui-ci a été créé dans le cadre de l’opération « Alpage volant » qui vise à trouver des solutions d’adaptation face au changement climatique – dans l’optique d’un réchauffement de 2 à 3 degrés à l’horizon 2100. La photographe joue avec les lumières, s’affranchissant des notions de réel et d’imaginaire pour produire des images monochromes et organiques dignes d’un conte mythologique et écologique.

Olivier Monge
(né en 1974)
Diplômé de l’École nationale Louis-Lumière en 1998, Olivier Monge réalise portraits et reportages pour la presse et mène un travail personnel à la chambre sur le territoire et le patrimoine ; dans ce cadre, il a produit « Montagne urbaine » (2014), « Greystones » (2016), « Water Please » (2019). Il a publié plusieurs ouvrages, dont Nice, hier et aujourd’hui
(2003) et La Promenade des Anglais
(2005). Il est directeur artistique de la galerie Fermé le lundi, à Marseille et membre de l’agence Myop.
Data Center La crise sanitaire et les épisodes de confinement successifs ont confronté nos sociétés à une dépendance grandissante aux outils numériques. Olivier Monge documente les grands data centers en France pour donner à voir les nouvelles matrices de nos vies modernes.
Sandra Reinflet
(née en 1981)
Sandra Reinflet utilise la photographie et le texte pour mettre en scène le réel. En 2020, « VoiE.X, artistes sous contraintes » a reçu le prix Roger Pic de la Scam et le prix des membres Carré sur Seine. En 2021, son travail « Les bâtisseuses » a été exposé sur la basilique de Saint-Denis. Elle réalise des actions culturelles pour amplifier la voie de ceux que l’on n’entend pas. Son travail est exposé en France et à l’étranger.
Le Prix du silence
Bure : quatre-vingts habitants, une salle des fêtes panoramique, des routes et lampadaires rutilants, une station essence comme sortie d’un film de science-fiction… Le laboratoire d’enfouissements des déchets nucléaires a changé ce paysage de la Meuse, l’un des départements les plus pauvres et les moins peuplés de France. Pour faire accepter ce projet destiné à enfouir les résidus nucléaires les plus radioactifs (jusqu’à quatre cent mille ans) à 500 mètres de profondeur, les villages alentour ont reçu d’importantes compensations financières. Par une alternance de photographies d’infrastructures subventionnées et de portraits d’opposants, Sandra Reinflet interroge les mécanismes d’implantation de ce projet que l’État semble vouloir faire aboutir à tout prix.
Sarah Ritter
(née en 1978)
Sarah Ritter travaille d’après une méthode heuristique, par accumulation d’images trouvant au fil du temps leur ordre et leur logique associative. Ce processus permet aux photographies de mûrir et de s’apparier, formellement ou métaphoriquement. Elle a publié La nuit craque sous nos doigts (2029), et à été lauréate du programme de recherche de l’Institut pour la photographie de Lille en 2021.
Ors
Prises de vues réalisées sur un site minier en Guyane française. Depuis 2021, Sarah Ritter mène une exploration sensible et de terrain sur les activités extractives. La Guyane est le territoire français qui compte le plus de mines en activités, du fait de la présence d’or dans son sol. Les mines peuvent être légales, encadrées par la législation française, ou illégales, prospection hors de toute précaution pour les humains qui y travaillent et pour le milieu environnant. Elle a pu assister à toutes les étapes de l’extraction de cet or, qui n’a pas d’autre valeur que monétaire dans notre monde. “Il y a une sorte d’abîme qui s’ouvre quand on le contemple, quand on en parle avec ceux qui l’extraient, le filtrent, le purifient, le fondent, le vendent. Une fascination toujours présente, toujours étrange, profonde. L’or est très jaune, très dense, et une toute petite pépite pèse déjà lourd dans ma paume. Elle pèse dans mon cœur, dans nos cœurs. J’ai choisi de montrer le moment où lances à eau, terre, cailloux, et bulldozer se rencontrent pour pro pulser l’or dans les tamis et les tapis de plastique qui vont le retenir.” En complément de la commande “Radioscopie de la France”, ce travail a reçu le soutien de l’Institut pour la Photographie des Hauts-de-France.

Bertrand Stofleth
(né en 1978)
Bertrand Stofleth croise photographie, recherche, collaborations et écritures. Ses images documentaires portant sur les modes d’habitation des territoires et interrogent les paysages dans leurs usages et leurs représentations. Depuis 2018, il documente les changements liés aux enjeux climatiques et sociaux. Il a publié plusieurs ouvrages, dont Rhodanie
(2016) et La Vallée
(2022). Son travail est présent dans différentes collections publiques et privées, en France et à l’étranger.
Atlantides
Avec ce projet, Bertrand Stofleth interroge les paysages et les habitants de la façade atlantique française à l’ère de l’anthropocène. Il arpente les abords du littoral, du trait de la côte à l’arrière-pays, depuis la pointe bretonne jusqu’à la frontière espagnole. En allant à la rencontre d’experts et d’habitants, il documente les conséquences du réchauffement climatique accélérées par le tourisme de masse : érosion, submersion marine, bouleversements des écosystèmes et de la biodiversité. Ce travail critique sur le paysage et son habitat met en lumière des stratégies d’adaptation, comme autant d’alternatives et de solutions.
28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English

Paysage(s) Fresson(s)
17.02...19.05.2024
Inauguration vendredi 16 février 2024 à 18h

À de rares exceptions près [Sudre, Brihat, Cordier], la photographie est affaire de prise de vue puis de tirage. Depuis Nicéphore Niépce, la tradition veut que les photographes réalisent eux-mêmes leurs épreuves, qui dans un espace spécialement dévolu, adapté pour l’occasion, qui dans leur salle de bains, qui dans leur cuisine. Pourtant, l’industrie invisibilise rapidement cette étape, principalement à l’initiative de Kodak et de son célèbre « You press the button, we do the rest ». Plus tard, les agences photographiques sous-traitent la production de tirages de presse quand, de leur côté, des auteurs photographes confient le tirage à des tiers. Parfois parce qu’ils considéraient que cette opération n’était pas si importante. Parfois parce qu’ils n’avaient pas le temps. Parfois parce que des tireurs avaient su gagner leur confiance.
Dans ce dernier cas, les photographes considèrent que les artisans d’exception sont les plus à même de rendre compte de leur démarche, de révéler mieux qu’ils ne le feraient eux-mêmes leur intention avec cette étape qui s’avère cruciale. Il en résulte souvent une certaine exclusivité : certains photographes ne jurent que par un seul tireur et ne feraient réaliser leur tirage auprès d’aucun autre. Les anciens Yvon Le Marlec, Claudine Sudre, Philippe Salaün ou Roland Dufau [pour la couleur], les actuels Guillaume Geneste, Thomas Consanti, Diamantino… sont autant de figures incontournables des cinquante dernières années pour qui le tirage fait partie intégrante de l’œuvre du photographe.
Parmi cette galerie de tireurs, un nom s’impose, Fresson. Et trois prénoms : Pierre, Michel et Jean-François. Une dynastie toujours active, en la personne de Jean-François Fresson qui œuvre à réaliser des épreuves selon le procédé familial, en couleurs le plus souvent, mis au point par Pierre et Michel Fresson.
Les Fresson sont eux-mêmes les héritiers d’une filière technique quasi révolue, celle des procédés pigmentaires. Gustav Suchow révèle en 1832 que la lumière agit sur les chromates ; en 1852, William Henry Fox Talbot [1800-1877] signale que la gélatine associée au bichromate de potassium devient insoluble après son exposition à la lumière ; dès 1855, Louis Alphonse Poitevin [1819-1882] exploite ces propriétés pour créer le procédé au charbon en incorporant du noir de carbone au bichromate de potassium. Ce procédé pigmentaire et ses déclinaisons [on peut remplacer le noir de carbone par d’autres pigments] ont l’avantage de mieux se conserver que les procédés argentiques et connaissent un essor commercial considérable à la fin du XIXe siècle. Ces procédés pigmentaires offrent aux photographes de multiples possibilités créatrices, différentes des procédés argentiques traditionnels. Nombre de photographes et de producteurs de papiers photographiques concourent au succès de ces différents procédés qui recueillent notamment les suffrages des photographes issus du courant pictorialiste au tournant du XXe siècle.
L’aventure Fresson débute dans ce contexte effervescent autour de ces techniques pigmentaires lorsque Théodore-Henri Fresson [1865-1951] met au point son propre procédé pigmentaire, qu’il présente à la Société Française de Photographie en 1899. Son procédé « charbon-satin » fait le succès de l’entreprise familiale jusqu’au déclin de la demande au milieu du XXe siècle. À partir de 1947, l’activité de vente de papier « charbon-satin » diminue et l’atelier réalise désormais des tirages pour les photographes, tels Laure Albin Guillot ou Lucien Lorelle. À partir de 1950, un des deux enfants de Théodore-Henri Fresson, Pierre [1904-1983], œuvre avec l’aide de son propre fils Michel [1936-2020] à adapter le procédé familial à la couleur. Lorsqu’ils s’installent à Savigny-sur-Orge en 1952, Pierre et Michel Fresson lancent leur activité de tirage en couleurs selon la technique de leur invention, le fameux procédé Fresson, avant d’être rejoints par Jean-François en 1978.
Obtenue après décomposition d’un original en couleurs à travers trois filtres [rouge, vert, bleu], puis exposition à la lumière pour les quatre couleurs successives [cyan, jaune, magenta et noir] avant un bain d’eau tiède et de sciure de bois légèrement abrasive, l’épreuve finale est le résultat d’une technique complexe parfaitement maîtrisée et d’un savoir-faire unique, au sein d’un atelier dont les conditions thermo-hygrométriques sont parfaitement connues par les opérateurs.
Produire un tirage Fresson est un processus complexe, qui fait autant appel à la technique [l’application des couches successives sur le papier est le fruit d’une machine spéciale fabriquée par les Fresson eux-mêmes en 1952 et toujours utilisée de nos jours] qu’à l’œil du tireur et à sa maîtrise de son environnement. Durant le processus, les accidents sont nombreux, notamment lorsque le papier trop lourd se déchire à la sortie d’un des bains, provoquant une tension de découragement soudain dans les épaules du tireur [ ! ] : tout est à recommencer. Deux à cinq jours de travail ne sont pas de trop pour obtenir ces photographies en couleurs reconnaissables entre toutes : douces, satinées, chaudes, sensuelles, légèrement floues, presque granuleuses malgré le papier lisse et souvent de formats réduits [le plus couramment 21 x 27 cm].
D’aucuns n’apprécient pas cette esthétique. Elle aurait l’art de transformer des prises de vues médiocres en « bonnes photographies » : l’atmosphère singulière induite du procédé ferait le charme du cliché. Mais cette assertion est vraie pour tous les tireurs, c’est d’ailleurs en cela que l’on reconnaît un tireur exceptionnel, capable d’extraire le meilleur d’un négatif. Le procédé Fresson serait également la dernière occurrence d’un courant artistique suranné, le pictorialisme, où la technique et l’esthétique entreraient en contradiction avec la pratique amateur et la photographie vernaculaire. D’autres, tels Bernard Plossu et ses amis ne jurent que par le procédé Fresson. Certes, les Fresson excellent à magnifier une « image », à ajouter du trouble au trouble, accentuer les qualités d’un cadrage « parfait », à ajouter [créer] du sens dans une photographie en apparence banale. Bernard Plossu a su identifier chez les Fresson le tour de main qui sait valoriser ses photographies. Loin d’être des tableaux, ses photographies d’éléments du réel le plus anecdotiques, toujours parfaitement cadrées, vont trouver plus de sens grâce au procédé Fresson, donner l’impression au regardeur qu’il sent ce qu’a senti le photographe au moment de la prise de vue. Les photographies de Bernard Plossu tirées par les Fresson deviennent des compositions impressionnistes où la couleur sourde invite à l’examen et l’introspection, le choix de petits formats renforçant cette immersion. Il est à croire que le procédé Fresson a été inventé pour Plossu, tant ses photographies entrent en résonance avec le procédé. Le nom de Plossu est indissociable du nom de son atelier de tirage, depuis 1967 que Plossu a découvert le procédé. Et Bernard Plossu est devenu le meilleur des agents pour le célèbre atelier de Savigny-sur-Orge. D’ailleurs, depuis le début 1970, Plossu documente la vie de l’atelier et s’y rend régulièrement pour photographier la dynastie au travail.
Si le procédé Fresson et les photographies de Plossu ont su se trouver et se magnifier l’un l’autre, Bernard Plossu n’est pas seul. Avec les années, il s’est entouré d’une « famille », où la marche, la déambulation, la photographie et le procédé Fresson sont les dénominateurs communs. Autour de Bernard Plossu, l’exposition rassemble quelques membres de cette vaste famille :Jean-Claude Couval, Douglas Keats, Philippe Laplace, Laure Vasconi et Daniel Zolinsky.
Jean-Claude Couval arpente les Vosges pour trouver les traces de la Première Guerre mondiale, tandis que Daniel Zolinsky sillonne l’Italie et le Mexique. Douglas Keats fait œuvre utile en répertoriant, à l’instar de la Mission héliographique, les églises ancestrales du Nouveau-Mexique, vestiges de l’évangélisation des autochtones par les colons portugais et espagnols du XVIe siècle, tout en jouant avec les particularités du procédé Fresson en déclinant à plusieurs heures d’intervalle selon le même point de vue l’église de Ranchos de Taos. Adepte du procédé charbon, Philippe Laplace propose des compositions pictorialistes des chemins et des sentiers qu’il traverse en France. Tandis que Laure Vasconi mène une déambulation singulière et solitaire dans d’anciens studios de cinéma aux États-Unis, en Inde ou en Italie, à la recherche de fantômes, le procédé Fresson ajoutant du mystère au mystère, la photographe créant de nouveaux paysages au sein de ces paysages fictifs.
Au cœur de l’exposition, comme un hommage aux différentes générations de Fresson et au procédé, deux séries en couleurs de Bernard Plossu, fruits de séjours américains du début des années 1980. L’une fut la dernière série tirée par Michel Fresson quand la seconde fut la première tirée par Jean-François Fresson. L’esprit Fresson est bien là mais les différences démontrent s’il en était encore besoin que le procédé ne fait pas tout : c’est bien l’œil et la main du tireur qui font la singularité du tirage.
Sylvain Besson
__
Commissariat :
Sylvain Besson, musée Nicéphore Niépce
Bernard Plossu
Scénographie, montage :
Michel Le Petit Didier
Nicolas Pleutret
Remerciements :
Jean-Claude Couval
Douglas Keats
Philippe Laplace
Laure Vasconi
Daniel Zolinsky
Anatole Desachy
Galerie Les Yeux Ouverts, Fontainebleau
La Société des Amis du musée Nicéphore Niépce




28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English

Sacha
17.02...19.05.2024
Inauguration vendredi 16 février à 18h

Même les dromadaires étaient sous le charme
(Miguel Medina, photographe)
Lorsqu’en 1966 le magazine Elle
publie un portrait de groupe de ses photographes devant l’objectif de Peter Knapp, il faut attendre la seconde photographie pour qu’un des personnages centraux tombant le chapeau se révèle ne pas être un photographe mais une photographe, la jeune Sacha van Dorssen. L’air de rien, en toute discrétion dans un métier où la production est abondante et mixte, Sacha fait partie du cercle restreint des photographes de mode passés à la postérité.
Avec une apparente simplicité, Sacha (née Sacha van Dorssen en 1940 à Rotterdam, Hollande) a su s’imposer comme une photographe de mode singulière, identifiable entre toutes, photographiant pour les magazines les plus prestigieux et répondant à de nombreuses commandes publicitaires (Yves Saint-Laurent, Louis Vuitton, Dim, …). Nul besoin de signature : sans pour autant d’ailleurs les identifier comme de son fait, nous avons de nombreuses photographies de Sacha « dans l’œil »,.
Elle
puis The Sunday Times Magazine
, Stern, Vogue UK, Avenue, Le Jardin des Modes, Lui, Vogue Homme,
Harper’s Bazaar Italia, GQ, Bloom
et surtout Marie Claire
(de 1977 à 1999, sans discontinuer ou presque Sacha va publier tous les mois dans le magazine et ses différentes variantes), autant de magazines qui vont faire confiance à la photographe néerlandaise qui s’est vue presque immédiatement confier, dès son arrivée en France en 1964, ses premiers reportages par Peter Knapp, alors directeur artistique de Elle
.
Composé de plusieurs centaines de milliers de diapositives, rangées dans leurs petites boites jaunes soigneusement classées par date, et de tous les justificatifs de publication, le fonds photographique de Sacha témoigne d’une activité uniquement tournée vers la photographie de mode. Cette exposition pourrait d’ailleurs être composée exclusivement de couvertures et de doubles pages de magazines tant il y en a eu. Les diapositives constituent une matière première illimitée dans laquelle Sacha puis les journaux ont puisé « les bonnes photographies » destinées à être imprimées. Car dans la mode, l’objet final et abouti reste le magazine, où les photographies sont mises en page et soigneusement légendées.
En effet, la photographie de mode n’existe que pour le magazine et qui mieux que Sacha pour incarner cette chaîne complexe de production d’images de mode. Lorsque l’on lit ou que l’on écoute Sacha, l’expression qui revient le plus souvent est celle de « travail d’équipe ». Lors de chaque séance s’activent des rédacteurs ainsi qu’un ou plusieurs assistants (logistique, éclairage, …), les mannequins, les coiffeurs, les maquilleurs… Avant que la photographe ne puisse s’exprimer, elle doit ronger son frein !
Plusieurs années durant, les assistants de Sacha ont soigneusement documenté les différents voyages pour les magazines en annotant les données techniques nécessaires au développement des films argentiques sur les polaroids de repérage. Sacha a ensuite rassemblé ces informations dans ses cahiers : lieu de prises de vue (pays, ville) et de résidence lorsque le séjour durait plus d’un jour, nom des différentes personnes présentes, celui de ou des mannequins, tickets d’hôtel ou de restaurant. Ce travail de référencement en temps réel est une source formidable pour comprendre le mode de production de ces photographies et son aspect résolument collectif.
On décrit souvent Sacha comme une photographe exigeante et … lente. Elle-même le reconnait : « j’admets qu’on dise que je suis très lente, mais quand mon mannequin arrive fin prêt, il me faut du temps pour que ce côté apprêté disparaisse et qu’il se produise quelque chose de vrai ou de naturel ; en fait, je suis comme la fermière bretonne qui vend ses dindes : si vous voulez de la qualité il faut mettre le temps. »
[1]
Cette exigence est tellement identifiable et porteuse que les magazines et les marques vont lui faire confiance durant près de 50 ans.
La qualité de ses cadrages (à de rares exceptions près, ses photographies sont impossibles à recadrer au grand regret des directeurs artistiques), le soin apporté aux détails, son sens de la couleur, sa maîtrise de la lumière et le naturel qui se dégage de ses clichés pourtant très construits, imposent Sacha auprès des magazines et des marques. Là encore, une fois les clichés pris, le travail est de nouveau collectif : rédacteurs, directeurs artistiques, rédacteurs en chef, … Sacha nous parle de joie partagée et il est vrai que le résultat final semble toujours joyeux et léger.
Sacha incarne une certaine idée de la femme, de l’homme et de la mode sur près d’un demi-siècle. Et même si elle a multiplié les collaborations avec des magazines partout dans le monde, elle reste associée à Marie Claire
et les déclinaisons en kiosque (Marie Claire bis
et Marie Claire beautés
). A l’instar de Elle, Vogue
ou Stern
, les magazines ont leur personnalité, leur ligne conductrice et Marie Claire
revendique depuis sa relance en 1954 par Jean Prouvost une identité forte. Héritier du Marie Claire
fondé en 1937 par Jean Prouvost et Marcelle Auclair, le nouveau Marie Claire
proclame « un magazine de luxe pour tout le monde », associant la mode (le prêt-à-porter comme la haute-couture) à des conseils pratiques, de cinéma, de tourisme, tout en proposant des articles de fonds sur des sujets de société.
En 1937, les couvertures de Marie Claire
proposaient des mannequins toujours souriants, à partir de 1954 les reportages photographiques proposent les mannequins qui semblent saisis dans leur quotidien. Au gré des rédactrices et des changements dans la société - que Marie Claire
accompagne -, cette identité visuelle perdure. Et c’est dans sa capacité à saisir « le vrai ou le naturel » tant recherchés par le magazine que Sacha va exceller, tandis que le magazine connait son apogée dans les années 1980, après qu’Evelyne Prouvost-Berry, secondée par Claude Brouet comme rédactrice en chef, a succédé à son grand-père en 1976.
Chez Sacha, les mannequins ne semblent jamais poser. Ils sont comme saisis dans leur intimité, une forme d’abandon faisant oublier la présence de la photographe. Et le paysage occupe une place essentielle. De façon subtile, Sacha sait combiner mannequins, modèles et décors en jouant avec la lumière extérieure, qu’elle préfère à celle du studio. Peter Knapp dit de Sacha qu’elle n’est pas dans le silhouettage de la forme, que ce qui se passe autour de la silhouette n’est pas en contraste avec le sujet, il en résulte des photographies douces, des ambiances où le vêtement ne semble pas être le principal sujet mais se lit pour autant comme essentiel à l’ambiance donc comme un élément désirable.
Sacha aime à photographier les à-côtés de ses voyages pour la mode et la publicité, posant son regard précis sur des détails inattendus mais toujours parfaitement composés. C’est dans cet esprit que Sacha est la photographe d’ouvrages dédiés à Mariano Fortuny
[2]
et Christian Dior
[3]
pour les Éditions du Regard, qui feront date. Premier livre publié par les Éditions du Regard, celui consacré à Fortuny témoigne la maestria de Sacha pour capter les ambiances (ici celle si singulière qui régnait dans le palazzo Fortuny laissé quasiment en l’état depuis 1965), mettant en avant des détails, écumant inlassablement le palais. José Alvarez dira : « pour Sacha, rien n’est insignifiant »
[4]
et pour ce faire Sacha s’adapte à la lumière particulière du lieu, elle qui préfère les extérieurs et le soleil. Pour Dior, le jeu est tout autre et ses compositions subtiles s’intègrent aux photographies d’archives qui composent l’ouvrage.
Mode, publicité, reportages, depuis 1964, Sacha a construit une œuvre singulière faite de lumière, d’exigence et de sincérité.
Sylvain Besson
__
Commissariat :
Sacha
Sylvain Besson, musée Nicéphore Niépce
Design Graphique :
Le Petit Didier
Nicolas Pleutret
Tirages :
Dupon Paris
Kleurenfelix Breda
Remerciements :
Gabriel Bauret
Françoise Bornstein
Peter Knapp
La société des Amis du musée Nicéphore Niépce
Dingeman Kuilman
Et les équipes du Stedelijk Museum Breda
Beja Tjeerdsma
Marieke Wiegel
Friso Wijnen
[1] Coups de cœur et déclenchements in Gabriel Bauret, Sacha
!, Éditions du Chêne, Paris, 2011
[2] Anne Marie Deschodt, Mario Fortuny : un magicien de Venise (1871-1949), Éditions du Regard, 1979
[3] Françoise Giroud, Dior
, Éditions du Regard, 1987
[4] Gabriel Bauret, Sacha
!, Éditions du Chêne, Paris, 2011









28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Baptiste Rabichon, Pièces
14 octobre 2023 ... 21 janvier 2024
inauguration : vendredi 13 octobre à 18h

Le travail de Baptiste Rabichon [né en 1987] est empreint de traces du présent, de vestiges des fantasmagories de l’enfance, autant que de références à l’histoire de l’art, au cinéma, ou aux jeux vidéo. L’artiste use des capacités de la photographie à rendre compte d’une expérience vécue, comme à s’extraire de la réalité. Il oscille en permanence entre prélèvement du réel et interprétation.
Baptiste Rabichon compose ses images à partir de matières premières constituées de prises de vues à la chambre photographique, comme au Smartphone...], de peintures, ou de dessins... Dans son atelier, au laboratoire, il expérimente et combine de multiples processus : prises de vues et tirages analogiques, projections à l’agrandisseur, photogrammes, photographies digitales, collages numériques, etc. Différentes temporalités se retrouvent ainsi entrecroisées sur le tirage, telles des strates de mémoire, des réminiscences sensorielles qui s’entrechoqueraient avec le moment présent. Le regard du spectateur se confronte à l’inversion des valeurs, au bouleversement des perspectives, au changement d’échelle, à la fascination de l’auteur pour l’infiniment grand.
Baptiste Rabichon crée des univers fictionnels qui nous parlent pourtant du monde dans lequel nous vivons. Il nous met face à notre rapport compulsif et obsessionnel à l’image. Selon ses propres termes, il s’agit d’« expériences contradictoires du monde, l’une remplie de durées, d’instants, de souvenirs et de projections, l’autre immédiate et primitive » qui se combineraient sous ses mains dans le noir du laboratoire.
L’exposition propose une découverte des derniers travaux de cet artiste prolifique.

XXe siècle, [2020-2021]
Depuis le paléolithique, avec les parois pour toile de fond, l’homme préhistorique a produit des signes : traits, points, formes abstraites, animaux, mais aussi contours et silhouettes humaines dans un corps à corps avec la roche. Baptiste Rabichon avec la série XXe siècle nous met face cette obsession de l’humain pour les images. Grâce à la photographie, mais sans l’intermédiaire d’un appareil, l’artiste produit à son tour une multitude de traces, notamment celle de son propre passage. Il applique tout d’abord de la peinture sur une plaque de verre. Cette matière première, soufflée, étalée à même la main, est ensuite projetée à l’agrandisseur sur le papier photographique. Baptiste Rabichon s’enfonce alors dans l’obscurité du laboratoire et tout va se jouer par son geste dans le noir. Il mêle à ces premières traces de nouvelles empreintes sur la surface sensible : photogramme de son propre corps projeté, chimigramme de son bras, etc. Différentes temporalités s’entrecroisent sur le tirage telles des strates de mémoire, et Baptiste Rabichon, tel un inventeur de grottes, diffuse ces nouvelles « images-parois ».

Manhattan Papers [2021]
En imprimant des dizaines de photographies de New York en couleurs négatives, assemblées ensuite en petites maquettes, puis re-photographiées en studio sur film positif couleur, avant d’être tirées sur papier négatif couleur ; Baptiste Rabichon obtient des images étranges, où positif et négatif s’entremêlent. D’étranges scènes où le décor [maquettes en papier] semble plus « réaliste » que ce qui l’habite [objets, modèle vivant…]. C’est à travers le prisme de cette friction où image et réalité paraissent se confondre qu’il s’attelle à construire de nouvelles images possibles de New York, ville du XXe siècle par excellence. S’y côtoient aussi bien l’image qu’il s’en est fait par le cinéma, la photographie, la littérature, la musique [mises en scène faisant référence plus ou moins explicitement à des films comme King Kong et Metropolis ou au travail de Berenice Abbott par exemple] que ce qu’il en a réellement rapporté [les décors sont intégralement construits avec des photographies prises sur place lors des séjours que Baptiste Rabichon a pu faire à Manhattan]. Ou comment, à travers cette nouvelle technique photographique [qu’il a mise au point pour pallier la disparition du célèbre papier Cibachrome], tenter, dans une histoire aussi vaste que celle de la photographie new-yorkaise, d’inscrire un nouveau travail sur cette ville si fantasmée, à la fois réelle et image d’elle-même.

Lost Levels [2020-2021]
Bien avant que des personnages en 3D n’interagissent dans des univers virtuels aux décors et paysages photo-réalistes, le jeu vidéo était fait de pixels. Avec Lost Levels , Baptiste Rabichon fait ressurgir ce passé. Il replonge dans les jeux de son enfance, prélève des fragments d’images de l’ère des consoles en 8 et en 16 bits, puis recompose des tableaux : de nouveaux mondes. Dans cet étrange terrain de jeu, fait de collages numériques, on suit le scénario, on passe les niveaux. Cette mission demande beaucoup d’observation. Il faut s’attarder sur une multitude de détails pour découvrir un nouveau système solaire, passer un labyrinthe sous-marin, explorer les différents étages d’une maison qui peut nous rendre fou. Alors parmi le lit à baldaquin, le poulpe, La Grande Odalisque, l’armure de samouraï, la cabine téléphonique, saurez-vous trouver la porte d’entrée pour la Warp Zone , cette zone de distorsion qui vous permettra de vous téléporter entre les niveaux ? Et si vos doigts ne vous font pas encore trop mal de marteler les boutons de la manette, vous arrivez peut-être jusqu’à cette ville tentaculaire inhabitée… ou pas tout à fait. Car ces mondes ludiques sont tous habités d’un petit personnage que vous pourrez rencontrer sur votre chemin. Il s’agit de l’artiste [parfois accompagné] qui s’est mis en scène et incrusté dans les images. « J’ai commencé cette série pendant le premier confinement, enfermé dans 15 m2. J’étais angoissé par cette pandémie et j’ai passé mes journées sur l’ordinateur, complètement perdu dans la virtualité. En fin de compte, tu te dis que le monde n’est qu’information et que tu n’es toi-même qu’un petit morceau de code dans une grande bouillie de données. » You Win! Direction le paradis du pixel! Game Over


Vues d’artiste [2022]
À l’heure où le télescope James Webb nous fait parvenir des images d’étoiles dans une définition inédite, Baptiste Rabichon nous propose sa propre vision du Cosmos. En hommage aux illustrations d’objets, d’êtres ou de phénomènes dont on ne dispose pas de représentations photographiques et qui accompagnent souvent les articles de vulgarisation scientifique, il nomme ce travail Vues d’artiste . L’artiste nous propulse dans un univers fantasmé, peuplé d’astres et de paysages insolites, résultant d’une étrange alchimie entre le dessin et processus photographique. Sur de petites feuilles de calque, Baptiste Rabichon dessine des sphères, des points, des taches… Ces esquisses transparentes il les dispose ensuite, dans l’obscurité totale, sur du papier photosensible avant d’enclencher la lumière ; Fiat lux – Que la lumière soit . Et la lumière, traversant le calque, crée la nuit. Un authentique noir photographique qui vient englober le dessin, transformant ainsi chaque sphère, point, tache, en autant de planètes, d’étoiles et de galaxies. Par la rencontre du dessin et du photogramme, naissent ces petits univers, que Baptiste Rabichon fabrique autant qu’il les regarde apparaître, se rappelant sans cesse qu’image est l’anagramme de magie.

Blue Screen of Death [2021-2022]
L’écran bleu de la mort est le surnom donné à l’affichage d’arrêt d’urgence émis par Windows. Erreur fatale : l’écran devient alors intégralement bleu. Ce sobriquet donné depuis les années 1980 au plantage d’un ordinateur, semble une étrange prémonition de l’envahissement des écrans dans nos vies, et notamment aujourd’hui de l’omniprésence des smartphones. Dans les mains ou à l’oreille de la majorité des gens que nous croisons, sur les tables des restaurants, accrochés aux pare-brises des voitures, en reproductions géantes sur les façades des monuments, sur le plan de travail pendant la préparation du dîner et souvent, jusque dans notre lit ; il est impossible d’échapper à ces petits rectangles noirs… Qui n’a pas déjà, dans les transports en commun, ressenti une vague angoisse devant le spectacle de tout un wagon silencieux et hypnotisé par la lueur bleutée de son terminal ? Dans Blue Screen of Death l’outil critiqué est le producteur direct de l’oeuvre. Baptiste Rabichon réalise des photogrammes à double exposition, celle de l’agrandisseur imprimant l’ombre des objets cachant sa lumière et celle du téléphone s’exposant lui-même par contact direct. Dans un répertoire d’objets du quotidien en tous genres, vient s’inviter un étrange intrus : un smartphone déversant le contenu de son écran sur le papier photosensible. Notification des derniers chiffres du COVID, vidéo d’un chaton jouant de la flûte, Candy Crush, Tinder, selfie, chaque oeuvre est parasitée, contaminée, par le flux de l’écran, comme l’est déjà chaque instant de notre vie.

Verbatim [2023]
Baptiste Rabichon affectionne les rencontres incongrues entre analogique et digital. Dans Verbatim , il nous en livre l’une des plus simples, mais aussi l’une des plus troublantes. Consistant, à première vue, en de banales photographies réalisées au smartphone, les oeuvres laissent apercevoir, quand on s’en approche, des milliers de petits points colorés. Cette trame, qui rappelle l’impression offset ou la sérigraphie, n’est autre que le réseau de diodes composant l’écran du smartphone producteur de l’oeuvre en question. Mais une observation encore plus fine permet de déceler des irrégularités. C’est que l’artiste, sans se soucier des traces de doigts, poussières ou autres saletés, place directement son téléphone allumé dans un agrandisseur photographique devant lequel il dispose une feuille de papier photosensible. La lumière de l’écran traverse l’optique et insole directement le papier photosensible de l’image qu’il diffuse. Verbatim est réalisée dans l’urgence. Cette rencontre entre deux ères photographiques ne sera bientôt plus possible en raison de l’inéluctable disparition de la photographie analogique couleur. Mais renversant l’habituelle nostalgie associée à l’argentique, l’artiste nous propose au contraire une réflexion sur la fragilité de nos vignettes digitales. La photographie numérique est un texte décodé puis transcrit en image par les logiciels de nos ordinateurs et téléphones portables — le titre de la série Verbatim fait d’ailleurs écho à cette retranscription. Que restera-t-il dans quelques décennies des milliards d’images prises quotidiennement durant les premières années du XXIe siècle ? Toutes ces photographies fugaces, vues d’atelier, selfies, portraits de sa compagne, notes visuelles, Baptiste Rabichon par sa technique d’agrandissement argentique, les transforme en tableaux. Quelque chose de classique s’en dégage.


Mother’s Rooms [2022]
Avec l’arrivée de l’automatisation de la photographie et encore plus avec l’avènement du numérique, nous avons oublié que la photographie était affaire d’inversion. À l’origine, l’image qui se forme dans la chambre noire est transposée géométriquement : la gauche est à droite, et le haut est en bas. C’est par ce glissement spatial que Baptiste Rabichon cherche dans son travail à brouiller le rapport entre espace réel et espace imaginaire. Lors de ses rêveries d’enfant, l’artiste allongé son lit, la tête à l’envers, les yeux fixés au plafond, renverse son regard. En contrariant les contraires, une dimension alternative se développe en miroir du monde de départ, en dehors de l’espace et du temps. Se remémorant ces instants oniriques avec sa mère, il décide de revenir aux origines de la photographie, au point de vue, et d’utiliser la chambre photographique. Perché sur un escabeau, il place son appareil au ras du plafond, enregistre des lieux très intimes, familiaux. Gardant l’inversion de l’image d’origine, les luminaires sont ancrés au sol, les ampoules flottent tels des ballons de baudruche. Tous les éléments constitutifs de ces espaces viennent braver les codes de ce que l’on connaît. L’observation de ces images nous place à l’intersection de la mémoire et de l’imagination et nous rappelle que « toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants ».

Pièces [2023]
Pièces est un ensemble au sein duquel chaque oeuvre est différente de l’autre, mais forme un tout. Tel un mathématicien créateur de figures impossibles, Baptiste Rabichon poursuit ses recherches autour de la notion d’espaces complexes, fictifs, ou artificiels dans lesquels un personnage cherche son chemin. Il nous en livre ici le premier extrait, une œuvre au titre éponyme de l’exposition, qui prend pour thème les Échecs. Juxtaposant de multiples vues, créations graphiques par ordinateur et photogrammes, l’artiste suscite notre étonnement et offre à notre perception toute la symbolique de ce jeu. Noir / Blanc, Couleur / Monochrome, Positif / Négatif, Argentique / Numérique, Petit / Grand, Masculin / Féminin : autant de dualités, de couples d’opposés complémentaires et indissociables, qui sous-tendent l’unité. Le compte-rendu précis et réel d’une partie du « plus noble des jeux » ne serait-il pas alors, comme dans les romans de chevalerie, une métaphore de l’amour ?

Commissariat de l’exposition :
Emmanuelle Vieillard,
musée Nicéphore Niépce
Scénographie, montage :
équipe du musée Nicéphore Niépce
Le musée remercie
les prêteurs sans qui l’exposition
n’aurait pu avoir lieu :
Galerie Reuter Bausch — Luxembourg,
Galerie Binome — Paris,
Galerie Paris B — Paris,
Villa Vauban, musée d’Art
de la Ville de Luxembourg,
Collection privée

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Stéphane Lagoutte, Liban, stratigraphie
14 octobre 2023 ... 14 janvier 2024
inauguration : vendredi 13 octobre à 18h

Stéphane Lagoutte est photographe membre de l’agence MYOP depuis 2009 et directeur de la structure depuis 2016. En parallèle des commandes de presse liées à l’actualité, il produit un travail documentaire multiforme et questionne le support, la matière photographique.
Le musée présente dans cette exposition un travail au long cours réalisé par le photographe à Beyrouth pendant plus de dix ans.
En cinq séries, « Beyrouth 75-15 », « Observation », « Révoltes », « Voir », et « Survivance », le photographe nous parle d’un temps non linéaire. Il étudie, tel un géologue, la succession des strates qui constituent l’histoire contemporaine du Liban depuis 1975.
Les couches se succèdent, se diffusent, semblent former un cycle empêchant toute transition, mais les faits ne se répètent jamais tout à fait à l’identique. Entre mémoire et actualité, le photographe emprunte de nouvelles voies.
« Formellement ces nombreuses années de voyage m’ont permis de repenser ma photographie et donné le temps d’imaginer des formes diverses. Il s’agit toujours de documenter mais, que cela concerne des événements directs ou leurs répercussions profondes – sous forme de traces – le propos imposait différentes écritures sensibles qui se répondent et se complètent.
»
Surimpressions, agrandissements, projections, détails, sont autant de formes d’écritures photographiques qui permettent au photographe de débusquer les signes et de rendre compte de la situation complexe de ce pays.

Beyrouth 75-15
2015
Le photographe tombe amoureux d'une femme qui l'emmène à Beyrouth, Liban. Il est sidéré par la ville, confluent de l'actuel, du passé, de l’histoire, l’archaïque. Il sort son appareil. Il fait son travail. Il s'enfonce, se faufile et se glisse dans les interstices.
Rues entremêlées, figures à leurs fenêtres, bâtiments criblés de souvenirs douloureux. Par amour le photographe s'égare. Hôtel de luxe abandonné, escaliers incertains et en bas, dans le caché de la ville, une discothèque assoupie sous un linceul de poussière. Là, à côté de concrétions indéfinissables, il bute sur les films négatifs d'un autre photographe, mort peut-être, les images d'un fantôme en somme.
Trois années durant, le photographe retourne et arpente les rues libanaises. Les images s'accumulent mais ne suffisent pas. L’appareil reste stérile, ça ne va pas.
De retour à Paris, il exhume, avec précaution, un à un, les vieux négatifs oubliés. Brutalement une autre vie apparaît. Des hommes et des femmes dansent, boivent de l'alcool et discutent, rient, s'aiment. Ils n'ont pas encore peur. C'est la vie d'avant 1975. Avant cette guerre civile dont personne ne sortira indemne.
Alors comme un couple qui se retrouve après des années de séparation, les images d'aujourd'hui se couchent sur celles d'hier. Beyrouth 1975 - 2015. Superposition temporelle, deux solitudes se rencontrent et s'étreignent. Ainsi, le photographe, Stéphane Lagoutte, puisque c'est de lui qu'il s'agit, parvient à tisser un présent augmenté et mouvant.
Ses images ne témoignent pas, elles agissent. Elles n'arrêtent pas le temps, elles le déploient.
Samuel Doux.

Observation
2011 – 2014
Photographier les rues de Beyrouth éveille la suspicion, la défiance. Même dans les rues sans lieu sensible, sans histoire, le photographe aperçoit les regards se poser sur lui. Il se sent regardé, considéré comme danger potentiel, un individu dont on ne définit pas très bien les intentions. Observé par des anonymes à leur fenêtre, sur leur balcon, il décale son regard et, à son tour, les observe. Il consigne alors par la photographie ces instants suspendus dans la ville.
De retour à son atelier, Stéphane Lagoutte décide de redonner leur place à ces individus. Pour les inscrire dans l’Histoire de manière à la fois poétique et politique, il les dessine, un à un, minutieusement, à l’encre de chine. Chaque personnage prend alors une autre dimension, une taille monumentale à l’instar de la peinture historique. Ces anonymes deviennent les hérauts annonciateurs des actes d’une tragédie qui, inexorablement, égrène l'histoire du Liban.

Révoltes
Photographies : Stéphane Lagoute, 2019 – 2020
Montage : Oan Kim, 2023
Son : Liban pendant les manifestations de 2019 – 2020
4 minutes
Les manifestations débutent le 17 octobre 2019 dans la soirée. Une taxe « WhatsApp » est le déclencheur d’un mouvement de protestation de la population, réclamant un changement politique et structurel. Stéphane Lagoutte est sur place et suit les événements jusqu’à la démission du gouvernement. Des photographies de ces premières semaines de mobilisation collective, se dégagent un fort sentiment d’unité contre les classes dirigeantes et une protestation pacifique.
Le photographe retourne sur place en février 2020. Les banques ont cessé d’autoriser leurs clients à accéder à leurs comptes, le taux de chômage et la pauvreté augmentent, le Liban fait face à une période de troubles. Les rues et les places occupées ne portent plus la même ferveur, mais la population continue le combat ; un combat que Stéphane Lagoutte tente de retranscrire par l’image. « Il était 8h du matin, les manifestants tentaient de bloquer l’accès au parlement, sous les lances à eau et les lacrymogènes
. J'ai eu l'étrange sentiment que le peuple libanais était déjà au boulot. Comme un devoir. Celui de résister, d'exprimer une colère, un refus. C'était avant la problématique de la pandémie, c'était avant l'explosion au port qui confirme la justesse de leur combat. Un combat qui se heurte violemment aux intérêts des dirigeants, mené par un peuple qui n'a plus les moyens de vivre résigné
. »

Voir
2020
Le 4 août 2020, la ville de Beyrouth est soufflée par une double explosion sur le port qui meurtri les libanais dans leur chair et ébranle leurs espoirs. Les jours suivants, un flot continu de voitures défile sur l'autoroute face au lieu du drame. Les habitants veulent constater par eux-mêmes : voir pour le croire, pour réaliser l’impensable et ainsi le rendre réel.
Stéphane Lagoutte, sur place comme beaucoup d’autres photographes de presse, détourne son objectif de l’événement. Il tourne le dos au port pour capter les regards ; ce premier regard sur la scène qui révèle à lui seul l’ampleur de la catastrophe et la profondeur de l’impact sur les vivants.

Survivance
2020
Dix jours après l'explosion, Stéphane Lagoutte récolte des témoignages, consigne les stigmates, sonde les âmes. « Les habitants des quartiers dévastés me parlent, comme une catharsis et je les photographie dans leur élan, leur stupeur. […] Les façades des maisons sont au sol, les immeubles sont désertés. Pas de manifestations aujourd'hui. On me dit qu'il y a trop à faire. »

Commissariat :
Céline Duval, Stimultania,
Emmanuelle Vieillard, musée Nicéphore Niépce
Scénographie, montage :
équipe du musée Nicéphore Niépce
Design graphique :
Le Petit Didier, Nicolas Pleutret
Exposition co-produite avec Stimultania, pôle de photographie à Strasbourg et Le CRI des Lumières à Luneville
Avec le mécénat de Canson

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Kate Barry
My Own Space
17 juin .... 17 septembre 2023
inauguration : mercredi 14 juin à 18h30
Téléchargez le dossier presse ici

Kate Barry [1967-2013] débute sa carrière de photographe en 1996. Les commandes pour la mode et les magazines font sa renommée et son œuvre participe de la construction de l’imaginaire d’une époque [campagne mère-fille pour Comptoir des Cotonniers en 2003-2006, portraits d’actrices lors de la sortie du film Huit Femmes
de François Ozon en 2002, etc.].
Malgré les contraintes des commandes, la photographe impose son regard, ce qui l’autorise à développer des projets plus personnels. Celui consacré aux salariés du marché international de Rungis [Les Gueules de Rungis
, 2009] fera date, mais son œuvre autour du paysage est celle où elle exprime le mieux sa sensibilité. À l’opposé du clinquant des magazines, des impératifs des commandes et de la surmédiatisation de sa famille [elle est la fille de John Barry et de Jane Birkin], Kate Barry y propose des atmosphères dépouillées, faites de poésie et de subtilité, à la fois mélancoliques et oppressantes. En 2021, la famille de Kate Barry a donné au musée Nicéphore Niépce l’intégralité de ses négatifs couleur et noir et blanc, sa production numérique, ses planchescontacts, une sélection de tirages ainsi que ses deux principales expositions [Bunkamara Gallery, Japon, 2000 et Arles, 2017].
Le musée propose au public de découvrir une première rétrospective de cette œuvre singulière, diverse et complexe.
Le livre " Kate Barry, My Own Space" aux Editions de la Martinière est en vente à la boutique-librairie du musée.

![Laetitia Casta [pour Elle] 2 octobre 2000 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Kate Barry Laetitia Casta [pour Elle] 2 octobre 2000 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Kate Barry](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/kate-barry/kate-barry3/60855-1-fre-FR/kate-barry_smartphone.jpg)
Lâcher prise
[ extraits ]
Principalement connue pour ses portraits de figures issues des mondes de la musique, du cinéma et de la mode qu’elle photographie dans le cadre de commandes pour la presse, Kate Barry s’affirme comme une photographe complète, qu’on ne peut circonscrire à cette seule pratique. Surtout, Kate Barry évolue au sein d’un environnement familial où l’image [et en particulier la photographie] est omniprésente.
Si la photographie est partout, elle l’est particulièrement autour de Kate Barry. Fille de Jane Birkin et de John Barry, la vie de famille de Kate Barry est largement médiatisée. Le couple Jane Birkin / Serge Gainsbourg fait longtemps la une de nombreux journaux. Le duo défraie souvent la chronique, voit sa vie scrutée et ouvre régulièrement la porte de sa demeure aux caméras de télévision ainsi qu’aux photographes.
Autour de Kate Barry, la photographie est également omniprésente dans l’intimité. Son oncle, Andrew Birkin, photographe, accompagne souvent la famille dans ses pérégrinations et emmène par exemple Kate Barry alors âgée de 4 ans dans ses repérages destinés à Stanley Kubrick ; il la photographie sur le trône de Napoléon à Fontainebleau, portrait à la fois anecdotique et marquant. Le monde de l’image est prégnant : Jane Birkin actrice et chanteuse bientôt réalisatrice a pour amie la photographe Gabrielle Crawford, elle aura comme compagnon le réalisateur Jacques Doillon, les soeurs de Kate Barry deviendront très jeunes actrices et modèles, etc.
À l’adolescence, Kate Barry semble trouver sa voie dans le stylisme en intégrant en 1983 l’école de la Chambre syndicale de la couture à Paris. Alors que ses créations font l’objet de premiers défilés dès 1985, son parcours est perturbé par plusieurs dépendances. Son séjour, au début des années 1990, dans un centre londonien adepte de la méthode dite « Minnesota » la convainc de fonder un tel centre en France. Initiée en 1991, l’association APTE [Aide et Prévention des Toxicodépendances par l’Entraide] accueille ses premiers patients à partir de 1994. Peu après, Kate Barry abandonne le stylisme pour la photographie. « La photo n’a pas été une évidence. Loin de là. C’est un amoureux quand j’avais 16 ans qui m’a donné mon premier appareil photo. Et c’est encore un amoureux qui m’a donné un appareil photo bien plus tard, à 28 ans. C’était un plaisir que je ne voyais pas. Je me suis fait plaisir plus tard, quand cette notion a pris de l’importance, quand il a fallu construire à nouveau. J’ai pu créer mon espace, un espace à moi. »
Les débuts sont balbutiants mais déjà empreints de la personnalité de la photographe en devenir. À l’instar de nombreux photographes autodidactes, les proches constituent des modèles de choix. Elle s’approprie l’appareil, apprend à jouer avec la lumière et déjà transparaissent des ambiances mélancoliques, des atmosphères pesantes, des compositions où les vides volontaires concourent à dramatiser les scènes, tandis que sa famille se prête au jeu.
Rapidement, les premières commandes se présentent et Kate Barry multiplie les séances de prises de vue : reportage pour Elle
en octobre 1996 [20 pellicules], commandes de Lui en novembre 1996 [21 pellicules], du Figaro
Madame
[30 pellicules] et de l’agence Sygma [23 pellicules] en décembre 1996. Le rythme est toujours aussi soutenu dans les premiers mois de l’année suivante avec des portraits d’Alexandra Kazan, Françoise Hardy, Sabine Azéma, Maïwenn, et ce pour le seul 1er trimestre 1997. Les magazines, ceux de mode en particulier, sont encore à l’apogée de leur diffusion et la profusion des titres offrent à Kate Barry de nombreuses opportunités. Elle
, Vogue
, Cosmopolitan
, Jalouse
, L’Officiel
, Gala
, Off Femme
, DS
puis plus tard H&K
, Glory
, Madame
Figaro
, Elle Japon
, Joyce
, Vanity Fair
, etc. : cette liste non exhaustive de titres traduit la grande variété de magazines qui s’adressent à elle, la diversité stylistique portée par chacun d’entre eux et à laquelle la photographe s’efforce de répondre.
Jusqu’alors environnée de photographies et de producteurs d’images de toutes sortes, elle-même modèle pour ses propres créations de mode, Kate Barry s’installe rapidement à partir de 1996 comme une photographe qui compte : son accès privilégié à certaines personnalités, ainsi que l’univers visuel singulier qu’elle sait créer et qui lui est propre, achèvent de convaincre nombre de commanditaires et de modèles à faire appel à elle. Son implication au monde aussi. Ses engagements sont nombreux : une affiche pour Ni Putes Ni Soumises en 2003, la couverture pour le 1er numéro de Rose
, magazine dédié aux femmes atteintes d’un cancer [automne 2011], une série de portraits engagés de personnalités dans le cadre de la Vague blanche pour la Syrie en 2012 [où elle photographie Sandrine Bonnaire, Sonia Rykiel et Sophie Marceau dans le cadre d’un projet photographique et politique initié par Sarah Moon]. Par ailleurs, Kate Barry n’hésite pas à brouiller son image de photographe de mode et de personnalités du show-business et du cinéma : même s’il s’agit au départ d’une commande, elle s’investit particulièrement dans une série de portraits réalisés à Rungis dans le cadre des 40 ans du célèbre marché [2009].
À partir de 2002 et jusqu’à, au moins, 2008, Kate Barry s’essaie à un genre nouveau pour elle, le paysage, et c’est là que toute sa sensibilité va s’exprimer. Seule face à la nature, elle saisit des détails, sans forcément y réfléchir, se met en œuvre, comme le suggère Marie Darrieussecq, « une flânerie active, une flânerie déterminée [si une telle chose peut exister] ». En contrepoint de sa pratique du portrait, Kate Barry évoque la nécessité de s’essayer à une autre forme de photographie : « C’est pourquoi j’ai fait des photos de lieux. Pour perdre mes repères, perdre ce regard croisé, ce regard reconnaissant. » Dans ses paysages, réalisés au gré de ses voyages en Israël, en Jordanie, en Normandie [Le Havre notamment], en Bretagne [à Dinard avec Jean Rolin], Kate Barry construit une œuvre délicate, fragile, suscitant l’introspection. Ses proches évoquent ses paysages comme étant son « vrai » travail photographique, le plus proche de sa personnalité, celui où ses inquiétudes et ses silences s’expriment le mieux.
Alors que Jean Rolin nous narre que « Kate avait pris cette habitude de filmer, à l’aide d’un appareil photo miniature et d’une manière un peu compulsive, non pas même tout ce qui se passait autour d’elle, mais plutôt ce qui se déroulait à ses pieds » et que très rarement elle relevait la caméra pour filmer le décor, les paysages de Kate Barry surprennent justement par leurs cadrages et leur atmosphère. Jamais elle ne semble lever la tête : la ligne d’horizon est haute, part belle est donnée aux sols et à leur altérité. Ses paysages proposent des sujets peu communs[cimetières, murs défraîchis, détritus abandonnés dans un sous-bois, etc.], des ambiances mélancoliques [là une plante qui s’extrait du bitume tant bien que mal, ici une route de campagne mal entretenue sous un ciel qui semble plombé], des corps anonymes comme perdus dans des décors urbains où la nature reprend ses droits, etc. En ce sens, les photographies avec Jean Rolin pour l’ouvrage Dinard, Essai d’autobiographie
Immobilière
font œuvre de manifeste de sa pratique du paysage, succession de « lieux indécis » dont ils partagent tous deux le goût.
Quand sa carrière est brutalement stoppée en décembre 2013, Kate Barry envisageait des projets de documentaires, ceux inaboutis autour des auteures Flannery O’Connor ou Mary McCarthy ou celui consacré à Philippe Djian. Actrice des changements provoqués par l’émergence des technologies numériques suscitant une porosité accrue entre images fixes et images animées, Kate Barry poursuivait là une démarche représentative d’une photographe de son temps : enfant puis adolescente au cœur des années 1970-1980 quand la médiatisation à outrance de certaines figures célèbres s’accentue, jeune femme assiégée par un monde d’images dans son propre quotidien, elle-même productrice d’images photographiques en amateure avant d’exercer comme professionnelle, photographe de commande puis auteure à part entière exposant et vivant de sa photographie.
L’étude du fonds Kate Barry nous montre les différents possibles de notre rapport à la photographie. L’auteure y déploie sa personnalité et son espace à elle, d’abord cernée par les images des autres avant de devenir elle-même productrice d’icônes.
Sylvain Besson

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Bertrand Meunier,
Erased
17 juin ... 17 septembre 2023
inauguration : mercredi 14 juin 2023 à 18h30
Commissariat de l’exposition : Sylvain Besson, Bertrand Meunier
Exposition co-produite avec le musée de la Photographie de Charleroi.
Avec le soutien de Picto Foundation.
Le musée remercie : Les Amis du musée Nicéphore Niépce, Canson
Un livre accompagne l’exposition : Bertrand Meunier, Erased,
texte, Pierre Haski, Atelier EXB, Paris, 2023
Présentation de l’exposition à la presse :
vendredi 16 juin, 18 h, en présence de Bertrand Meunier, Pierre Haski, Sylvain Besson et des partenaires.
Visite commentée de l’exposition par Bertrand Meunier et Pierre Haski :
samedi 17 juin, 14 h 30
Réservation conseillée : 03 85 48 41 98
[gratuite]

Téléchargez le dossier presse ici

Membre du collectif Tendance Floue, prix Niépce en 2007, Bertrand Meunier est le parfait représentant de cette photographie documentaire française au regard décalé, au style cinématographique, attachée à la photographie argentique, pour qui le médium est un outil de compréhension du monde avant d’être une technique d’enregistrement. Depuis ses débuts à l’agence VU’ et les commandes de Newsweek
et Libération
, le photographe a affiné son approche. Son exigence et sa rigueur offrent au regardeur une vision du monde sans fioritures, qui invite au questionnement et à la réflexion.
Bertrand Meunier a confié son fonds photographique au musée en 2021 et a invité l’institution chalonnaise à revisiter avec lui ses archives.
L’exposition Erased
propose
en quelque 80 tirages argentiques,
des vidéos, des installations,
des coupures de presse, un regard
renouvelé sur le travail au long
cours, mené par le photographe
en Chine de 1999 à 2019.
Bertrand Meunier a, par
des séjours réguliers, su saisir
les transformations de la Chine
durant les vingt dernières années,
de l’intégration de cette dernière
à l’Organisation Mondiale
du Commerce [2001] aux
manifestations à Hong-Kong
de 2019-2020, avant que l’épidémie
de COVID ne ferme le pays
aux étrangers.
Un texte du journaliste Pierre Haski
[correspondant pour Libération
en Chine durant six ans pendant
les années 1990], accompagnera
un livre dédié au travail
« chinois » de Bertrand Meunier
[aux éditions EXB] et servira
de fil conducteur à la scénographie
de l’exposition.

La photographie est faite d’exactitude, de fidélité dans la reproduction du réel. Le photojournaliste capte le monde pour montrer, pour dénoncer et pour rendre compte. Membre du collectif Tendance Floue, Bertrand Meunier est en apparence dans cette logique. Pourtant, sa photographie est le contraire du [photo-] reportage. Même si ses clichés furent, un temps, publiés dans les magazines et les journaux [Newsweek ou Libération principalement] et qu’il fut diffusé par l’agence VU’ au début des années 2000, ils ne répondent à aucune des injonctions de la presse. Bertrand Meunier est un photographe du temps long, du noir et blanc, qui se refuse aux images « faciles ». Pour chacun des pays qu’il choisit de photographier, ce sont des séjours répétés, répartis sur plusieurs années, durant lesquels il va tourner obstinément autour de ses sujets, où sa subjectivité et son ressenti occupent toute la place.
Erased
est le grand œuvre de Bertrand Meunier. Depuis 1997 qu’il se rend en Chine, il a photographié la disparition progressive du monde paysan au bénéfice de l’industrie puis le remplacement progressif de cette dernière par l’économie tertiaire et les nouvelles technologies. Avec Erased
, il nous montre les profondes transformations de la Chine de ces trente dernières années, sous l’impulsion du Parti communiste et les directions successives de Jiang Zemin [1989-2002], Hu Jintao [2002-2012] et Xi Jinping [depuis 2012]. Erased
accompagne les mutations de la société chinoise, les ouvertures et fermetures successives au capitalisme, le contrôle de la population de plus en plus marqué, les conséquences sociales et humaines des décisions du Parti qui autorisent la Chine d’aujourd’hui à se considérer l’égal des États-Unis aux niveaux économiques, diplomatiques et militaires, à l’instar de l’U.R.S.S. d’autrefois.
Le monde est complexe et Bertrand Meunier s’efforce d’en rendre compte. La Chine nous semble lointaine. Mais chaque jour, l’Occident consomme chinois, nos dirigeants composent avec le régime, les grandes réformes successives menées par le Parti contribuent à [re]placer la Chine au cœur des enjeux géopolitiques les plus cruciaux de notre temps. Erased
est, en ce sens, essentiel pour appréhender le monde d’aujourd’hui. À défaut de nous donner des clés pour comprendre la Chine, cet œuvre au long court nous expose, sans concession, la résilience d’un peuple aux injonctions d’un parti dirigeant tout puissant Bertrand Meunier nous invite à nous projeter dans ses photographies pour que nous fassions corps avec les protagonistes, pour que les cultures asiatiques, et la culture chinoise en particulier, nous concernent et nous interpellent.
Les photographies de Bertrand Meunier ne sont pas spectaculaires : aucun évènement historique, aucun tremblement de terre, aucune manifestation, ou alors, par accident ou [presque] par hasard. Bertrand Meunier ne recherche pas le scoop mais se positionne au niveau de la rue, s’approche au plus près des personnes et tente de capter les effets de la corruption et des décisions centrales mal appliquées ou biaisées à mesure que l’on s’éloigne des centres de pouvoir. En noir et en niveau de gris, il photographie le quotidien de la Chine. Peu importe la succession de dirigeants, des changements brutaux que ces derniers imposent à la population, l’être humain s’adapte, vit, survit, ploie, contourne, détourne. En ce sens, ces clichés sont universels et, dans une société toujours plus corsetée, la résilience se révèle. La crainte aussi, parfois. Meunier nous fait « rentrer » dans une société qui pourrait être la nôtre [ou l’est déjà, ou est en passe de le devenir] : modifications des paysages et déplacement de population [le barrage des Trois-Gorges à partir de 2003], corruption et scandales [celui du sang du Henan, années 1990], surveillance accrue des populations, répression des contestations [Révolution des parapluies à Hong Kong, 2014], etc. Jusqu’au COVID, quand, de fait, Bertrand Meunier n’a pu se rendre en Chine. Pour autant, ses clichés concourent à nous rendre évidents les atermoiements de la classe dirigeante chinoise pour communiquer sur la gravité de la pandémie, ses hésitations quant au confinement avant la soudaine et radicale politique répressive du « zéro COVID » puis la fin aussi subite que brutale de cette politique et le refus de vaccins étrangers.
Bertrand Meunier reste fidèle à la technologie argentique, à la lenteur qu’elle induit et qu’il affectionne particulièrement. Il utilise des films extrasensibles et produit des tirages argentiques le plus souvent dans le format traditionnel du 40 x 60 cm, qu’il aime à assembler en mosaïque au bénéfice de la narration. Les sujets évoluent devant nous, en apparence indifférents aux contraintes de leur temps et au photographe. Il en résulte une œuvre cohérente et homogène, comme une séquence quasi sans fin d’un film qui durerait depuis 20 ans ; d’ailleurs, le qualificatif « cinématographique » revient régulièrement lorsque l’on évoque le travail de Meunier. Les photographies sont denses, presque charbonneuses. Pour les paysages, les plans sont larges et des personnages semblent les traverser comme des fantômes, tandis que pour les portraits, les cadrages sont resserrés, les expressions comme en suspens. Meunier égrène des immeubles à moitié détruits, des bras et des dos qui portent, des visages tendus mais aussi des partages et des échanges de regards, des références au cinéma nombreuses. Est proposé au regardeur un avenir apocalyptique fait de ruines autant que de modernité mal maîtrisée et absorbée à marche forcée.
L’être humain survit, l’être humain oppresse. C’est peut-être cela le véritable sujet photographique de Bertrand Meunier, qu’il explore dans chaque lieu visité, en France, en Chine, en Corée du Sud ou au Pakistan. La contrainte, la violence des politiques, voilà le leitmotiv de son œuvre. Les moyens sont différents, les régimes politiques également, mais il est toujours question de contrôle des populations ou de manipulation de la mémoire collective. Sans complaisance, Meunier montre des individus qui vivent, voire survivent, quelles que soient les injonctions de leurs dirigeants.
Le style et l’écriture photographique de l’auteur évacuent tout pathos ou voyeurisme et tentent de faire ressentir la violence de sociétés où des décisions prises par un nombre restreint de personnes ont des effets sur le plus grand nombre. De cette violence, Bertrand Meunier en rend compte par l’absence de couleurs, par la poussière, par les ruines, par les regards, par ses noirs si denses. Ses clichés en deviennent intemporels. De fait, il ne souhaite ni sensibiliser ni concerner mais bien partager ses questionnements. Bertrand Meunier a confié son fonds photographique au musée Nicéphore Niépce en 2021. Nous avons revisité avec le photographe les 3000 planches contact consacrées à la Chine pour proposer cette version de Erased
.
Erased
ou la disparition de mondes successifs; Erased
ou faire en sorte que ces mondes ne soient pas totalement effacés. En nous prêtant ses yeux emplis de doutes par l’entremise de l’appareil photographique, Bertrand Meunier nous oblige à ouvrir les nôtres. Et à douter, avec lui.
Sylvain Besson

En traversant le miroir
[extraits du texte
publié dans l’ouvrage Bertrand Meunier, Erased
]
Quelques semaines après
mon installation à Pékin comme
correspondant de Libération
,
à l’été 2000, je pris une décision :
je ne chercherais pas à « expliquer »
la Chine, mais à la « montrer ».
Cela peut sembler étrange pour
un journaliste justement envoyé
dans un pays lointain afin de
décrypter la complexité du monde.
Mais je réalisai très vite que chacune
des facettes de la gigantesque
et historique transformation
chinoise dont j’étais le témoin
était une partie de la réalité,
qui ne permettait pas pour autant
de comprendre ce qui se jouait
globalement. Ma démarche
s’apparentait donc à celle
d’un photographe, dont chaque
cliché a sa vie propre, mais
qui commence à « faire sens »
lorsqu’il est associé aux autres,
sur le temps long.
Un magazine économique chinois
m’a demandé un jour – c’était
une époque où le journaliste occidental n’était pas nécessairement un « ennemi » – de raconter mon travail en Chine pour son numéro de fin d’année. J’y expliquais comment j’avais le sentiment de traverser constamment le miroir entre plusieurs Chines, et que je vivais cela comme un privilège dont les Chinois eux-mêmes sont privés – ou, bien souvent, se privent volontairement.
Je racontais deux moments
de l’année écoulée, un reportage
dans une zone déshéritée
de la Chine rurale, où l’ascenseur social n’était pas encore passé ; et une soirée costumée dans l’univers des start-up de Pékin, où le déguisement le plus fréquent
avait été celui de Garde rouge, les partisans fanatisés de Mao pendant la révolution culturelle. J’exprimais ma perplexité face à ce grand écart de la société chinoise et, surtout, le cynisme de la nouvelle élite pékinoise, dénuée de tout sens de l’histoire.
[…]
En deux décennies, j’ai donc vu
la Chine prendre la parole, et
la perdre ; atteindre un développement
économique et une prospérité
qui semblaient inatteignables aussi
vite, et se demander si le prix
à payer n’a pas été trop élevé,
si elle s’en remettra, et comment. Il faut toujours avec la Chine
se garder de jugements trop hâtifs,
de sentences définitives, car
l’Histoire a montré à quel point
elle était imprévisible, éruptive,
et jamais réellement soumise.
Se garder donc de vouloir
l’expliquer à coups de concepts et de théories ; il faut déjà la « voir »,
dans sa complexité, sa diversité,
sa richesse et ses failles. C’est
ce qu’a fait, sur le temps long, avec
son regard et son talent, mon ami
Bertrand Meunier. Il a ainsi fait
œuvre utile.
Pierre Haski

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
L'accroche-coeur
voyages dans la collection
de Nathalie Casabo-Emprin
23 février ... 21 mai 2023
Inauguration : mercredi 22 février à 18h30

Jusqu’au milieu des années 1980, la reconnaissance des photographes comme artistes à part entière et l’émancipation de la photographie de ses caractères documentaires ou techniques ne sont pas acquis. Quelques précurseurs institutionnels posent pourtant les premières bases : le musée français de la Photographie de Bièvres est fondé en 1964, le musée Réattu à Arles qui inaugure un département photographie en 1965, la Bibliothèque Nationale crée un département dédié à la photographie sous l’égide de Jean-Claude Lemagny en 1968 et le musée Nicéphore Niépce, créé en 1972, ouvre ses portes au public en décembre 1974. De son côté, le marché se met timidement en place avec quelques galeries dédiées [notamment Agathe Gaillard
en 1975, Baudoin
Lebon
en 1976, Studio 666
en 1980 ou Le Réverbère
en 1981]. Certains photographes sont eux-mêmes à l’initiative de cette reconnaissance : Jean-Pierre Sudre organise au sein de la galerie La Demeure
des expositions qui confrontent auteurs contemporains et maîtres du passé [« Sieff / Bayard », décembre 1968 ; « Dieuzaide / Talbot » en 1971 par exemple] ; Jean Dieuzaide ouvre la Galerie du Château d’Eau en 1974.
Au début des années 1990, la situation a déjà considérablement évolué. Le Mois de la Photo
à Paris propose depuis 1980 des expositions traduisant la diversité du médium et des approches, expositions complétées par des catalogues, des colloques, des rencontres-débats, etc., contribuant à augmenter la visibilité de la photographie. La naissance du Centre National de la Photographie en 1982 entérine la promotion par l’État de la création photographique contemporaine française. La demande du public d’ailleurs est forte, soutenue par des initiatives comme celle de la FNAC qui ouvre ses galeries photos en 1969 et commercialise avec force conseils du matériel photographique désormais accessible à tous ; les expositions présentées dans les galeries FNAC sont également accompagnées de rencontres et de débats.
De fait, une nouvelle génération de photographes émerge, soutenue par les institutions, les critiques, le marché. Des débats esthétiques inédits s’imposent et le sacrosaint 30 x 40 noir et blanc cher aux humanistes est supplanté par de grands tableaux photographiques en couleurs. Des artistes contemporains s’emparent du médium photographique et les expérimentations se multiplient tandis que de nouvelles revues voient le jour tentant de rendre compte de cette multiplication des approches [Photo
, Zoom
, Contrejour
, Camera International
, Photographie Nouvelle
, etc.].
Au cœur de ce foisonnement photographique des années 1980, Nathalie Casabo-Emprin [NCE] expose en 1988 le collectif Noir Limite
qui vient d’être censuré à Bourges à la galerie Suzel Berna
[installée à Antibes depuis 1982 et spécialisée dans la sculpture verre et la peinture]. S’ensuit en 1989 « Les trois maîtres de l’étrange », confrontant les photographies de Ralph Gibson, Eikoh Hosoé et Arno Minkkinen et les sculptures en verre de l’américain Dale Chihuly. Le succès de ce « dialogue » entre photographies et sculptures verre, toutes deux façonnées par la lumière, convainc la galerie de se lancer et explorer cette nouvelle forme. NCE intègre la galerie et la photographie la galerie et la photographie y prend pleinement place.
Pionnières en ce domaine,Suzel Berna
et NCE présentent systématiquement en duo ou en collectif les sculptures en verre et les photographies d’artistes internationaux. Stimulés par cette approche, artistes et publics encouragent la galerie à ouvrir un espace parisien en 1990. Une vingtaine d’expositions souvent accompagnées de débats, conférences – animées par des philosophes [Robert Pujade], historiens [Hervé Le Goff], conservateurs [Jean-Claude Lemagny], journa-listes [Jean-Christian Fleury] – et signatures de livres [Michel Tournier/Arno Minkkinen] auront lieu jusqu’en 1995.
Dès 1991, NCE organise des expositions à l’extérieur et devient l’agent d’Arno Minkkinen et de plusieurs photographes. Commencent alors des projets plus ambitieux comme la réalisation du livre [Marval-Aperture, Prix des Rencontres d’Arles 1994] et de la rétrospective Waterline
[20 ans d’autoportraits de Minkkinen] présentée au Pori Art Museum en Finlande, au Musée de l’Élysée de Lausanne, aux Rencontres d’Arles en diaporama, et à la galerie avec la signature du livre par Michel Tournier. Le développement de ces activités l’amène à quitter la galerie Suzel
Berna
et à créer sa propre structure
en 1995 : NCE Photographie Contemporaine
. Dès lors, NCE
adapte son fonctionnement :
elle n’offrira plus seulement un lieu
d’exposition mais sera également
agente et productrice d’expositions
aux thèmes souvent audacieux
et qui nourrissent la créativité
des photographes. À la fois agence
donc mais aussi galerie itinérante
et proposant à la location
des expositions monographiques
ou collectives « clés en main »,
la structure fait montre d’un engagement
en faveur des photographes
peu commun pour l’époque.
Exposer c’est choisir et les choix de NCE peuvent parfois sembler des coups de coeur plus qu’une ligne éditoriale, tant le profil des auteurs semble a priori
hétérogène. Or bien au contraire, une fois confrontés entre eux, se dégagent des différents corpus, une vraie cohérence et une vraie ligne directrice. NCE Photographie
Contemporaine
fait le choix d’une approche peu orthodoxe : alors que la mode est au renouveau de la photographie française, aux changements de format, à la couleur, NCE défend une photographie souvent engagée, sans frontières et sans tabou. C’est ainsi qu’elle expose dès 1990, The Sisters of Perpetual Indulgence
de Jean-Baptiste Carhaix, Persona
Grata et Ignudi
, nus masculins de Lenni Van Dinther, le TB-AIDS
Diary
de l’américaine Linda Troeller, les travaux de Philippe Hédan [mort du Sida peu après son exposition au Musée Réattu] et «
Sida&prévention »
invitant 30 artistes internationaux à créer une œuvre sur ce thème en 1993. Elle s’attache à faire connaître la photographie finlandaise au public français, en initiant la première rétrospective de la photographie finlandaise au Mois de la Photo à Nice, « Finnice », en 1991, en créant l’exposition « Vents du Nord, 6 regards finlandais sur la terre – l’homme – la matière » pour le mois de la photo à Talant en 1995, et « Une histoire finlandaise » pour le centre photographique de Rouen en 1997.
NCE promeut aussi la photographie française à l’étranger. En 1996, l’exposition « Suds » rassemblant huit jeunes auteurs français est présentée à la Fondation italienne de la Photographie à Turin après avoir été inaugurée au Musée de la Photographie d’Helsinki en Finlande avec lequel NCE collaborera à plusieurs reprises. « Un alphabet intime », réunissant les œuvres de Boubat, Clergue et Dieuzaide, est exposé à la Galerie Otso en partenariat avec le centre culturel français d’Helsinki. Agent de nombreux photographes étrangers et de jeunes auteurs français, NCE collabore avec des institutions mais aussi des galeries européennes et des maisons d’édition. La production de l’exposition et du livre Alemeshaye et autres histoires
de femmes
de Shanta Rao, lauréate du European Publishers Award
for Photography 1995
[Éd. Braus, Stichting Fragment Foto, Lunwerg Editores, Dewi Lewis Publishing, Marval, Peliti Associati] en est un exemple. Mais être agent engage et contraint : la galerie défend, soutient et encourage alors la personne, son travail et ses œuvres. Pérenniser une telle structure, indépendante, avec autant d’artistes, sans mécènes, sans subventions, et sans céder aux diktats de la mode, était sans doute utopique ou trop ambitieux ;
L’aventure s’achève en 2002 aprèsl’exposition « Les Métamorphoses » en 2001 à Paris. Une grande partie du fonds de NCE Photographie contemporaine y est présentée et plusieurs personnalités [Anne Sanciaud, Jean-Claude Lemagny, Gérard Haddad, psychanalyste et écrivain, le photographe Bogdan Konopka, les journalistes Armelle Canitrot, Yan Le Goff, Jeanne Fouchet...] viennent parler des œuvres de leurs choix, rendant ainsi une dernière fois hommage à la galerie et à sa collection.
Force est de constater que peu nombreuses sont les galeries dédiées à la photographie créées dans les années 1980 connues du grand public ayant encore pignon sur rue aujourd’hui. Appartenant à la deuxième vague des galeries consacrées spécifiquement à la photographie, NCE s’est affichée comme défricheuse alors que le marché était encore balbutiant [la foire Paris-Photo n’existe que depuis 1997].
L’exposition « L’accroche-coeur » nous invite à voyager dans l’activité de la galerie Suzel Berna /
NCE Photographie Contemporaine, de 1989 au début des années 2000. Elle raconte une épopée, une histoire de la photographie en train de s’écrire et de s’inscrire progressivement dans le marché de l’art, dans une fin de siècle en pleine mutation avec l’avènement du numérique qui se profile.
« L’accroche-coeur », Voyages
dans la collection de Nathalie
Casabo-Emprin
s’organise comme une balade poétique à travers les principales expositions collectives ou personnelles. Autant de projets qui rendent compte de la richesse des techniques photographiques employées par les photographes de cette époque [gommes bichromates, tirages au palladium, polaroids transferts, etc.], et de la diversité des approches artistiques pour questionner le monde.
Artistes associés /
> Les trois maîtres de l’étrange :
Ralph Gibson,
Eikoh Hosoe,
Arno Minkkinen.
> Vents du Nord / Une histoire finlandaise / Finnice :
Stefan Bremer,
Ulla Jokisalo,
Timo Kelaranta,
Harri Larjosto,
Arno Rafael
Minkkinen,
Jyrki Parantainen,
Jorma Puranen,
Pentti Sammallahti.
> Nus masculins / Visions au féminin :
Emmanuelle Barbaras,
Shanta Rao,
Nadine Wergifosse,
Lenni Van Dinther.
> Un alphabet intime :
Édouard Boubat,
Lucien Clergue,
Jean Dieuzaide.
> Sida&prévention :
Vasco Ascolini,
Emmanuelle Barbaras,
Jean-Baptiste Carhaix,
Franco Fontana,
Thierry Géraud,
Ralph Gibson,
Michael Von Graffenried,
Timo Kelaranta,
Arno Minkkinen,
Linda Troeller,
Valérie Winckler.
> H 2 O :
Kristof Albrecht,
Carmelo Bongiorno,
Eric Bourret,
Edouard Boubat,
Christophe Bourguedieu,
Lucien Clergue,
Jean Dieuzaide,
Connie Imboden,
Bogdan Konopka,
Tuija Lindström,
Peter Maurer,
Arno Minkkinen,
Jyrki Parantainen,
Jorma Puranen,
Shanta Rao,
Pentti Sammallahti,
Patrick Toth,
Linda Troeller,
Lenni Van Dinther.
> Suds :
Emmanuelle Barbaras,
Didier Ben Loulou,
Christophe Bourguedieu,
Frances Dal Chele,
Anne Delassus,
Yann De Fareins,
Thierry Géraud,
Shanta Rao.
> Accrochage libre :
Vasco Ascolini,
Jean-Claude Bélégou,
Carmelo Bongiorno,
Toni Catany,
Jean-Baptiste Carhaix,
Florence Chevallier,
Barbara Crane,
Frances Dal Chele,
Jean Dieuzaide,
Thierry Géraud,
Philippe Hédan,
Timo Kelaranta,
Ralph Louzon,
Tuija Lindström,
Peter Maurer,
Olivier Pasquier,
Michel Semeniako,
Yves Trémorin,
Lenni Van Dinther.

![Shanta Rao [1966] Sans titre vers 1990 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Shanta Rao/ADAGP 2023 Shanta Rao [1966] Sans titre vers 1990 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Shanta Rao/ADAGP 2023](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/actuelles/l-accroche-coeur-voyages-dans-la-collection-de-nathalie-casabo-emprin/nce/60019-1-fre-FR/NCE_smartphone.jpg)
![Barbara Crane [1928-2019] Série «Objets trouvés» 1983 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Barbara Crane Studio Barbara Crane [1928-2019] Série «Objets trouvés» 1983 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Barbara Crane Studio](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/actuelles/l-accroche-coeur-voyages-dans-la-collection-de-nathalie-casabo-emprin/nce3/60040-1-fre-FR/NCE_smartphone.jpg)
![Arno Rafael Minkkinen [1945] Autoportrait, Nauvo, Finlande 1973 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Arno Rafael Minkkinen Arno Rafael Minkkinen [1945] Autoportrait, Nauvo, Finlande 1973 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Arno Rafael Minkkinen](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/actuelles/l-accroche-coeur-voyages-dans-la-collection-de-nathalie-casabo-emprin/nce5/60056-2-fre-FR/NCE_smartphone.jpg)
![Jean-Baptiste Carhaix [1946] Sister Hellina Handbasket 1993 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Jean-Baptiste Carhaix Jean-Baptiste Carhaix [1946] Sister Hellina Handbasket 1993 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Jean-Baptiste Carhaix](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/actuelles/l-accroche-coeur-voyages-dans-la-collection-de-nathalie-casabo-emprin/nce6/60064-1-fre-FR/NCE_smartphone.jpg)
![Connie Imboden [1953] Visceral Thoughts 1987 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Connie Imboden Connie Imboden [1953] Visceral Thoughts 1987 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Connie Imboden](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/actuelles/l-accroche-coeur-voyages-dans-la-collection-de-nathalie-casabo-emprin/nce7/60072-1-fre-FR/NCE_smartphone.jpg)
28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Cinematographer
25 février ... 21 mai 2023
Inauguration : lundi 27 février à 18h15
Le musée Nicéphore Niépce présente une sélection de travaux photographiques personnels réalisés par des membres de l’Association Française des directrices et directeurs de la photographie cinématographique [AFC].
Faut-il le rappeler, le cinéma est l’émanation de la photographie. Il a fallu d’abord décomposer le mouvement en images fixes, [ce qu’ont fait Jules Étienne Marey et Edweard Muybridge dans les années 1870], puis trouver le moyen de faire défiler ces images au rythme de 24 par secondes pour les animer [les frères Louis et Auguste Lumière, 1895]. Dans les années 1930, la photographie se répand dans les livres, dans la presse, prend peu à peu le pas sur le texte, et adopte les codes narratifs cinématographiques [séquences, expressivité, etc.]. Les histoires se racontent par l’image. Et si longtemps seront étudiées les différences entre image fixe et image animée, le passage aux technologies numériques au début des années 2000 semble avoir atténué les réflexions sur les antagonismes des deux pratiques pour les concentrer sur leurs concordances. Notre culture visuelle ne s’arrête plus à cette opposition et la frontière est désormais poreuse. Par l’opération du montage et l’organisation des séquences entre elles, le cinéma fait des histoires. Un film est un travail d’équipe : chaque rôle est déterminé, chaque tâche décomposée. Au-delà du scenario, du rôle du réalisateur, du jeu des acteurs, les techniciens participent aussi aux effets narratifs : les ingénieurs son, les décorateurs, accessoiristes, et les chefs opérateurs ou directeurs de la photographie. En anglais, ces derniers se désignent avec la neutralité du vocable « Cinematographer ». Ceux-là sont des professionnels de l’image, des professionnels du cadrage et de la lumière.
Quand la caméra est éteinte et l’équipe de tournage au repos, certains, certaines, de ces « cinematographer » retournent à la photographie. Ils et elles continuent de cadrer, de regarder le monde à travers un viseur, d’observer, d’attraper les lumières, les couleurs, de capter les ambiances. Certains, certaines commencent de nouvelles histoires, plus intimes, plus solitaires, mais toujours écrites avec la lumière. Des histoires amorcées, en images, comme des « photogrammes de films qui n’existent pas » [Pascale Marin].
L’exposition présentera les séries photographiques de : Gertrude Baillot, Céline Bozon, Sébastien Buchmann, Rémy Chevrin, Jean-Marie Dreujou, Denis Lenoir, Laurent Machuel, Pascale Marin, Claire Mathon, David Nissen, Pierre Novion et David Quesemand.
En parallèle, une seconde exposition « Chefs Op’ : L’autre du 27 février au 16 mars 2023 à l’Espace des Arts à Chalon-sur-Saône une sélection de photographies de vingt-six membres de l’AFC.
Chef opérateur, Chef op’, cinematographer, directeur de la photographie… quelle que soit l’appellation choisie, elle désigne un métier, un maillon central de la production cinématographique. Dans le processus de fabrication d’un film, tout ce qui a trait à l’image, tout ce qui sera vu par le spectateur relève de leur responsabilité et de leurs compétences. Les cadrages, les techniques d’enregistrement, mais surtout la création, le choix et l’exécution de la lumière. C’est leur travail que ce festival met à l’honneur. Quelles pratiques ces professionnels de l’image animée ont-ils gardé de la photographie ? À cette question curieuse, vingt-six des membres de l’AFC [Association Française des directrices et directeurs de la Photographie Cinématographique], ont répondu présents. À travers des citations de leurs travaux personnels, vous pourrez découvrir toute la diversité et la richesse de leurs créations photographiques.
Avec les travaux de : Robert Alzraki, Gertrude Baillot, Hazem Berrabah, Céline Bozon, Sébastien Buchmann, François Catonné, Rémy Chevrin, Jean-Marie Dreujou, Isabelle Dumas, Nathalie Durand, Jean-Noël Ferragut, Nicolas Gaurin, Jimmy Glasberg, Thierry Jault, Denis Lenoir, Laurent Machuel, Baptiste Magnien, Pascale Marin, Stephan Massis, Claire Mathon, David Nissen, Pierre Novion, Steeven Pettiteville, Gilles Porte, David Quesemand et Gordon Spooner.
Commissariat de l’exposition :
Émilie Bernard et Emmanuelle Vieillard, musée Nicéphore Niépce
Exposition réalisée en partenariat avec le Festival Chefs Op’ en Lumière
Avec le mécénat de Canson
Tous les tirages de l’exposition, à l’exception du travail de Sébastien Buchmann, ont été réalisés au laboratoire du musée sur papier Canson Infinity.
Plus d’information sur les chefs opérateurs sur le site de l’AFC :
www.afcinema.com


28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Prix Impression Photographique
Ateliers Vortex :
Maxime Laguerre, Débris de synthèse
du 23 février au 31 mai 2023
Vernissage : mercredi 22 février à 18h30
Maxime Laguerre interroge dans son travail le métissage, la notion d’afrodescendance. Que signifie aujourd’hui être d'ascendance africaine et comment les représentations et stéréotypes des personnes noires, leur culture, leur visibilité, influent sur leur place dans la société et leur construction identitaire ?
« Ce travail est inspiré de l’œuvre d’Aimé Césaire, «
Cahier d’un retour au pays natal », ainsi que par l’esthétique du carnet (tant le carnet de croquis, que de notes ou de voyage).
Pour ce projet, j’ai créé un ensemble d’œuvres assemblées autour d’un travail photographique réalisé en novembre 2021 au Togo. Mon but était de composer de nouvelles images à partir de ces photographies, du fonds iconographique du musée Nicéphore Niepce, de mes archives personnelles ainsi que de fragments de textes issus de différents auteurs afrodescendants.
J’ai souhaité une esthétique au plus proche du carnet de croquis où images, notes et références viennent s’entremêler et mettre en lumière une recherche artistique, tant plastique que théorique, autour des notions de Négritude, de Panafricanisme et de Mondialité afin de constituer un ensemble plastique qui saurait traduire au mieux ma découverte du continent africain. L’association de documents vient dialoguer et tisser une relation entre mon travail photographique et les œuvres constitutives de mon accomplissement en tant qu’artiste afrodescendant.
L’ensemble des portraits et de paysages a été réalisé entre les villes de Lomé et Kpalimé. Ce voyage fut mon premier contact avec le territoire africain. Ainsi, après plusieurs mois de gestation, il m’est apparu que la meilleure manière de donner du relief à cette expérience photographique soit de mettre mon travail en lien avec une iconographie précise, ainsi qu’avec les textes fondateurs de ma constitution en tant qu’Être créole, en tant qu’Être du «Tout-monde».
Ce travail a été élu Prix Impression Photographique des Ateliers Vortex (Dijon) et du musée Nicéphore Niépce, avec le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English





















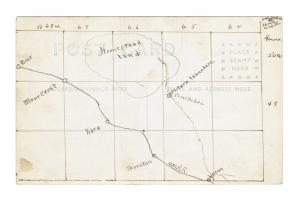






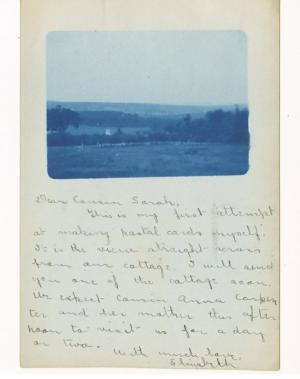


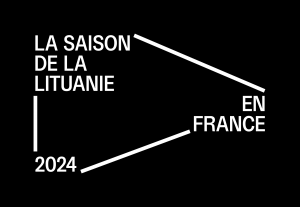








![La Poubelle du Psy [la forme de votre chagrin] 2007 © Jean-Christian Bourcart La Poubelle du Psy [la forme de votre chagrin] 2007 © Jean-Christian Bourcart](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/jean-christian-bourcart/visuel-4/65107-1-fre-FR/visuel-4_smartphone.jpg)































![Baptiste Rabichon XXe siècle [05] 2020, photogramme, unique © Baptiste Rabichon Baptiste Rabichon XXe siècle [05] 2020, photogramme, unique © Baptiste Rabichon](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/baptiste-rabichon/baptiste-rabichon2/59767-7-fre-FR/Baptiste-Rabichon_smartphone.jpg)
![Baptiste Rabichon XXe siècle [01] 2020, photogramme, unique © Baptiste Rabichon Baptiste Rabichon XXe siècle [01] 2020, photogramme, unique © Baptiste Rabichon](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/baptiste-rabichon/xxe-siecles-01/62066-1-fre-FR/XXe-siecles-01_smartphone.jpg)


![Baptiste Rabichon Blue Screen of Death [026] 2022 Photogramme, ed. 1/1 © Baptiste Rabichon Baptiste Rabichon Blue Screen of Death [026] 2022 Photogramme, ed. 1/1 © Baptiste Rabichon](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/baptiste-rabichon/blue-screen-of-death-026/62122-1-fre-FR/Blue-Screen-of-Death-026_smartphone.jpg)








![Selfportrait [Cosmopolitan] october 2 2000 Gelatin silver print © Kate Barry Selfportrait [Cosmopolitan] october 2 2000 Gelatin silver print © Kate Barry](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/kate-barry/kate-barry/59747-6-fre-FR/kate-barry_smartphone.jpg)
![Autoportrait [pour Elle] 2001 Impression numérique © Kate Barry Autoportrait [pour Elle] 2001 Impression numérique © Kate Barry](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/kate-barry/kate-barry4/60863-1-fre-FR/kate-barry_smartphone.jpg)

![Jane Birkin [Bretagne] 1995 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Kate Barry Jane Birkin [Bretagne] 1995 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Kate Barry](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/kate-barry/barry-02/61161-1-fre-FR/BARRY-02_smartphone.jpg)
![Mode [pour Cosmopolitan] 2000 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Kate Barry Mode [pour Cosmopolitan] 2000 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Kate Barry](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/kate-barry/barry-08/61169-1-fre-FR/BARRY-08_smartphone.jpg)
![Les Robes Noires [Elle] 2001 Gelatin silver print © Kate Barry Les Robes Noires [Elle] 2001 Gelatin silver print © Kate Barry](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/kate-barry/kb-image-6-et-7/61177-1-fre-FR/kb-image-6-et-7_smartphone.jpg)
![Reine Graves [Joyce] 2002 Chromogenic Print © Kate Barry Reine Graves [Joyce] 2002 Chromogenic Print © Kate Barry](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/kate-barry/kb-image-6-et-7/61179-1-fre-FR/kb-image-6-et-7_smartphone.jpg)




















![Linda Troeller [1949-] Photographie de la Série TB – AIDS Diary 1988 Polaroid © Linda Troeller Linda Troeller [1949-] Photographie de la Série TB – AIDS Diary 1988 Polaroid © Linda Troeller](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/actuelles/l-accroche-coeur-voyages-dans-la-collection-de-nathalie-casabo-emprin/nce2/60027-10-fre-FR/NCE_smartphone.jpg)
![Eikoh Hosoe [1933] Embrace 46 1971 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Eikoh Hosoe Eikoh Hosoe [1933] Embrace 46 1971 Tirage sur papier au gélatino-bromure d’argent © Eikoh Hosoe](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/actuelles/l-accroche-coeur-voyages-dans-la-collection-de-nathalie-casabo-emprin/nce4/60048-1-fre-FR/NCE_smartphone.jpg)












![Maxime Laguerre, Débris de synthèse [détail], 2023 Maxime Laguerre, Débris de synthèse [détail], 2023](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/maxime-laguerre/maxime-laguerre/59817-6-fre-FR/maxime-laguerre_smartphone.jpg)