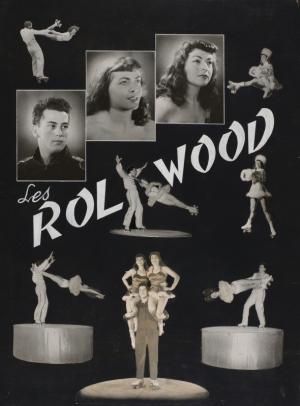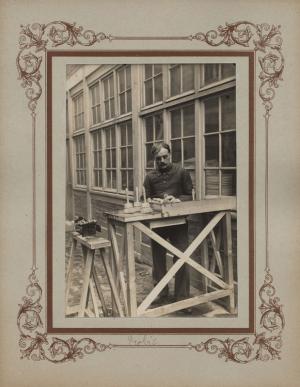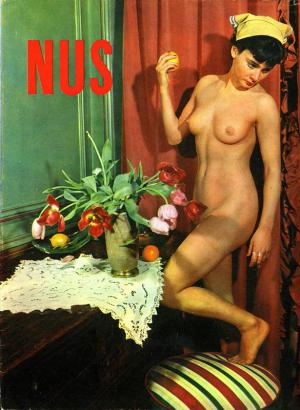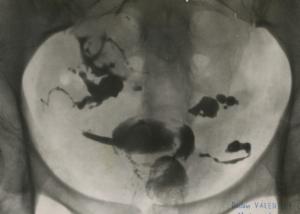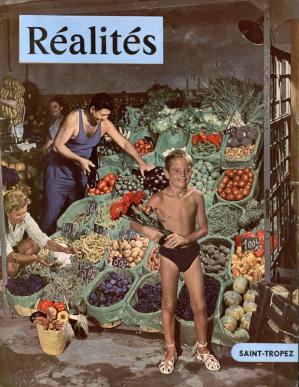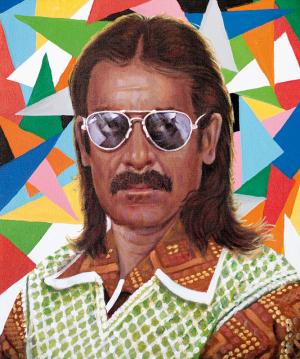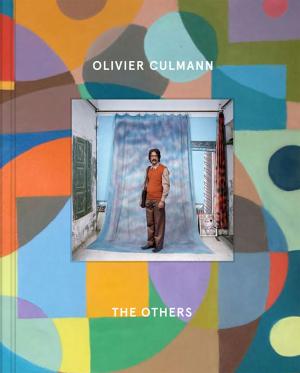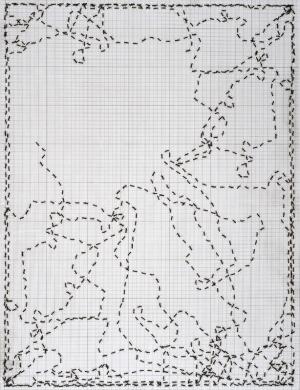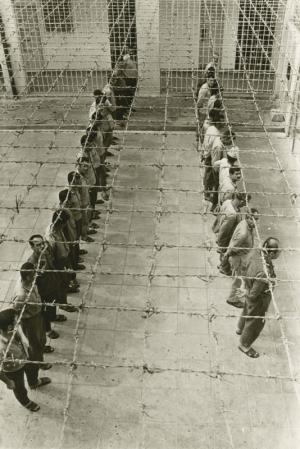Stéphane Couturier
Alger, Climat de France
15 10 2016 ... 15 01 2017
Stéphane Couturier s’attache aux développements urbains et aux métamorphoses des bâtiments. Avec élégance, le photographe réussit à mettre à nu les « tripes de la ville » ; ses vues, qu’elles soient réalisées à Paris, Berlin, La Havane ou Séoul, sont l’inextricable enchevêtrement d’un rendu hyperréaliste et de la dissolution de la forme. Conçu à partir de 2011, le projet « Climat de France » repose sur une figure de l’architecture des années 1950, Fernand Pouillon, qui fut un des grands bâtisseurs des années de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. A travers la photographie et la vidéo, Stéphane Couturier dissèque la plus grande cité d’Alger, édifiée au moment de la guerre d’Algérie, lieu d’affrontement entre GIA et pouvoir, et désormais place forte de tous les trafics.
Exposition réalisée grâce au mécénat de Marie et David Benmussa et au soutien de la Société Canson, de la Société des Amis du musée Nicéphore Niépce et du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bourgogne Franche-Comté.
La ville est une mise en séquences, certes, mais elle est un bloc. Immeuble par immeuble, quartier par quartier, portrait par portrait, Alger semble indivisible. Les fragments conviennent parfaitement à l’idée de la ville.
On sait, on l’a assez répété, que l’idée et l’objet ne peuvent coïncider. Et pourtant, ici, Stéphane Couturier approche de la « vérité ». Il ne convoque pas nos sens mais il nous fait voir les matières. En recourant systématiquement à la bande-séquence, il se dégage d’une description uniquement matiériste. Sa photographie a l’ambition de rendre compte de cet événement par le nombre infini de circonstances qui l’accompagnent. Ce n’est pas en convoquant le hasard que le photographe nous conduit à entrevoir des morceaux de vivant. L’idée de la bande fragmentaire les relie, ou plutôt elle les rapporte à une forme de pensée qui leur confère un sens. La représentation précise des propriétés de ce qui est exposé incite le spectateur au commentaire. La méthode photographique est implacable.
N’y aurait-il donc de vérité que dans cette géométrie et dans la rigueur des lignes ? La connaissance des choses pourtant est inséparable de ces objets suspendus, courant le long d’interminables façades. Le périssable, l’histoire quotidienne des hommes, se joue du monument et de son essence. Le temps est la grande affaire de cette photographie ; à chaque image son lot de strates historiques. Le temps long s’affiche aux côtés d’une actualité toujours changeante. Les draps, les vêtements sèchent et les antennes paraboliques signalent la modernité. Hors du temps et dans l’instant, la photographie constate que rien ne précède rien.
[...]
On voit comment se constitue l’univers photographique de Stéphane Couturier. Croyant contempler une abondante documentation sur l’architecture ou simplement compulser un inventaire insensible, le spectateur que nous sommes contemple sa propre relation à l’ordre et au désordre. Toutes ces images, dans leur construction subtilement répétitives, sont l’écho de nos angoisses et de nos désirs. La photographie, dans des temps anciens, aimait définir le bien et le mal.
Ici, la prise de position décrit l’impératif des choses et son antidote, le fluide. Dans ces photographies, on ne se heurte jamais au solide. La vie est évitement et retirement.
François Cheval
Visite de l’exposition avec Stéphane Couturier, samedi 15 octobre / 15 h 30 suivie d’une séance de dédicaces.



Climat de France, « une architecture sans mépris »
De sensibilité méditerranéenne et capable de produire des logements de qualité, en grande quantité et à faible coût, l’architecte Fernand Pouillon fut chargé au cours des années 1950 par le maire d’Alger de réaliser trois ensembles, dont Climat de France. Ils devaient contribuer à loger les populations musulmanes alors entassées dans des bidonvilles, réduire les tensions sociales et réaffirmer l’autorité de la métropole.
Dominant le quartier populaire de Bab el-Oued et la vieille ville, tournée vers la mer, Climat de France était, avec près de 5000 logements, l’opération la plus importante. [...] L’immeuble principal s’organise autour d’une longue place de 233 x 38 m dont les façades sont scandées par des colonnes de pierre blanche qui confèrent à l’ensemble un caractère classique. Pouillon écrira : « [...] j’ai la certitude que cette architecture est sans mépris. Pour la première fois peut-être dans les temps modernes, nous avions installé des hommes dans un monument. Et ces hommes qui étaient les plus pauvres de l’Algérie pauvre, le comprirent. C’est eux qui baptisèrent la grande place “les 200 colonnes”. »
Aujourd’hui, Climat de France est une cité surpeuplée, par endroits délabrée et insalubre. Les caves ont été transformées en chambres et le toit terrasse du bâtiment des 200 Colonnes, initialement un lieu de travail et de sociabilité pour les femmes, accueille désormais un bidonville. La place, qui concentre les trafics, est surnommée La Colombie et la police ne rentre plus dans la cité. Mais l’architecture de pierre a résisté à cette surpopulation bien mieux que ne l’aurait fait le béton.
Étienne Hatt
Journaliste – membre de la rédaction d’artpress

Publications :
Stéphane Couturier
Alger – Climat de France
Textes de François Cheval, Étienne Hatt
Arnaud Bizalion éditeur, Marseille, 2014
Format 23 x 32 cm, 76 pages
ISBN : 978-2-36980-023-1
30 €
Stéphane Couturier
Textes de François Cheval, Matthieu Poirier
Éditions Xavier Barral, Paris, 2016
Format 24 x 30 cm, 308 pages
ISBN : 978-2- 36511-111-9
39 €



28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Lamia Joreige
And the living is easy
Variations autour d'un film
15 10 2016 ... 15 01 2017

Artiste plasticienne et cinéaste libanaise, Lamia Joreige utilise des documents d’archives et des éléments fictifs pour réfléchir aux relations entre les histoires individuelles et l’histoire collective. Elle explore les représentations des guerres libanaises et leurs conséquences. Beyrouth est au centre de son imagerie.
Avec l’exposition « And the living is easy – Variations autour d’un film », Lamia Joreige propose une installation en trois parties autour de son long métrage réalisé à Beyrouth en 2014. A travers le quotidien mis en scène de cinq personnages, Lamia Joreige réalise un portrait en creux de sa ville natale : entre beauté des images, apparente douceur de vivre et angoisse de l’instabilité politique au Proche-Orient.
Les changements politiques, sociaux et urbains de Beyrouth, depuis les années 90 jusqu’à aujourd’hui, ont transformé la ville et l’expérience d’y vivre. Depuis dix ans, Beyrouth, est comme en suspens, figée dans un présent qui empêche toute projection dans l’avenir, dans l’attente d’une résolution des conflits du pays mais également de ceux de toute la région. Cet état est au cœur de mon long-métrage And the living is easy réalisé en 2014 qui sera projeté quotidiennement dans l’exposition.
Quelles questions se posent lorsque l’on passe de l’espace de projection à celui d’exposition? Que se passe-t-il dans le processus de pensée d’une œuvre de sa genèse à sa réalisation et inversement après la réalisation de celle-ci lorsque l’on la décortique, la repense et la réinvente?
L’installation And the living is easy – Variations autour d’un film interroge la fabrication de mon long-métrage And the living is easy [2014], et les possibilités de formes qu’il crée. Elle se déploie en trois temps ou Partitions [Le scénario , La bande-son et La cartographie d’un film ] qui reconfigurent le matériau du film, l’espace et la durée dans le lieu d’exposition.
Le scénario de And the living is easy n’a jamais existé. Le tournage qui a eu lieu en 2011, était entièrement basé sur l’improvisation, les scènes étant inspirées par des lieux dans la ville et les désirs des personnages, qui pour la plupart, n’étaient pas des acteurs et qui tous y jouaient leur propre rôle.
L’image-texte Partition I est un document rédigé a posteriori d’une œuvre dont elle documente l’intégralité du matériau, du tournage à la réalisation, en transcrivant les scènes du film, qu’on peut lire dans l’ordre du montage, ainsi que les prises de ces mêmes scènes, qui n’ont pas été choisies, et également les scènes filmées, mais qui n’ont pas été retenues au montage final.
Le tapuscrit présenté sous forme d’une frise de 15 mètres met en évidence le processus de création tout en ouvrant à un imaginaire spéculatif et en proposant une multiplicité de lectures.
Partition II
, la bande-son, est une installation sonore, qui interroge la notion de bande-son au cinéma en déconstruisant celle du film pour la recomposer sous une autre forme, avec une autre sonorité et dans une autre spatialisation.
Le pari est de ne travailler strictement qu’à partir de sons du film [hors dialogues], sans aucun ajout donc sans utiliser d’instrument extérieur, analogique ou électronique, mais en jouant de la vitesse, la réverbération, le spectre et la texture des sons.
Partition III reprend le principe d’une frise historique murale afin de réfléchir à ce qui s’est passé à Beyrouth entre le tournage du film et aujourd’hui, sur les plans sociologique, politique, historique, humain et géographique ; à ce qui s’est passé entre ces deux présents. Le film devient le prisme par lequel j’observe cette période, et sa géographie devient l’axe principal d’un montage fait de photographies, vidéos, textes, annotations personnelles, articles de journaux, où le réel et l’imaginaire se confondent pour raconter des histoires – faits divers, mouvements civiques, historiques, ou récits imaginés – nous en proposant une lecture non linéaire. Ici comme dans mon travail antérieur, la question de l’histoire et de ses récits possibles est centrale.
Comme un prélude à l’installation principale, Beyrouth 1001 vues , le 2e chapitre de Beyrouth, Autopsie d’une ville [2010], sera présenté dans l’exposition. S’inspirant de l’idée du palimpseste, cette vidéo, faite de photographies de plusieurs époques, intègre différents éléments temporels, pris dans un incessant mouvement d’absorption, d’effacement et de reconfiguration.
Lamia Joreige







28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Célèbre pour ses portraits monumentaux brossés en bichromie, Yan Pei-Ming tente d’atteindre à travers eux le portrait universel. Artiste compulsif et persévérant, il travaille depuis toujours indépendamment des caprices de courants artistiques éphémères, déclinant ses portraits en séries, peignant d’après modèle, de mémoire ou d’après photo.
C'est ce dernier aspect qui résonne particulièrement dans les murs du musée Nicéphore Niépce: plusieurs photographies de femmes et de couples servent ici de terreau à la créativité de Yan Pei-Ming. Par le mélange du fusain et de la gouache l'artiste réussit à rendre la brutalité d'un réel pris sur le vif ainsi que l'intrusion dans l'intimité de ces "demoiselles".
L'artiste isole sur le papier les femmes photographiées, les assemble, dissout le décor. Le corps, plus sensible à la lumière, surgit de la chambre noire de l'atelier, l'image se fixe. La rapidité du geste vient appuyer l'acuité du regard, tandis que la sensibilité de la pellicule fait place à la dextérité du pinceau.
Paradoxe ultime: la photographie, qui avait enterré le portrait peint, devient avec Yan Pei-Ming son outil de réhabilitation. Un outil qu'il manipule avec liberté pour le soumettre à la peinture et livrer une série d'œuvres saisissantes, Mesdemoiselles .

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Mathilde Geldhof, Luisa
Prix Impression Photographique Vortex
15 10 16 ... 15 01 2017
Les ateliers Vortex et le musée Nicéphore Niépce ont le plaisir de vous inviter à découvrir Luisa de Mathilde Geldhof, oeuvre primée et produite par les ateliers Vortex dans le cadre de la deuxième édition du Prix Impression Photographique soutenu par la Région Bourgogne Franche Comté.
En photographiant le quotidien, Mathilde Geldhof cherche à définir la part de réalité et de fiction présente dans l'image. Assemblées sous forme de retable, les scènes ordinaires photographiées au Portugal durant l'été 2015, se confrontent à la forme sacralisée de leur présentation. Le spectateur, en ouvrant et refermant les volets, parcourt une histoire, comme il lirait les chapitres successifs d'un roman. Luisa est autant une fable estivale qu'un récit métaphorique.
Mathilde Geldhof est diplômée de l’École nationale supérieur des beaux-art de Paris où elle a suivi l'enseignement de Patrick Tosani. Elle est lauréate du Prix Impression Photographique décernée par les ateliers Vortex en 2016. Ce prix reçoit le soutien du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.
Situés à Dijon, les ateliers Vortex regroupent des artistes qui mènent depuis 2012 une politique de diffusion de la création contemporaine à travers des expositions et des résidences artistiques. Le musée Nicéphore Nièpce s'associe aux ateliers Vortex en présentant temporairement le Prix Impression Photographique.

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
L’œil de l’expert
La photographie contemporaine
18 06 ... 18 09 2016
En décembre 2016, François Cheval quittera la direction du musée Nicéphore Niépce. L’occasion de revenir sur vingt ans d’une politique d’acquisition originale en matière de photographie contemporaine.
Le musée, lieu de conservation que d’aucun souhaiterait cantonner aux œuvres d’art ancien, seul patrimoine « avéré », a assumé son rôle de soutien à la création.
Accueil d’artistes en résidences, constitution de corpus d’œuvres capables de donner une vision complète de la carrière d’un artiste, production de tirages
sous la direction des photographes, projets artistiques dans la ville, ces choix
ont ouvert les collections à une réflexion sur le monde et sur le médium, à travers l’œil expert de l’artiste.
Exposition conçue avec le soutien des mécènes et partenaires :
Olympus France, BMW France, Canson, HSBC, le Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bourgogne Franche-Comté et de la Société des amis
du musée Nicéphore Niépce.
Dans le modèle originel du musée Nicéphore Niépce, fondé par Paul Jay en 1974, le photographe et l’artiste ne font qu’un. Le fondateur s’étant entouré de personnalités diverses, comme Philippe Néagu, André Jammes, Jean-Pierre Sudre, etc, il ressort de cette période une affirmation de la création photographique, nostalgique du savoir-faire, et une recherche de la vérité du média en tant qu’espace individuel de création. Et le cri d’amour poussé par Jean-Claude Lemagny sera repris dans les faits par Paul Jay : «Aimer charnellement la photographie. L’expression peut paraître bizarre. Mais je veux simplement rappeler que tout véritable amour est charnel». La photographie relève avant tout du sensible. On en parle comme d’un être aimé dont on décrit les qualités tactiles.
La « peau », la « chair » et la « matière », telle est la vérité d’une photographie humble,
à l’écart du marché, de l’art contemporain et de ses concepts. On se méfie de la facilité du grand format, on soupçonne la couleur pour sa vulgarité. Bref, n’étaient invités au musée que les photographes porteurs d’une certaine morale. Véritable démiurge, le photographe contemporain, un auteur dans le sens plein du terme, était proche de l’alchimiste, si ce n’est de l’apprenti-sorcier.
Depuis 1996, au photographe tout-puissant a succédé la figure du photographe saisi par l’incertitude ! Vingt ans d’acquisitions contemporaines interrogent le médium inventé par Nicéphore Niépce. Il ne s’agit pas uniquement d’introduire de nouvelles esthétiques, chaque image et chaque série sèment le doute sur les présupposés de l’acte photographique. L’enjeu ne pouvant se limiter à l’entre-soi du milieu photographique, la collection a fait le pari d’une alternative aux images « vulgaires » du monde. La collection contemporaine est un acte militant, une volonté farouche de s’opposer à l’entertainment, à la société du spectacle. Elle propose une suite de regards renouvelés de la part, non d’auteurs sacralisés, mais de professionnels de l’image, instruits des ruses du médium. En cela, les choix opérés de n’acquérir que des séries complètes, de les produire bien souvent, et d’affirmer des fidélités dans le temps dressent un tableau de la crise de la photographie et de sa possible régénération.
Le rôle confié à tous ceux que nous avons conviés ou convoqués est multiple et complexe. Il leur a été demandé, cette fois-ci sans humilité, de reconstruire la globalité de l’objet photographique. Et pour cela, de participer joyeusement à l’ébranlement du vieil édifice chancelant, s’effritant, sous les coups des médias modernes et des réseaux sociaux. Plus rien n’est indiscutable. L’auteur et le concept d’œuvre photographique, l’intention, cette catégorie indéfinie, les périodisations aléatoires et «l’histoire» de la photographie, l’ensemble des critères imposés de l’extérieur sont mis à mal.
Le musée Nicéphore Niépce n’est plus obsédé par la rareté et par l’épreuve unique. Parce qu’il s’est doté de moyens techniques [ laboratoire de production, résidences…], il a su proposer une nouvelle forme de relation avec le photographe. Dorénavant, au beau nom d’auteur nous préférons celui « d’expert », un être en possession d’un capital technique et culturel en capacité d’interroger la relation anthropologique qui s’incarne entre l’homme moderne, sa caméra et le monde. La politique d’acquisition s’est construite dans une polémique permanente entre l’institution provinciale et le photographe. Les « sujets » se sont imposés après disputes et débats. Ils ont pris forme en opposition au marché et à l’institutionnalisation de l’art. C’est en connaissance de la situation économique et de la crise culturelle de la photographie qu’ils ont pu émerger. Nous avons pu parler un moment d’achats « nécessaires » quand la notion d’art, inutile ici, a disparu au profit de récits critiques mais toujours jubilatoires. La photographie contemporaine ne peut tirer gloire aujourd’hui que de ses tentatives de témoigner non pas de l’état du monde, mais du rapport que nous entretenons avec l’image autocratique qui se confond avec la marchandise nouvelle. Elle fait comparaître devant nous l’objet de prédation, elle exhibe sa nette tendance à réduire les têtes, sa tentation permanente à être un objet totalitaire et un objet futile, un objet de contrôle social et de pure satisfaction. Elle s’inscrit en faux sur la supposée capacité et la légitimité du médium de restituer le réel, son objectivité.
Ce que l’œil de l’expert a apporté au musée Nicéphore Niépce et à ses visiteurs, c’est la démonstration d’une photographie sans réelles conséquences sur le monde, mais donnant l’impression d’une liberté retrouvée. Parce que débarrassée du narcissisme, de la décoration et du suivisme « arty », la photographie contemporaine a su jouer avec la machine et ses potentialités.
François Cheval



Listes des oeuvres exposées par artiste :
La sélection des œuvres présentées dans cette exposition s’est avérée complexe.
Des choix draconiens et des sacrifices ont du être fait. Nous vous invitons à retrouver la liste intégrale de tous les artistes qui ont été soutenus par le musée Nicéphore Niépce
mais également produits et suivis tout au long de leur parcours artistique en consultant notre site www.museeniepce.com
A
Ziad Antar
[1978 – ]
— Walid Joumblatt, Mokhtara, 2005,
tirage jet d’encres pigmentaires,
105 x 105 cm.
— Jean-Luc Moulène, 2002,
vidéo, durée : 16’’22’
Acquisition en 2013
B
Patrick Bailly-Maître-Grand
[1945 – ]
— Les Gémelles, 1997,
Paire de monotypes directs
[ positif-négatif ],
tirages au chloro-bromure d’argent,
80 x 65 cm chacun.
Acquisition en 2013
Roger Ballen
[1950 – ]
— Brian with pet pig, 1998,
— Man bending over, 1998,
— Woman, man and dog, 1995,
— Old man, Ottoshop, 1983,
tirages au gélatino-bromure d’argent,
36 x 36 cm.
Acquisition en 2006
John Batho
[1939 – ]
— Présents Absents, 1999,
18 tirages au gélatino-bromure
d’argent extraits
d’une série de 27 photographies,
format 29,5 x 23 cm.
Acquisition en 2002
Mathieu Bernard-Reymond
[1976 – ]
— Monuments_Crude oil prices
2003-2008, 2008,
tirage jet d’encres pigmentaires,
76 x 90 cm.
Acquisition en 2010
Jean-Christian Bourcart
[1960 – ]
— Série : The Dawn Came But No Day,
2016,
4 tirages jet d’encres pigmentaires,
40 x 60 cm
Acquisition en 2016
Bruno Boudjelal
[1961 – ]
— En Kabylie,
— Sans titre, 2009-2012,
— Tipaza, 2009-2012,
tirages jet d’encres pigmentaires,
40 x 60 cm.
Acquisition en 2012
Elina Brotherus
[1972 – ]
3 photographies issues d’un portfolio
— Le nez de monsieur Cheval,
série : Suites françaises 2
et 12 ans après, 1999,
— Contente enfin ?,
série : Suites françaises 2
et 12 ans après, 1999,
— Chambre 10 [le coin],
série : 12 ans après, 2011,
tirages jet d’encres pigmentaires,
30 x 37 cm.
Acquisition en 2015
François Burgun
[1977 – ]
— À ma soeur, mère de mes enfants,
série : Bande pour voir, 2005,
tirage jet d’encres pigmentaires,
100 x 100 cm.
Acquisition en 2013
Robert Burley
[1957 – ]
— Kodak Image Centre, Building 7,
Kodak Canada, Toronto, 2006,
— Film warehouse, Agfa-Gevaert,
Mortsel, Belgium, 2007,
— After the failed implosion
of the Kodak-Pathé building GL,
Chalon-sur-Saône, France,
December 10, 2007,
tirages jet d’encres pigmentaires,
101,5 x 122 cm.
Acquisition en 2014
C
Michel Campeau
[1948 – ]
— Sans titre, 0294 ( Montréal, Québec),
— Sans titre, 0145 ( Montréal, Québec),
série : La chambre noire, 2005-2009,
tirages jet d’encres pigmentaires,
107 x 84 cm.
Acquisition en 2013
Natasha Caruana
[1983 – ]
— Alchimie du soleil,
série : Coup de foudre, 2014,
tirage jet d’encres pigmentaires,
70 x 60 cm.
Photographies réalisées
lors de la Résidence BMW
au musée Nicéphore Niépce,
automne 2014.
Acquisition en 2014
Alexandra Catiere
[1978 – ]
6 tirages extraits de la série :
Ici, par delà les brumes, 2011,
— N.N.,
10 x 13 cm,
— Mouchoir blanc,
28,5 x 19,5 cm,
— Dipsacus, 2011
15 x 20,5 cm,
— Émile dans le soleil,
17,5 x 23,5 cm,
— Arbre de Chalon,
15,5 x 20,5 cm,
— Zacharie,
23,5 x 17 cm,
tirages au gélatino-bromure d’argent.
Photographies réalisées
lors de la Résidence BMW
au musée Nicéphore Niépce,
automne 2011.
Acquisition en 2012
Claire Chevrier
[1963 – ]
— GR07/2010,
— GR31/2010,
— GR14/2010,
série : Douchy-les-Mines, 2012,
tirages jet d’encres pigmentaires,
53 x 80 cm.
Acquisition en 2014
Gérard Collin-Thiébaut
[1946 – ]
— Série : Pliant (s) de voyage,
2 Notebook NEC et laque du Japon,
2001.
Acquisition en 2001
Kathryn Cook
[1979 – ]
— Le long de la route de déportation
dans le désert syrien,
entre Alep et Deir ez-Zor,
série : Memory of Trees, 2013,
tirage jet d’encres pigmentaires,
86 x 130 cm.
Acquisition en 2015
Alexis Cordesse
[1971 – ]
— Mur intérieur, 2011,
tirage couleur RC type Lambda,
55 x 183 cm.
Acquisition en 2012
Olivier Culmann
[1970 – ]
— Série : Autour, 2001 – 2002,
3 tirages jet d’encres pigmentaires,
50 x 50 cm.
Acquisition en 2016
D
Antoine d’Agata
[1961 – ]
— Série : Insomnia, 1998 – 2002,
tirages au gélatino-bromure d’argent,
27 x 22,5 cm.
Dépôt en 2011
Raphaël Dallaporta
[1980 – ]
— Fragile, Portfolio, 2011– 2012,
tirages dye transfer,
50 x 40 cm.
Acquisition en 2014
Denis Darzacq
[1961 – ]
— Hyper nº 23, 2010,
tirage jet d’encres pigmentaires,
105 x 70 cm.
Acquisition en 2010
Morgane Denzler
[1986 – ]
— Puzzle, Mémoire 2, 2012,
— Puzzle, Mémoire 4, 2012,
impression sur puzzles,
40 x 52 cm.
Acquisition en 2013
Michaël Durand
[1969 – ]
— Série : Paris Postcard, 1997,
4 tirages à développement
chromogène,
49,5 x 49,5 cm.
Acquisition en 1997
E
JH Engström
[1969 – ]
— Série : Trying to dance, 1996– 2001,
3 tirages à développement
chromogène, 104 x 133 cm.
Acquisition en 2007
F
Jean-Louis Faure
[1931 – ]
— Machine à espionner les porcs,
sculpture matériaux divers,
164 x 185 x 50 cm.
Maia Flore
[1988 – ]
— Série : Situations, 2011– 2012,
12 tirages jet d’encres pigmentaires,
30 x 40 cm.
Acquisition en 2015
Charles Fréger
[1975 – ]
— Série : Short school haka, 2009,
3 tirages jet d’encres pigmentaires,
100 x 82 cm.
Acquisition en 2013
G
Marion Gronier
[1976 – ]
— Série : Les Glorieux,
4 tirages jet d’encres pigmentaires,
40 x 40 cm.
Photographies réalisées
lors de la Résidence BMW
au musée Nicéphore Niépce,
automne 2012.
Acquisition en 2013
Stan Guigui
[1969 – ]
— Série : Cuchillo Bohemio, 2008,
3 tirages jet d’encres pigmentaires,
40 x 60 cm.
Acquisition en 2016
J
Noël Jabbour
[1970 – ]
Série : The Hunt
— Le sanglier, 2005,
— Stéphanie, 2005,
— Phaesant in a field, 2005,
tirages jet d’encres pigmentaires,
43,5 x 32,3 cm.
Acquisition en 2008
K
Peter Knapp
[1931 – ]
— Jet line, 1974,
composition de 12 tirages
à développement chromogène,
42 x 170 cm.
— Vol de la Panam dans le ciel
de l’Utah, 1984,
tirage chromogène, 150 x 100 cm.
— Aéroglyphe VII, Zermatt, 1983,
tirage jet d’encres pigmentaires,
44,7 x 60,7 cm.
Acquisition en 2013
L
Jean Le Gac
[1936 – ]
— Fifty fictif série 11, 1999,
diptyque d’un tirage
à développement chromogène
et d’un tirage au gélatino-bromure
d’argent,
48,5 x 58 cm.
Acquisition en 1999
Laurence Leblanc
[1967 – ]
— Série : Rendons le possible :
portraits, Cambodge, 2012,
4 tirages jet d’encres pigmentaires,
53 x 80 cm.
Acquisition en 2015
Ange Leccia
[1952 – ]
— Montage vidéo
réalisé pour l’exposition
à partir de deux oeuvres présentes
dans les collections :
Azé, 2003,
acquisition en 2003
et Ruins of love, 2006,
acquisition en 2006,
durée : 26’ en boucle.
M
Mac Adams
[1943 – ]
— The Third Swan, 2010,
tirages jet d’encres pigmentaires
triptyque, 102 x 102 cm.
Acquisition en 2010
Virginie Marnat-Leempoels
[1970 – ]
— Cocotte, 2002,
tirage au gélatino-bromure d’argent,
150 x 110 cm.
Acquisition en 2004
Guillaume Martial
[1985 – ]
— Série : Le Modulor, 2014,
9 tirages jet d’encres pigmentaires,
37 x 55,5 cm.
Acquisition en 2015
Serguey Maximishin
[1964 – ]
— A fountain. Gudermes. Chechnya,
août 2003,
tirage couleur, 30 x 45 cm.
— « Zov Ilyitcha » Restaurant.
Saint-Petersbourg, novembre 2003,
tirage couleur, 30 x 45 cm.
Acquisition en 2007
Mazaccio & Drowilal
Élise Mazac
[1988 – ]
et Robert Drowilal
[1986 – ]
Série : Wild Style, 2013,
— Celebrity,
— Analyse this,
— Mars Attacks!,
— Bad boys,
— Dances with wolves,
— L.A.,
— The Beach,
— Virus,
— Wild Wild West,
tirages jet d’encres pigmentaires,
20 x 30 cm.
Photographies réalisées
lors de la Résidence BMW
au musée Nicéphore Niépce,
automne 2013.
Acquisition en 2015
André Mérian
[1955 – ]
— Série : Water Front, 2012,
10 tirages jet d’encres pigmentaires,
35 x 48 cm.
Acquisition en 2014
Bertrand Meunier
[1966 – ]
— Série : Paysans ordinaires, 2006,
2 tirages chromogènes,
80 x 120 cm,
1 tirage chromogène,
60 x 90 cm.
Acquisition en 2008
Laurent Millet
[1968 – ]
— Série : Petites machines, 1997-1998,
4 tirages au gélatino-bromure d’argent,
40 x 30 cm.
Acquisition 1998
— La constellation des choses, 2009,
vidéo, format 4/3, durée : 59’’59’
Acquisition en 2009
Christian Milovanoff
[1948 – ]
— Attraction 1, 2005,
tirage jet d’encres pigmentaires,
60 x 80 cm.
— Attraction 16, 2005,
tirage jet d’encres pigmentaires,
60 x 80 cm.
Acquisition en 2005
— Extrait de la série Pitt Campus,
2001 – 2002,
tirage à développement chromogène,
96 x 120 cm.
Acquisition en 2007
Jean-Luc Moulène
[1955 – ]
— Hashem El Madani, Saïda, juin 2001,
tirage Cibachrome,
151 x 119 cm.
Acquisition en 2003
O
Yuki Onodera
[1962 – ]
— How to make a Pearl nº 23, 2000,
— How to make a Pearl nº 33, 2001,
tirages au chloro-bromure d’argent,
210 x 150 cm.
Acquisition en 2012
P
Dominique Pasqualini
[1956 – ]
— L’aurore des images, 2001,
vidéo, durée : 12’’
Acquisition en 2001
Mathieu Pernot
[1970 – ]
— Meaux (Seine-et-Marne) / 2.462
/ Au groupe scolaire du chemin
aux Prêtres, série : Les Témoins, 2006,
tirage jet d’encres pigmentaires,
60 x 50 cm.
— Meudon-la-forêt (Seine-et-Oise) /
Les Trivaux,
série : Le meilleur des mondes, 2006,
tirage jet d’encres pigmentaires,
28 x 40 cm.
Acquisition en 2006
Gerald Petit
[1973 – ]
— Série : L’Homme et la caméra, 2005,
4 tirages jet d’encres pigmentaires,
29,5 x 37,5 cm.
Acquisition en 2006
Philippe Pétreman
t [1976 – ]
— Série : De l’inconvénient d’être né,
2013,
3 tirages jet d’encres pigmentaires,
40 x 50 cm.
Acquisition en 2013
R
Walid Raad
[1967 – ]
et Akram Zaatari
[1966 – ]
/ Fondation Arabe pour l’image
— Surprise_West, 2002,
vidéo, durée : 2’24’’
— Surprise_East, 2002,
vidéo, durée : 2’22’’
Acquisition en 2005
Lola Reboud
[1982 – ]
Série : Les Éphémérides
— Tanger, août 2011,
— Quatre jeunes filles (les baigneuses),
Tanger, août 2011,
— Deux jeunes hommes, septembre 2011,
tirages jet d’encres pigmentaires,
27 x 27 cm.
Acquisition en 2015
S
Lise Sarfati
[1958 – ]
— Ikcha. Colonie de rééducation
par le travail, 1995,
2 tirages couleur,
39,2 x 59,3 cm.
Acquisition en 1997
Malick Sidibé
[1936 – 2016]
— Chemise : Soirée mariage M. Tall,
vers 1962,
18 tirages au gélatino-bromure
d’argent collés sur une chemise
cartonnée 32,5 x 50 cm dépliée.
— Chemise : Soirée mariage / Kodian,
8 novembre 1969,
20 tirages au gélatino-bromure
d’argent collés sur une chemise
cartonnée 32 x 48 cm dépliée.
— Chemise : Baptême enfant / Bassidiki
[Kamité] par / L’Asso Boys,
31 décembre 1968,
18 tirages au gélatino-bromure
d’argent collés sur une chemise
cartonnée 32 x 48 cm dépliée.
— Chemise : J.F. Club,
5 avril 1969,
25 tirages au gélatino-bromure
d’argent collés sur une chemise
cartonnée 32 x 72 cm dépliée.
— Chemise : Les Dauphins,
vers 1962,
20 tirages au gélatino-bromure
d’argent collés sur une chemise
cartonnée 32 x 48 cm dépliée.
Acquisition en 2010
Klavdij Sluban
[1963 – ]
— Série : D’une Amérique l’autre,
Amérique centrale, 2005–2010,
3 tirages au gélatino-bromure
d’argent, 40,5 x 26,5 cm.
Acquisition en 2012
T
Patrick Tosani
[1954 – ]
— Série : Territoire, 2002,
25 tirages à développement
chromogène,
25,7 x 33,7 cm.
— La Grande Nef, 1984,
tirage à développement chromogène,
334 x 242 cm.
Acquisition en 2014
Z
Patrick Zachmann
[1955 – ]
Série : Mare Mater,
— Après le saccage du poste de police
de La Goulette,
Tunisie, avril 2011,
tirage jet d’encres pigmentaires,
80 x 120 cm.
— Oussama, 19 ans, candidat au départ,
Zarzis, Tunisie avril 2011,
tirage jet d’encres pigmentaires,
80 x 120 cm.
— Centre de rétention de Takandja
où les migrants clandestins restent
entre six et dix-huit mois,
Malte, juin 2009,
tirage jet d’encres pigmentaires,
53,2 x 80 cm.
— M. et Mme Bon Zomita, devant
leur maison, dont le fils a disparu
en mer en février 2011,
Zarzis, Tunisie, 2011,
tirage jet d’encres pigmentaires,
33 x 49,8 cm.
Acquisition en 2014

Liste des participations intellectuelles ou techniques, des éditions ou co-éditions d’ouvrages de photographie contemporaine du musée Nicéphore Niépce depuis 2000 :
Esantys ir nesantys :
présents et absents
Photographies de John Batho
Texte de Claire Nédellec
Société des Amis
du musée Nicéphore Niépce,
Association Française d’Action Artistique
[ Ministère des affaires étrangères ],
Ville de Rodez, musée Denys Puech,
2000
Gerald Petit
Texte de François Cheval
Musée Nicéphore Niépce / L’Office,
école nationale des beaux-Arts de Dijon,
2000
John Batho, une rétrospective
Photographies de John Batho
Texte de François Cheval
Éditions Marval,
2001
Sur la route
Photographies de Rajak Ohanian
Texte de François Cheval
Musée Nicéphore Niépce,
2003
Hautes surveillances
Photographies de Mathieu Pernot
Texte de Phillippe Artières,
suivi d’un entretien entre Mellany
Robinson et Mathieu Pernot
Actes Sud,
2004
The New Painting
Photographies d’Elina Brotherus
Textes de Susanna Pettersson,
Andrea Holzherr, Sheyi Antony Bankale
Thames & Hudson,
2005
Le Grand tour
:
Syrie, Liban, Palestine
Photographies de Jean-Luc Moulène
,
Patrick Tosani, Ange Leccia,
Akram Zaatari
Textes de François Cheval,
Alexis Tadie, Elias Sanbar
Isthme éditions / Musée Nicéphore Niépce,
2005
Le Grand Ensemble
Photographies de Mathieu Pernot
Éditions Le Point du Jour,
2007
Peter Knapp
Gabriel Bauret
Textes de Hans-Michael Koetzle,
François Cheval, Catherine Zask
Éditions du Chêne,
2008
Virginie Marnat-Leempoels
Texte de François Cheval
Les Presses du Réel,
2009
Un jour comme les autres
Photographies de Claire Chevrier
Textes de François Cheval, Fabien Danesi,
Jacinto Lageira, Blandine Chavanne.
Silvana Editoriale,
2009
Agonie
Antoine d’Agata
, Rafaël Garido
Éditions Actes Sud / Atelier de Visu,
2009
Yuki Onodera
Textes de Tomoko Okabe,
Kyoji Maeda, François Cheval
Tokyo Metropolitan Museum
of Photography,
2010
The Narrative Void
Photographies de Mac Adams
Textes de François Cheval
et Alexandre Quoi
Éditions le Bec en l’air,
2010
Act
Photographies de Denis Darzacq
Textes de Michel Frizot
et Virginie Chardin
Éditions Actes Sud,
2011
Cabaret New Burlesque
Photographies de Stan Guigui
Texte de François Cheval
Éditions du Chêne,
2011
Il fait jour
Photographies de Claire Chevrier
Textes de Sidi Mohammed Barkat,
Damien Sausset et Pia Viewing
Éditions Loco / Silvana Editoriale
2012
La double exposition du je (fiction)
Jean Le Gac
Textes de François Cheval
et Robert Bonaccorsi
Villa Tamaris Centre d’art,
2012
Ice
Antoine d’Agata
Images en Manoeuvres éditions,
2012
Waterfront
Photographies d’André Mérian
Texte de François Cheval
Arnaud Bizalion éditeur,
2013
Atras del Muro
Photographies de Stan Guigui
Textes de François Cheval
et Michel Philippot
Éditions Images Plurielles,
2013
The disappearence of darkness
Photography at the end
of the analog era
Photographies de Robert Burley
Textes de Gaëlle Morel et Doina Popescu,
Alison Nordström, François Cheval,
Andrea Kunard
Princeton Architectural Press, New York
/ Ryerson Image Centre, Toronto,
2013
Mare mater, journal méditerranéen
Photographies de Patrick Zachmann
Texte de François Cheval
Éditions Actes Sud,
2013
Memory of trees
Photographies de Kathryn Cook
Textes de François Cheval
et Karin Karakasli
Éditions Le Bec en l’air,
2013
Peter Knapp, carnet nº 4
Texte de François Cheval
Auer Photo Fondation,
2013
Odysseia
Photographies d’Antoine d’Agata
Textes de Bruno Le Dantec
et Rafael Garido
André Frère Editions,
2013
Charleroi
Photographies de Claire Chevrier
Textes de François Cheval
et Xavier Canone
Musée de la photographie de Charleroi,
2014
Colles et chimères
Photographies de
Patrick Bailly-Maître-Grand
Textes de Patrick Bailly-Maître-Grand,
Michel Poivert, Héloïse Conesa,
François Cheval, Anne-Céline Besson
Musées de la Ville de Strasbourg,
2014
Expired
Photographies de Ziad Antar
Textes de Akram Zaatari
et François Cheval
éditions Beaux-Arts de Paris
/ Musée Nicéphore Niépce,
2014
Alger, climat de France
Photographies de Stéphane Couturier
Texte de François Cheval
Arnaud Bizalion éditeur,
2014
Jeffrey Silverthorne
Photographies de Jeffrey Silverthorne
Textes de François Cheval
et Joachim Naudts
Kehrer Editions,
2014
Actes : Antoine d’Agata,
une présence politique
Textes de Philippe Azoury, Léa Bismuth,
François Cheval, Xavier Coton,
Jean-Baptiste del Amo,
Christine Delory-Momberger,
Fanny Escoulen, Rafaël Garido,
Fabrice Guenier, Nan Goldin,
Magali Jauffret, Bernard Mercadé,
Bertrand Ogilvie,
Paule Palacios-Dalens, André Rouillé
André Frère éditions,
2014
Algérie, clos comme on ferme un livre ?
Photographies de Bruno Boudjelal
Textes de François Cheval
Éditions Le Bec en l’air,
2015
The Others
Photographies d’Oliver Culmann
Textes de Christian Caujolle,
François Cheval, Christopher Pinney
Éditions Xavier Barral,
2015
Cher Nicéphore...
Douze photographes écrivent
à Nicéphore Niépce
Photographies et textes
de Jean-Christophe Ballot,
John Batho, Elina Brotherus,
Raphaël Dallaporta, Valérie Jouve,
JR, Daido Moriyama,
Mathieu Pernot, Bernard Plossu,
Reza, Patrick Tosani, Sabine Weiss,
Laurent Millet
Textes de Sylvie Andreu,
François Cheval
Éditions Bernard Chauveau,
2015
Denis Brihat :
photographies 1955 – 2012
Textes de Solange Brihat, Alain Paire,
Pierre-Jean Amar, François Cheng,
François Cheval, Didier Brousse
Éditions Le Bec en l’Air,
2015
Sudan Photographs vol. 3
/ A land typology essay
Photographies de Claude Iverné
Textes de Robin Seignobos,
Vincent Francigny, François Cheval
Elnour éditions,
2016
Livres édités dans le cadre des résidences BMW au musée Nicéphore Niépce :
Alexandra Catiere
/ Ici, par delà les brumes
Photographies d’Alexandra Catiere
Texte de François Cheval
Éditions Trocadéro,
2012
Marion Gronier / Les Glorieux
Photographies de Marion Gronier
Texte de François Cheval
Éditions Trocadéro, 2013
Mazaccio & Drowilal / Wild Style
Photographies d’Élise Mazac
et Robert Drowilal
Textes de François Cheval,
Nicolas Heimendinger et Fani Morières
Éditions Trocadéro,
2014
Natasha Caruana / Coup de foudre
Photographies de Natasha Caruana
Texte de François Cheval
Éditions Trocadéro,
2015

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Léon Herschtritt
La fin d’un monde
18 06 ... 18 09 2016
prolongée jusqu'au 25 09 2016
Léon Herschtritt [né en 1936] fut le plus jeune photographe à recevoir le prix Niépce en 1960 grâce au travail réalisé durant son service militaire en Algérie. Humaniste, il n’hésite pas à diversifier ses sujets en développantune sensibilité particulière pour les scènes de rues, la jeunesse des années 1960 et son émancipation progressive, les mouvements sociaux, le peuple gitan…
En partant des archives personnelles du photographe et parfois de négatifs inédits, l’exposition s’articule autour de quatre-vingt photographies offrant une vision d’ensemble de l’oeuvre de Léon Herschtritt dans les années 1960. Autant d’images qui témoignent de la fin d’un certain monde.
Exposition conçue avec le soutien de:
la Société Canson, du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bourgogne Franche-Comté et de la société des Amis du musée Nicéphore Niépce.
La photographie de Léon Herschtritt est une épreuve pour la critique. Les séries s’affichent sans que l’on ait besoin de les déchiffrer. Cela va de soi. Une prostituée racole, un soldat bombe le torse et les amoureux de Paris se bécotent sur les bancs.
On fait aujourd’hui mérite à un photographe de son originalité. Déconcerter est la règle.
Et c’est tant mieux car le conformisme en photographie est sans nuances.
C’est oublier pourtant une des qualités essentielles de ce médium qui est de revoir et de conforter la mémoire. Ici, on retourne sur nos pas. On prend un plaisir certain à réemprunter des voies anciennes. Aujourd’hui, qui se risquerait à dresser le portrait d’un pays, d’une profession, qui se risquerait à figurer la légèreté, la joie de vivre ou la tristesse et le désarroi ? Une photographie qui se fait au gré des humeurs, telle pourrait être la définition simple de l’oeuvre de Léon Herschtritt ? Ce n’est pas si simple. Une épreuve pour la critique ! Car nous sommes mal placés, confrontés à l’agitation d’un présent si mouvementé, pour juger de cette période. Nous revendiquons la liberté du regard et nous ne pouvons nous empêcher de caractériser cette photographie de mélancolique. Mais si nous pouvons un instant refuser le désuet et l’anecdote, nous devons convenir que ce temps-là était en proie au bouleversement. Derrière les apparences futiles, derrière les équivoques, surgissent les prémices d’un avenir sombre, notre présent. En ces temps dits glorieux, dans les années 1960, des nations émergent, une jeunesse se prépare à la rébellion, les grèves se multiplient et le monde se sépare en deux camps. Dans ce qui paraît un cortège de désinvolture, de moments gracieux mais sans profondeur, le photographe rend avant tout compte du mouvement des choses et des hommes. Nous savons aujourd’hui quels troubles ont connus les nations : de la chute des empires coloniaux à la crise de la culture.
Le photographe, faussement humble, rend compte de la fragilité de la société autant que de l’impuissance de la photographie. Ce serait mal connaître Léon Herschtritt que de le voir comme un photographe critique sur son objet. Mais lorsqu’il pose son regard sur un sujet, rien n’est direct. La vision se déplace sur ce qui, apparemment, est accessoire. La photographie ne réside pas dans les réponses qu’elle peut apporter, et offre encore moins des solutions, mais elle interroge ses participants, acteurs ou figurants de ce théâtre. Jamais la photographie n’a été aussi « retorse » pour nous présenter des séries de fausses pistes. Si l’on conçoit cette manière de détourner les choses comme un artifice « humaniste », on se méprend. Léon Herschtritt s’évade de l’évidence tragique, de la démesure et des contrastes accrocheurs pour imposer une photographie lucide, malicieuse et sans acrimonie. Il trouve la juste expression de son travail dans un constat un peu nostalgique, mais acéré et architecturé, sur le fonctionnement des choses et des hommes. Le souci majeur du photographe, c’est la nécessité d’inscrire chaque image dans un récit qui ne doive rien aux grandes oeuvres photographiques qu’il connaît et apprécie. C’est sans honte qu’il exerce le métier de photographe-reporter, confiant dans la qualité brute de l’outil. Les ressources de l’appareil lui suffisent amplement pour exprimer ce qui sourd en profondeur.
Ainsi en va-t-il de l’œuvre de Léon Herschtritt. Elle vit sans à-coup, presque souterraine. La décrit-on, que bien souvent on se méprend. On pense qu’elle rentre dans son déclin. Peu de temps après, on l’exhume. Elle éveille plus que de la curiosité. Et, il est fort possible qu’un jour, elle ne vienne à réveiller l’inquiétude qui l’a fait naître.
François Cheval

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
"L’occident ne perçoit du Darfour comme des mondes lointains que la vitrine médiatisée de l’urgence. Sa représentation théâtrale rapide bruyante et mouvementée, avec sa typologie caractéristique de foule, de cris et pleurs d’enfants se cantonne au visible et audible de l’enceinte des camps. Dans une autre temporalité qui marginalise les enjeux onusiens, le territoire des Four, réel, meut dramatiquement autant qu’inéluctablement vers sa modernité, mais dans une douleur muette de moments ordinaires, instants ruraux, urbains et désormais humanitaires. La vraie violence est dans le silence, la lenteur, l’immobile.
"
Claude Iverné
Depuis 1998, Claude Iverné parcourt le Soudan, un territoire au carrefour du monde arabe et de l’Afrique. Délaissant toute idée préconçue sur le pays et les hommes, il photographie avec humanité un pays baigné d’influences contraires, documente l’intimité d’un peuple mêlé, à l’histoire complexe, à mille lieues des clichés sensationnels qui circulent depuis des années dans la presse. Le photographe choisit de s’affranchir des codes et usages en vigueur. Ses images allient le sentiment politique à l’essai lyrique.
Pour ce travail de longue haleine, Claude Iverné a reçu le prix Henri Cartier-Bresson en
2015.
Il est une manière peu courante d’exercer le métier de photographe chez Claude Iverné. Il refuse d’être vu. Car il est de bon ton désormais que le reportage se conjugue à la première personne. C’est en cela que l’on demeure ici dans une vision « puriste » de la photographie documentaire, dans le refus de l’égocentrisme. Si la réalité est obscure, le photographe s’inscrit dans cette obscurité.
En faisant siens les procédés d’une photographie « ethnographique », Claude Iverné en adopte ses principes. Il ne se satisfait pas du rôle accordé au photographe-reporter, ni d’être le simple porte-voix de populations en « souffrance ». Il s’approprie leurs codes et leurs logiques. Il n’est nullement à la recherche d’un « état de nature ». On se tromperait en l’imaginant traquant la « vérité » d’un peuple. A contrario, son approche n’est qu’une suite d’énigmes.
La raison qui procède à cette photographie n’est en rien explicative. Nous pénétrons au plus près des choses, par leur aspect le plus concret. L’esprit de série nous met en face de matrices et de leurs déclinaisons. Son constat devient le nôtre : une interrogation sans réponses.
Notre époque marque une certaine défiance envers la photographie de reportage. Existe-t-il une alternative à des images dont l’origine n’est que rarement certifiée ? Devant « l’inutilité », ou plutôt, devant l’inefficacité du témoignage photographique, est-il possible de régénérer le langage documentaire ? Il semble qu’en inversant l'ordre du temps, en se séparant de l’urgence, on puisse aborder de nouveaux territoires de la compréhension du monde.
S’il y a bien une tradition qui assure à la photographie en noir et blanc une certaine prédominance sur les autres médias modernes, c’est sans conteste la vertu du silence. Aux flux permanents d’informations, de quelque nature, l’image fixe et monochrome conserve la qualité de l’économie. La retenue, qui devrait être la règle en toutes choses, est pour le moins dans les situations présentées par Claude Iverné, le murmure de la réalité
En bannissant la séduction de l’émotion, tout en fondant une esthétique, le photographe inclut dans cette dernière la possibilité critique du visible et de sa perception. L’attente du spectateur, la pré-vision d’une image humanitaire étant l’« exotisme » contemporain, s’oppose à la seule voie possible de lecture du réel, sa transfiguration. La question de la restitution du réel n’appelle pas nécessairement la réquisition des impressions. Sans logos, l’opérateur dispose d’un outil efficace, son désir de distanciation.
La volonté de restituer « fidèlement » ce monde s’affiche avec la résolution certaine de dépasser l’actualité et bannit avec rudesse les affects. L'observation de la société soudanaise, selon une procédure rigoureuse, amplifie l’impression d’écart entre le traitement du sujet et son urgence. Les images n’apparaissent pas comme des « unica », des objets singuliers, mais se posent devant nous comme de simples éléments d’un jeu complexe. La photographie est un « kriegspiel ».
L’extériorité valide le commentaire. La cécité du photographe vaut celle de Tirésias. Face au désastre, l’opérateur résiste par la maîtrise de l’outil technique. La soumission à l’appareil est le début de la renonciation. L’altérité débute là où le fait technique est assujetti. Claude Iverné maîtrise l’arabe. De là, peut-être, une appréciation du réel qui ne doit rien à la fausse poésie du voyage. L'imaginaire romanesque est le grand absent de ces séries qui n’ont rien de symbolique et de désenchanté, bref, perclus de syndromes rimbaldiens. La pratique de la photographie, à l’imitation de l’apprentissage de la langue, est une initiation permanente aux difficultés, mieux même, aux impossibilités
Depuis que l’on sait que l’Afrique est mal partie, ce continent est sans promesse d’avenir. Il est comme il est. Voilà le propos de Claude Iverné. Contrairement au photographe « traditionnel », imprégné de considérations morales, il ne hisse pas le document au rang de témoignage. Et, amusé par le rôle messianique que l’on veut bien lui assigner, il n’entrevoit ses différentes interventions qu’en se dissociant du reportage traditionnel. Il installe l'idée que ce périple ne révèle rien par lui-même. Il est un leurre, certes, mais le moins trompeur, ici et maintenant.
Les images imprégnées d’une teinte étrange, dans laquelle se fondent les séries, ne suscitent ni fantasme et encore moins le désir de partir. Le récit se concentre sur les failles et les contradictions du biotope. L’enjeu de ce travail est de rompre avec les différents modèles de récit photographique. Evidemment, on ne trouve ni modernisation du mythe (Aux sources du Nil !), ni recherche d’un apaisement personnel. Le Darfour est semblable dans bien de ses aspects à la banalité d’autres territoires.
L’indifférenciation de la matière ne conduit pas la photographie sur la voie de l’abstraction. L’image ménage la nuance. Si elle réfute le contraste, c’est-à-dire, l’organisation simpliste d’une répartition entre le bien et le mal, c’est pour mieux se défaire du drame. La description de la réalité n’enregistre que des moments inqualifiables parce qu’universels. « La façon dont les hommes produisent leurs moyens d'existence, dépend d'abord de la nature des moyens d'existence déjà donnés et qu'il leur faut reproduire. Il ne faut pas considérer ce mode de production de ce seul point de vue, à savoir qu'il est la reproduction de l'existence physique des individus. Il représente au contraire déjà un mode déterminé de l'activité de ces individus, une façon déterminée de manifester leur vie, un mode de vie déterminé. La façon dont les individus manifestent leur vie reflète très exactement ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont coïncide donc avec leur production, aussi bien avec ce qu'ils produisent qu'avec la façon dont ils le produisent. Ce que sont les individus dépend donc des conditions matérielles de leur production. » Karl Marx. F. Engels. 1845. L’idéologie allemande.
Vouloir se confronter au monde par la photographie, une relation médiatisée par un appareil, n’a de sens que si l’expérience est partagée. Ici, elle prend différentes formes, du document publié à la photographie accrochée au mur. Ce qui importe dans la restitution, c’est la situation. Quoi qu'il en soit pour le photographe, si la prise de vue reste le matériau brut, l’indice, nécessaire à tous les commentaires ultérieurs, ces derniers se construisent en fonction de l’intention première. L’événement final se trouve au cœur du parcours photographique.

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
L’ivresse du mouvement
Sport et photographie
13 02 ... 22 05 2016
prolongée jusqu'au 6 juin
Au tournant du 20e siècle, le sport et la photographie s’associent dans la définition de la modernité. Ils ont tous deux en commun l’idée du partage du moment et de l’instantanéité. Précise par nature, proche dans l’action, la photographie va au-delà de l’enregistrement. Elle transpose un instant dont la nature est d’être éphémère. L’exposition présente l’œuvre des photographes d’avant-garde de l’entre-deux-guerres : André Steiner, Jean Moral, Jan Lukas, Pierre Boucher, Isaac Kitrosser, ainsi que la presse sportive illustrée de l’époque.
Ce serait une erreur de penser les multiples représentations du corps comme des excroissances du portrait photographique. Le portrait est une tentative d’approche du profil psychologique. Le corps photographié dans sa saisie directe est un manifeste. Le corps n’a besoin que de lui même pour s’afficher. Le portrait appelle le décor, une accumulation d’attributs, qui le parasite. C’est ainsi que l’on va insensiblement passer d’une image sursignifiée, encombrée d’objets, à une image dépouillée, centrée sur les conséquences de l’effort. La quête du mouvement, qui va faire le bonheur des premières revues photographiques, se retire au profit d’une esthétique sculpturale. Si à l’origine Marey et Muybridge sont utiles à la compréhension du geste, l’espace photographique des années 1930 se confond avec l’art antique de la statuaire et du nu. On se méprendrait à voir dans cette évolution un passage de l’eugénisme de l’éducation physique à une reconnaissance de l’intime. La pratique sociale et collective du sport suspend le soupçon d’indécence de la nudité. Le corps dénudé perd toute signification érotique au profit d’un idéal sociétal.
La gymnastique est à l’origine une pratique sociale réservée à une « élite ». Elle participe d’un art de la représentation de soi. En exhibant ostensiblement ce corps redressé, la photographie célèbre un mode de vie rejetant le laisser-aller et sa soumission aux tentations et aux plaisirs. A la recherche de la perfection du geste, la nouvelle « aristocratie » de l’entre-deux-guerres, tout en s’inspirant de ce modèle eugéniste, voit dans la pratique sportive une adhésion à la modernité débarrassée de l’individualisme. La performance supplante le bien-être et la vie au grand air n’est plus que la continuation des prouesses vues et admirées dans les magazines.
Les nombreuses et nouvelles revues développent sur l’espace des doubles pages la géométrie de la mécanique corporelle. Les manuels d’éducation physique et sanitaire sont relégués à des cercles restreints. Il ne s’agit plus de fabriquer des corps prêts à lutter contre le barbare, le voisin allemand. L’ascèse n’est plus le moteur de la nouvelle conception du corps. La photographie sportive renseigne sur la puissance et la richesse des nations. Cette sensibilité nouvelle, le passage d’un mode de vie à l’exaltation de l’exploit sportif, est à rapprocher du dynamisme de la presse et, en particulier, des développements des techniques de reproduction. La presse se saisit de la photogénie du corps sportif qui n’est rien d’autre que celui d’un demi-dieu, l’héritier d’un héros homérique, surpris au plus près.
Le sport et la photographie s’associent à définir la modernité. Ils ont tous deux en commun l’idée du partage du moment et de l’instantanéité. Précis par nature, proche dans l’action, la photographie va au-delà de l’enregistrement. Elle transpose un instant dont la nature est d’être éphémère. Ce que le magazine des années trente invente n’est rien moins que la transfiguration d’un acte simple en chant épique. L’image mécanique, soutenue par un verbe louangeur, transcende l’événement pour en faire un véritable phénomène collectif.
Dès 1919, ceux que l’on appelait les « préparatistes » souhaitent contribuer au redressement de la France. En 1918, c’est la puissance et la santé d’un peuple qui a vaincu la puissance et la santé d’un autre peuple. Mais, on s’appuie désormais sur l’exemplarité du vainqueur et non plus seulement sur des principes et des vertus. Le caractère spectaculaire de la photographie ne peut se contenter de corps s’ébrouant dans des paysages bucoliques. Il lui faut désormais la théâtralité du stade pour que le corps puisse exprimer ses qualités dramatiques et devenir support de mythes. La photographie devient alors une composante essentielle des idéologies totalitaires.
Autre matérialité de la substance corporelle, la valeur accordée au corps est en même temps une déréalisation du sujet. L’effort est une charge symbolique. L’image de l’anatomie du champion accède au sacré. Enveloppe impérissable, elle s’intègre dans l’histoire longue de l’Occident. Par contre, le corps de l’autre se voit déshumanisé, prêt à être sacrifié. Les magazines de l’Intelligentsia, « Vu » en particulier, n’hésitent pas à associer le corps du prolétaire usé au siècle de l’industrialisation. Le corps n’appartient plus aux individus. Le corps de la modernité photographique est une construction sociale, une fiction


28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Comprendre le photographique. Par cette volonté affichée, le musée Nicéphore Niépce s’affirme plus que jamais comme le musée de la photographie dans toutes ces acceptions. Il met en avant l’unité de la photographie qui, depuis le geste initial de Nicéphore Niépce ne peut se réduire à l’art et à la technique, ou à l’articulation des deux disciplines. Partial dans ses choix, il ne prétend pas à l’exhaustivité et privilégie la relation pédagogique entre l’objet photographique et le spectateur.
« Tous azimuts » présente des acquisitions récentes et inédites. Fruits d’achats et de nombreuses donations, celles-ci viennent à propos rappeler la vocation du musée à rassembler, conserver et diffuser.
Objet protéiforme, la photographie s’expose aux murs, s’insère dans le livre et se déploie dans le magazine. Elle s’affiche impudiquement dans les albums de famille.
Percevoir la photographie dans sa cohérence, et tenter de reconstruire l’archive photographique dans sa globalité, c’est renouer les relations qu’elle entretient avec nos obsessions, nos désirs et nos perversités ; au risque de dresser le panorama halluciné de la fascination de l’humanité pour ce médium.

Objet de promotion
Le pouvoir de démonstration de la photographie en fait dès la fin du 19e siècle un objet de promotion. Mais c’est surtout dans l’entre-deux-guerres que la photographie permet de dépasser l’ancienne réclame fondée sur le texte et le dessin. Vantant les mérites d’un produit, d’une marque ou d’une enseigne commerciale, elle s’affiche sur tout type de support : affiche, catalogue, calendrier, porte-courrier… L’impact de l’image est immédiat ; celle-ci est censée garantir la véracité du message. A l’époque, l’image publicitaire récupère et adapte les expériences plastiques des avant-gardes : photomontages, utilisation de la typographie, de la couleur. Il n’est d’ailleurs pas anodin de remarquer que les plus grands photographes ont travaillé pour la publicité.




En période de guerre
La photographie en période de guerre revêt de multiples aspects. Sa caractéristique principale depuis 1914 est avant tout d’être contrôlée pour être diffusée dans la presse à des fins de propagande. L’image est retouchée, les scènes sont reconstituées a posteriori . La photo devient une arme de persuasion pour rassurer la population (elle ne montre rien) et terroriser l’ennemi (elle le montre décimé). Les régimes totalitaires y ajoutent le culte du chef en inondant les territoires conquis de milliers de portraits solennels et intimidants. Restent les albums souvenirs de soldats, dont les prises de vue étaient toutefois elles-mêmes très encadrées.
La mission du photoreportage, à compter des années 1930, sera de montrer l’envers du décor, ce qui est caché, incarnant la conscience dénonciatrice, celle qui contribuera à changer les choses – en vain. La représentation de l’horreur n’a jamais empêché celle-ci d’exister. Cette horreur peut aussi n’être qu’évoquée à travers la métaphore, la transposition, comme le fait Laurence Leblanc en photographiant en gros plan les figurines de pâte à modeler d’un film de Rithy Panh sur le génocide khmer. Alexis Cordesse recueille lui les témoignages des anciens bourreaux du génocide rwandais qu’il accole à leurs portraits volontairement banalisé. L’image n’est plus une preuve immédiate mais un témoignage pour la mémoire. L’effet n’en est pas moins fort, voire sidérant.



Identifier
La photographie quantifie et mesure ; elle permet de reconnaître, identifier. Elle devient ainsi à la fin du 19e siècle l’auxiliaire précieux de la police. Les portraits commencent à nourrir les dossiers des condamnés et les premières fiches pour répondre à l’obsession de la récidive.
Bertillon met en place le fichier anthropométrique qui s’appuie sur l’image et différentes mesures du corps humain. La méthode est appliquée à des catégories d’individus toujours plus vastes, stigmatisées comme dangereuses ou potentiellement menaçantes : anarchistes, nomades, opposant politiques notamment dans les colonies… En France, les premières cartes d’identité avec photographie sont créées dans les années 1890. Cartes d’identité pour les étrangers, les Français, les fonctionnaires, cartes de travailleurs, visa de sortie, de transit, permis de séjour, Ausweis sous l’Occupation… l’administration recense, répertorie, renseigne, surveille.


Années 1930
Au début des années 30, la photographie s’avance dans l’expérimentation. Elle fait don à la modernité d’un répertoire élargi de formes, de scènes, d’attitudes neuves et fondatrices. Selon le sens d’une évolution artistique, sociale et politique vers la transformation complète du monde, la « Nouvelle Vision » des photographes n’envisage le visible qu’au travers de la géométrie des corps, des matériaux usinés et de la beauté de la machine. Dans la description des corps modernes, dans la photo d’une architecture révolutionnaire, dans la scénographie du portrait, le photographe dégage les images de tout superflu. A présent, nous regardons, admiratifs, l’œuvre commune de la « Nouvelle Vision », qui doit tout aux immigrés allemands et hongrois, aux proscrits, juifs, femmes, communistes, qui ont fait la photographie française et de Paris, le creuset de la rénovation du médium.

Le nu
Au 19e siècle, la photographie perpétue la tradition du nu artistique tel qu’il se pratique dans les beaux-arts. Le corps est traité comme une académie, une étude. La pudeur reste de mise, qui n’empêche pas, malgré la censure, la prolifération de vues érotiques qui font du nu, dès l’origine, la première économie de la photographie. Dès les années 1920, les photographes mettent en avant les qualités plastiques du nu, accompagnant un mouvement général de libération du corps. Celui-ci est photographié en gros plan, fragmenté, épuré ; il devient un pur objet esthétique sculpté par la lumière. Parallèlement, un type de photographie érotique et kitsch continue de circuler sous le manteau (Horace Roye). Aujourd’hui, libérée de la censure, la photographie a évacué les critères de beauté traditionnels et met sur le même plan corps, visage et sexe.




Voir au-delà
La précision de la photographie, vantée dès l’origine, permet de voir au-delà de notre champ de perception. La plaque photographique offre un grand pouvoir de détection ; tout point lumineux peut être capté pourvu que l’intensité ou le temps de pose soient suffisants. C’est ainsi que la photographie a certifié l’existence de certains astres, conjecturée jusque-là uniquement par le calcul. C’est aussi avec une plaque photographique que Röntgen mit en évidence les rayons X en 1895. Utile au progrès de la science, la photographie permet l’observation précise, l’accumulation de détails permettant l’étude et l’identification. Quantité de disciplines médicales s’en emparent, comme la psychiatrie. La photographie est l’instrument devenu indispensable à la démonstration. De là à affirmer qu’elle est une preuve, il n’y a qu’un pas, franchi notamment par certains « spirites » peu scrupuleux…
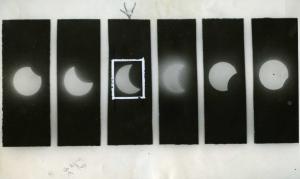

L'imprimé
C’est par l’imprimé que la photographie s’est imposée. D’illustrative dans les journaux du début du 20e siècle, elle fait imploser le magazine traditionnel au lendemain de la Première Guerre mondiale, en faisant du photographe l’acteur principal de la modernité. Le photographe devient reporter. Le monde désormais se voit avec son regard subjectif. La rotogravure va tout modifier et émanciper le photographe du texte. Chaque semaine, le lecteur se voit proposer non plus une simple illustration du monde, mais le monde lui-même. L’image n’est plus seule, elle s’insère dans une série. La double page apostrophe le regard du lecteur. La culture visuelle est née. Ces revues offrent aux photographes une visibilité et aussi leurs premières critiques.

Soutien à la création photographique actuelle
Le soutien du musée à la création photographique actuelle prend différentes formes : acquisitions auprès des photographes et des galeries, aide à un projet ou à une édition ou encore accueil en résidence. Cette dernière permet au photographe de concevoir et matérialiser un projet artistique tout en bénéficiant du savoir-faire du laboratoire photographique du musée pour les tirages. Virginie Marnat-Leempoels peut explorer à loisir les stéréotypes féminins, comme ici celui de la riche américaine trônant dans un intérieur qui dévoile tout de sa classe sociale. Aux antipodes, Jake Verzosa dresse le portrait des dernières femmes tatouées de la tribu des Kalingas aux Philippines. Marion Gronier tente de capter le sentiment d’abandon marquant les artistes de cirque qui passent des lumières de la piste à l’anonymat de leurs loges de fortune. Stan Guigui raconte la misère et la violence du Cartucho, la cour des miracles de Bogota, ou s’invite dans la communauté folklorique des Mariachis… La photographie est universelle ; et c’est une pluralité de regards qui nous est offerte ici.




André Mérian : Water Front
Dans le cadre d’une commande passée par « Marseille Provence capitale européenne de la culture », André Mérian a photographié les ports du bassin méditerranéens, interrogeant une urbanisation sans scrupules, fruit de la spéculation foncière. Il ne peut être question de banalité quand pour la première fois dans l’histoire des temps géologiques, des transformations de cette importance sont apportées à la structure du paysage. Pour le photographe qui choisit de représenter les paysages réels, il y a plus de tristesse à dire ce monde qu’à louer la beauté des points de vue. Dans la tradition d’un Marville ou d’un Atget, il enregistre le passage d’un monde à un autre, nous signifiant la fin d’un mythe.
28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Olivier Culmann
The Others
17 10 2015 ... 17 01 2016
Prolongée jusqu'au 20 01 2016
C'est une étrange galerie de portraits que nous propose Olivier Culmann. L’homme indien défile devant nos yeux, sans pour autant dévoiler son identité réelle…
Amorcée entre 2009 et 2011, années au cours desquelles Olivier Culmann vit à Delhi, puis poursuivie jusqu’en 2013, la série The Others sera présentée pour la première fois dans son intégralité lors de cette exposition au musée Nicéphore Niépce. Avec plus de 130 œuvres, le photographe questionne l’élaboration du statut social à travers la construction de l’image de soi et explore les limites du médium photographique.
The Others
est un travail sur les codes sociétaux de l’Inde et leurs modes de représentation.
Le matériau de base du photographe est une série d’autoportraits. Olivier Culmann y applique sur lui-même les spécificités visuelles et vestimentaires définissant chaque indien. Dans une société aussi cloisonnée que celle de l’Inde, il s’agit de retranscrire la variété des éléments constituant l’identité de l’individu : religion, caste, classe sociale, profession, origine géographique…
Ces portraits se déclinent en quatre phases, selon les différents procédés de création iconographique pratiqués en Inde : photographie de studio de quartier, utilisation de Photoshop par les laboratoires numériques, peinture…
__
Phase 1 : portraits en studio photographique
Les studios représentés dans ces photographies sont des studios de quartier issus de différentes villes d’Inde, notamment Delhi et les régions environnantes, Chennai, Pondichéry et Bombay.
__
Phase 2 : portraits avec utilisation de matériels numériques
Dans les studios photographiques de quartier, il est habituel d’avoir un choix de fonds : rideaux à motifs, photographie murale ou paysages peints à même le mur. Lorsqu’un client vient se faire photographier, il peut généralement aussi emprunter divers vêtements (veste, chemise, cravate…) mis à sa disposition le temps de la prise de vue.
Depuis l’arrivée du digital, des fonds sont créés virtuellement sur ordinateur. Le client, dont la silhouette est préalablement détourée, peut ainsi choisir le fond (fond de studio reconstitué, paysage de montagnes suisse, Taj Mahal…) devant lequel il souhaitera figurer sur la photographie commandée.
Les photographes proposent aussi des photos de corps sans tête, généralement plaisants et bien habillés, sur lesquels il ne reste qu’à déposer la tête du client, préalablement découpée puis replacée par le photographe/retoucheur numérique. Sont également à disposition des corps sans visage (la chevelure et les oreilles restent présents sur le document vendu), des couvre-chefs (chapeaux, bérets, turbans…), des chevelures, des accessoires divers (fauteuils, canapés, bouquets de fleurs…) ou encore des cadres à motifs.
Les portraits de la phase 2 associent ces matériaux numériques aux visages des portraits réalisés initialement.
__
Phase 3 : recomposition et colorisation de photographies déchirées
La réfection de photographies de famille endommagées (par le temps, l’humidité, les déchirures…) est une pratique courante en Inde. Elle est notamment utilisée lors de décès pour restaurer une photographie emblématique du défunt. Celle-ci trône ensuite généralement sur le mur de la maison ou du commerce familiale. Garante de la filiation, sa portée symbolique semble plus importante que la reproduction fidèle des traits physiques de l’ancêtre.
S’appuyant sur cette pratique, Olivier Culmann a donné à différents laboratoires de retouche numérique la moitié d’une photographie déchirée. Il leur a ensuite demandé de reconstituer entièrement le visage, puis de le coloriser à leur convenance. Certains y ont ensuite ajouté un fond.
__
Phase 4 : peintures réalisées à partir de photographies
L’utilisation de la peinture est courante en Inde, notamment pour la réalisation d’enseignes de certains commerces ou, plus traditionnellement, pour la réalisation d’affiches de films.
S’appuyant sur ce savoir-faire, Olivier Culmann a donné à un peintre de Delhi des tirages photographiques - en noir et blanc - et lui a demandé de les reproduire en utilisant différents styles (notamment issus de peintures d’affiches de films). Comme pour les recompositions d’images, il l’a laissé libre dans l’interprétation des couleurs et du fond.
Lors de l’exposition, les toiles originales réalisées par ce peintre seront présentées.
__
Olivier Culmann
The Others
Exposition co-produite avec Tendance Floue et Central Dupon Images.
Avec l’aide de Canson, d’Olympus France, de La Souris sur le gâteau et de l’hôtel St Georges à Chalon-sur-Saône.
Tous les tirages de l’exposition ont été réalisés sur du papier Canson lustré premium 310g par le laboratoire du musée Nicéphore Niépce.
Elle est accompagnée d’un ouvrage à paraître aux éditions Xavier Barral.
The Others
Olivier Culmann
Editions Xavier Barral
Relié, toile
21,5 x 26,3 cm
196 pages
Environ 140 photographies couleur
Textes : Christopher Pinney, professeur d’anthropologie et de culture visuelle à l’University College de Londres, François Cheval, Directeur du musée Nicéphore Niépce et Christian Caujolle, Professeur associé à l'Ecole Nationale Supérieure Louis Lumiere , critique, commissaire d'exposition indépendant.
__
Extraits :
Se vêtir n’est plus, depuis des temps immémoriaux, une nécessité fonctionnelle du genre humain. L’acte s’est métamorphosé en un jeu de conventions sociales. Les apparences décident, pour ne pas dire configurent le réel. Et ces vies fictives qui défilent dans le studio d’un quartier de New Delhi ne sont en rien plus illusoires que les pseudo-images « réelles » qui les ont précédées. Devant ces décors dressés, les seuls objets « incontestables », on redécouvre la consistance de la vraisemblance. En jouant à faire semblant, le photographe exhume le poids du destin qui nous recouvre. Les formes, les couleurs et les textures sont autant de signaux adressés à nos semblables ; dont nous voulons nous différencier ! En face de ce qui semble inéluctable, nous endossons les frusques et adoptons l’attitude que d’autres ont déterminée à notre place.
Chaque photographie, ou plutôt chaque scène, est un événement à la fois dérisoire et d’une grande justesse. Les portraits composent un recueil de nouvelles. Ils n’ont pas la prétention de réduire les différentes composantes de la population indienne à une farce, juste bonne à refléter l’esprit du temps. A la lumière crue du studio, ces vies reconstituées s’élèvent au-dessus de ce réel jamais reconnaissable, à jamais inintelligible. Sachant que nous sommes renseignés sur l’état du monde, plutôt que de recourir au même récit photographique sur le sous-continent indien, Olivier Culmann nous fait grâce de ses impressions fugitives. Délivré des leçons des anciens, il installe ses portraits-prototypes comme des notations, mieux même comme des récits. Les divers éléments de l’image sont des indices à interpréter et à rapprocher d’autres dans l’espoir que le spectateur puisse disposer d’un tissu d’hypothèses. Les objets, apparemment hétéroclites, les postures et les situations forment une chaîne logique à reconstituer.
[…]
Ce que l’on présente au regard d’autrui est un idéal de la figure fantasmée, le sceau de l’identité. L’identification est ici pourtant inséparable de la dissimulation. Le maquillage et les attitudes corporelles de l’acteur redéfinissent la visibilité du personnage. Le sujet, ou la personne, n’est en rien un être « naturel ». Dans cet aller-retour permanent entre normes et recherche d’une identité propre, la personne tente de se constituer en une unité qu’il souhaite cohérente. Cette sommation à l’originalité le pousse à contempler son propre reflet. Dorénavant le miroir est son tirage numérique. Il y cherche sans relâche, comme dans un jeu des sept erreurs, les signes défaillants. Il gomme les imperfections ou s’adjoint des éléments rassurants. L’anxiété règne dans cet univers irréel. On y traque les imperfections allant à l’encontre de l’image de soi tant désirée. Ce souci des apparences, encouragé délibérément par la marchandise, s’oppose à la conscience de soi, à la singularité et à l’autonomie. L'attention particulière que l'on porte à sa personne est soutenue par les technologies modernes. L’identité numérique se construit dans les espaces de communication où chacun se contemple, de manière narcissique, dans un enfermement intérieur. La relation à autrui sera une quête jamais satisfaite. Et la photographie, malgré son immense ambition, n’y pourra rien.
[…]
Deux extraits du texte de François Cheval publié dans The Others.

Olivier Culmann : Biographie
Le conditionnement social et le libre-arbitre habitent l’œuvre d’Olivier Culmann. À cheval entre l’absurde et le dérisoire, son œuvre analyse avec une acuité millimétrée la question de nos vies quotidiennes et de nos rapports avec les images. Revenant sans relâche sur ses obsessions – et les nôtres –, il nous emporte par son humour et son art de la narration.
1993 – 1999 : Il réalise, en collaboration avec Mat Jacob, le projet Les Mondes de l’école qui obtient la bourse de la Villa Médicis Hors Les Murs en 1997
2001 :
Parution de Les Mondes de l’école
, éditions Marval
Parution de Une vie de poulet
, éditions Filigranes
2003 : Prix Scam Roger Pic pour sa série « Autour, New York 2001 – 2002 »
2004 : Parution de Intouchables , éditions Atlantica
2006 : La série « Watching TV » présentée aux Rencontres internationales de la photographie d’Arles
2008 :
Exposition de la série « Les Mondes de l’école » à la Tour Eiffel à Paris.
3e
prix World Press Photo pour sa série « Watching TV » (catégorie « sujets contemporains »)
2011 :
Parution de Watching TV
, éditions Textuel
Exposition « Watchers » au Pavillon Carré de Baudouin à Paris
2014 : Expositions The Others et Diversions au Festival Images à Vevey en Suisse
2015 :
Exposition The Others
au musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône
Parution de The Others
, éditions Xavier Barral

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English

Nicéphore Niépce en héritage
17 10 2015 ... 17 01 2016
250 ans après sa naissance, et près de deux siècles après les premières expérimentations qui conduisirent à l’invention de la photographie, que reste-t-il du personnage de Nicéphore Niépce ? Son geste fondateur continue de fasciner et d’inspirer les artistes actuels.
On sait que l’homme était talentueux, doté d’une intelligence activée de curiosité. La vie de chercheur et d’inventeur de Nicéphore Niépce offre en effet un exemple saisissant d’opiniâtreté et de ferveur. Tenace, il aborde l’expérimentation en naïf, empiriquement. Pour lui, la photographie, l’image mécanique, est un nouveau continent : « Je suis comme Colomb lorsqu’il pressentait (sic) la découverte tardive, mais certaine d’un nouveau monde… Nous avançons la sonde à la main, sur notre nacelle aventureuse ; et bientôt l’équipage s’écriera avec transport… terre ! terre !
[1]
»
[Lettre de Nicéphore Niépce à Alexandre du Bard de Curley, « Au Gras, le 24 mai », BnF, fonds Janine Niépce.]
La terre est atteinte dès 1824 avec la mise au point de l’héliographie. Enfin, l’action de la lumière sur une surface sensibilisée permet de reproduire et fixer spontanément une image captée dans une chambre noire. Le Point de vue du Gras
, réalisé par Niépce vers 1826 – et considéré comme la plus ancienne photographie actuellement conservée
[2]
- consiste en une plaque d’étain sur laquelle Niépce a réussi à « enregistrer » le paysage vu depuis sa fenêtre à Saint-Loup-de-Varennes, aux environs de Chalon-sur-Saône.
[Coll. Harry Ransom Center, The University of Texas, Austin.]
L’objet légué par Nicéphore Niépce, sans antécédents, fait de nous le peuple de l’image, habitants d’un nouveau continent observé par lui seul. Mais dans les contrées incertaines de la culture contemporaine, l’intervention de Niépce a pris une telle importance qu’elle est la définition même de la modernité. On n’en mesure pas encore les effets, mieux même, les conséquences étranges. Cette fenêtre ouverte est en fait la boîte de Pandore, que ne cessent d’explorer les héritiers du génial inventeur.
C’est à ces derniers qu’est consacrée cette exposition. De Paolo Gioli à Daido Moriyama, elle montre comment la création contemporaine s’est emparée à la fois du personnage auquel elle rend hommage, mais aussi du résultat de ses expérimentations qu’elle n’hésite pas à réinterpréter.
La dévotion de Daido Moriyama pour Niépce l’a ainsi conduit à un véritable pèlerinage sur les traces de l’inventeur, de Saint-Loup à Austin au Texas. « Dès que je me suis retrouvé face à ce paysage [Saint-Loup-de-Varennes], les images d’ombre et de lumière de la photographie iconique de Niépce ont commencé à se substituer au paysage réel devant mes yeux et, soudain, j’ai eu la sensation de voir à travers les yeux de Niépce. » Une reproduction du Point de vue du Gras est accrochée au dessus du lit dans la chambre à coucher spartiate du photographe « pour ne pas oublier les origines et l’essence de la photographie. »
Cette image tant de fois - mal – reproduite, habite l’inconscient de chacun. Elle transparait dans une photographie de Bernard Plossu prise au hasard d’un voyage au Portugal, depuis la fenêtre du train où celui-ci a pris place.
C’est encore ce même Point de vue qui inspire à Andreas Müller-Pohle ses Digital Scores (after Nicéphore Niépce) . Numérisé, Le Point de vue du Gras renaît sous sa forme codée, une suite de signes alphanumériques. Tandis que Raphaël Dallaporta se sert du code secret et chiffré employé par Niépce et Daguerre dans leurs correspondances dès 1830. Travaillant à partir de fichiers numériques d’héliographies de Niépce, il applique ce cryptage aux codes sources de ses fichiers, endommageant les images.
L’outil informatique omniprésent désormais permet de réinterpréter l’œuvre de Niépce de la façon la plus mathématique à la plus loufoque. Joan Fontcuberta
recompose le Point de vue du Gras
sous forme de photomosaïque. Olivier Culmann
transforme le portrait posthume de Niépce, peint par Léonard François Berger
[1]
, en portrait de studio indien
[2]
, abusant de la retouche numérique.
[Peint en 1854, plus de vingt ans après la mort de son modèle, ce tableau est conservé au musée Nicéphore Niépce.]
[En référence à sa série The Others
, réalisée en Inde, qui fait l’objet d’une exposition au même moment au musée Nicéphore Niépce.]
L’hommage de Patrick Bailly-Maître-Grand tient quant à lui dans sa redéfinition constante des fondements de l’image mécanique qu’il adosse à l’histoire scientifique de la photographie. Son crédo est de découvrir et expérimenter les techniques anciennes. Avec les Gouttes de Niépce , il réalise des prises de vue de paysages à travers des gouttes de gélatine faisant office de lentille, qu’il superpose avec l’image des mêmes paysages floutées. « Il faut percevoir en ce bricolage laborieux une quête nostalgique des années primitives de la photographie quant tout était à découvrir avec une boîte, un bout de verre, de la chimie et du hasard. »
Cette manipulation du medium photographique est au centre du travail opéré par Paolo Gioli
en hommage à Niépce. A la fin des années 1970, il s’empare du polaroid, expérimente ses potentialités à la manière d’un découvreur du passé, réinterprétant les images iconiques de Niépce à travers des matières nouvelles.
Cette pluralité de regards portés par des photographes aux origines et parcours singuliers, démontre la richesse de l’héritage laissé par Nicéphore Niépce.
Artistes exposés :
Patrick Bailly-Maître-Grand (France, 1945)
Lars Kiel Bertelsen (Denmark)
Alexandra Catière (Belarus, 1978)
Olivier Culmann (France, 1970)
Raphaël Dallaporta (France, 1980)
Joan Fontcuberta (Spain, 1955)
Ralph Gibson (United States, 1939)
Paolo Gioli (Italy, 1942)
JH Engström (Sweden, 1969)
Daido Moriyama (Japan, 1938)
Andreas Müller-Pohle (Germany, 1951)
Bernard Plossu (France, 1945)
Emmanuelle Schmitt-Richard (France, 1968)
Exposition réalisée grâce au soutien du Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne et de la Société des Amis du Musée Nicéphore Niépce,
et avec la participation du Centre Georges Pompidou - Musée national d’art moderne, du FRAC Champagne-Ardenne et de la galerie Jean-Kenta Gauthier.

En marge de l’exposition :
12 photographes rendent hommage à Nicéphore Niépce, dans une lettre, accompagnée d’un cliché qui fut leur « première photographie » ou celle qui les a fait devenir "photographe".
Ces témoignages sont réunis dans le livre :
« Cher Nicéphore… »
Editions Bernard Chauveau
Textes de Sylvie Andreu, François Cheval, et des photographes : Jean-Christophe Ballot, John Batho, Elina Brotherus, Raphaël Dallaporta, Valérie Jouve, J.R., Mathieu Pernot, Bernard Plossu, Reza, Patrick Tosani et Sabine Weiss.
48 pages
ISBN : 978 2363061515
20 €
(à paraître / octobre 2015)

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Rudolf Koppitz
[1884-1936]
13 06 ... 20 09 2015
Héritière du Jugendstil viennois et du Pictorialisme, la photographie de Rudolf Koppitz [1884-1936] magnifie le corps en mouvement, dans d’élégantes compositions devenues des icônes de l’histoire de la photographie. L’exposition "Rudolf Koppitz [1884-1936]" est la première grande rétrospective consacrée au photographe en France. Conçue par le Photoinstitut Bonartes de Vienne, elle rassemble près de 130 photographies et documents pour une unique présentation au musée Nicéphore Niépce.
En 1929 parait pour la première fois un article sur la photographie artistique dans l’Encyclopaedia Britannica . Il est illustré d’une photo de Rudolf Koppitz, Étude de mouvement : on y voit s’avancer trois femmes drapées de noir devant lesquelles une quatrième jeune femme, nue, se penche en arrière dans une attitude élégante et maîtrisée. Cette photo, devenue une véritable icone incarnant à elle seule la photographie d’art, semble émaner d’un temps révolu au moment où la modernité se conjugue sur le mode de la Nouvelle Vision et du Surréalisme.
C’est dans ce contexte que Rudolf Koppitz (1884-1936) va pourtant devenir l’une des principales figures du pictorialisme viennois. Ce mouvement international, né dans les années 1880, portés par des amateurs fortunés réunis dans des clubs, revendique pour la photographie le statut d’art à part entière. Pour ce faire, il met en avant des techniques de tirage dites « nobles », inspirées de la peinture et des arts graphiques : tirages pigmentaires, à la gomme bichromatée, à l’huile… Réfutant la reproduction purement mécanique du réel, les pictorialistes stylisent, interprètent, floutent.
Koppitz sera l’un des représentants de cette esthétique. Sa position d’enseignant puis de directeur du département de photographie à la Graphische Lehr- und Versuchsanstalt de Vienne (Institut des arts graphiques appliqués) lui permettra d’exercer une influence certaine sur la création photographique viennoise. Sa participation à de multiples expositions, y compris en tant que membre des comités de sélection, assiéra son autorité dans le milieu de la photographie d’art.
Les thèmes abordés par Koppitz tout au long de sa vie, témoignent de son goût pour la nature et pour l’exercice physique, dans une pleine adhésion aux principes du naturisme apparu au tournant du siècle. Ses mises en scène de nus, y compris de son propre corps, répondent à une recherche esthétique de force et de pureté.
Au début des années trente, Koppitz délaisse les effets pictorialistes et adopte un style a priori plus documentaire bien que soigneusement mis en scène. Il parcourt la campagne, à la recherche d’une authenticité paysanne. Les images de la « Heimat » autrichienne suscitaient alors un intérêt croissant, directement lié à une volonté de développer le tourisme : l’Etat voulait montrer une patrie idéalisée, un pays aux beaux paysages alpins, garant des traditions. [Le terme « Heimat » n’a pas d’équivalent en Français. Il renvoie tout à la fois à la notion de patrie, de terre natale, de pays, évoquant également le lieu où l’on se sent « chez soi ».]
Le vocabulaire esthétique utilisé par Koppitz ne manquera pas d’être récupéré par le pouvoir austro-fasciste et par les tenants du national-socialisme. Les opinions politiques de Koppitz, mort deux ans avant l’Anschluss, restent toutefois ambigües. On connaît davantage celles de son épouse, Anna, une photographe qui fut aussi son assistante, et qui fit de nombreux clichés de la jeunesse autrichienne dont l’esthétique rappelle les mises en scène de Leni Rifenstahl. En continuant d’exploiter l’œuvre de son époux après 1936 et en y associant ses propres photographies, et par ses liens avérés avec le régime nazi, celle-ci a sans doute contribué à ternir durablement la réputation de Koppitz.
Rudolf Koppitz était-il naïf ou seulement guidé par une quête artistique et esthétique ? Ses œuvres à la beauté intemporelle et théâtrale lui valurent en tout cas les éloges de ses contemporains et un engouement pour ses photographies de nus et de danse qui perdure encore aujourd’hui


BIOGRAPHIE
Rudolf Koppitz naît le 3 janvier 1884 en Silésie autrichienne (dans l’actuelle République tchèque) dans une famille germanophone.
1897–1907
Le jeune Rudolf entre comme apprenti dans l’atelier du photographe Robert Rotter à Freudenthal. En 1901, le jeune homme, qui a alors 17 ans, passe son certificat d’aptitude professionnelle et obtient un emploi dans l’atelier de Florian Gödel, dans le chef-lieu du district d’Opava. Un an plus tard, il s’installe à Brno, où il travaille comme retoucheur sur positif et négatif dans le célèbre atelier de Carl Pietzner.
1908–1911
Koppitz travaille les années suivantes chez plusieurs photographes à travers tout le pays. Il s’installe à Vienne en 1911. Ses premières photographies datées, prises durant ses loisirs, remontent à 1908 ; elles représentent les églises des Minimes et Saint-Charles-Borromée à Vienne, des paysages pittoresques ou des chaînes de montagnes escarpées. Son style est influencé par la peinture et le graphisme de l’Art nouveau et de la Sécession viennoise, ainsi que par les photographies du mouvement pictorialiste qu’il a dû découvrir dans les expositions à Vienne. On ne lui connaît cependant pas de lien direct avec ces différents mouvements.
1912–1913
À 28 ans, Koppitz donne à sa carrière de photographe une nouvelle direction en allant suivre une formation à l’Institut des arts graphiques appliqués de Vienne. Il y suit les cours spécialisés de Novák sur le portrait photographique artistique. Le goût prononcé de Novák pour l’ornement et sa prédilection pour les compositions stylisées ainsi que sa façon de répartir les surfaces en aplats clairs et sombres marquent durablement Koppitz. Ce dernier est nommé dès 1913 assistant pour « la photographie de portraits et de paysages et les retouches ». Il travaille de préférence avec les techniques de tirage nobles, qu’il continue de perfectionner, et photographie des sujets typiquement pictorialistes : des paysages enneigés, des arbres, des vedute , des scènes paysannes romantiques et de nombreux portraits. Il effectue quelques voyages, notamment en Hollande et en Italie, où il fait de nombreuses photos.
1914–1918
Mobilisé dès le début de la guerre, Koppitz doit interrompre son activité d’assistant. Il est versé comme sergent dans une compagnie d’aviateurs et nommé « maître assistant pour la photographie de terrain ». Il sert d’abord sur le front oriental avant d’être muté au centre de formation des photographes de reconnaissance de Wiener Neustadt. De cette époque, nous conservons des photos représentant le front de Galicie, que Koppitz romantise dans son style caractéristique. À l’opposé, les vues prises depuis l’avion, sobres compositions géométriques et modernes, se distinguent nettement du reste de ses travaux.
1919–1927
À la fin de la guerre, Rudolf Koppitz reprend son poste à l’Institut des arts appliqués. Il y est d’abord « maître assistant pour les retouches », puis est nommé enseignant en 1920. Il entre à la Société Photographique. En 1924, sa première grande exposition personnelle a lieu à la Chambre de commerce de Vienne. Il commence dès lors à participer activement aux expositions : jusqu’à sa mort, près de 60 expositions collectives montreront ses travaux en Autriche et à l’étranger.
A l’Institut, il rencontre Anna Arbeitlang, qui y est assistante depuis 1917. Ils se marient durant l’été 1923. C’est en collaboration avec sa jeune épouse que Koppitz réalise ses premiers nus.
Début 1925, Koppitz réalise son œuvre la plus réputée, Bewegungsstudie (Etude de mouvement), qui connait un succès international. Durant cette phase de création, il travaille avec diverses danseuses. Il photographie notamment plusieurs fois les membres de la troupe de danse russe du « Ballet plastique Issatschenko ».
1928–1929
Koppitz ne participe pas seulement à des expositions internationales de photographes amateurs, il décide aussi, comme membre de comités, de la participation d’autres collègues à ce genre de manifestations. De par sa présence dans la rédaction du magazine Der Lichtbildner et ses nombreuses contributions photographiques dans d’autres magazines spécialisés tels que Photo- (und Kino-)Sport ou Photographische Korrespondenz, il exerce une influence sur le milieu de la photographie contemporaine en Autriche.
1930–1935
En 1930, l’exposition internationale « Film und Foto » (FiFo) est présentée à Vienne. Le style de Koppitz change : en lieu et place des compositions symbolistes apparaissent plus de clichés à caractère documentaire et objectif. Il n’utilise plus les procédés de tirage nobles et s’éloigne du flou pictorialiste. Ses motifs de prédilection restent la vie paysanne, les scènes campagnardes et les sujets sportifs.
1936
« Land und Leute » (Le Pays et le Peuple), l’exposition la plus complète de Koppitz, mais aussi la dernière, est inaugurée au Musée des Arts appliqués (actuel MAK) de Vienne en février 1936. Plus de cinq-cents pièces y sont exposées sur des sujets essentiellement agraires.
Rudolf Koppitz meurt le 8 juillet 1936, à l’âge de 52 ans. Anna Koppitz administre son héritage et continue de travailler en tant que photographe, surtout pendant la période nationale-socialiste.

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Blanc et Demilly
le nouveau monde
13 06 ... 20 09 2015
De 1924 à 1962, Théodore Blanc et Antoine Demilly tiennent l’un des studios les plus en vue de Lyon. Portraitistes reconnus, ils consacrent leur vie à la photographie, se partageant entre une activité commerciale traditionnelle, et une pratique créatrice, inventive et féconde.
Depuis près de quarante ans désormais, la fille d’Antoine Demilly s’attache à rassembler l’œuvre de son père et de son associé, ensemble dispersé, mis au rebut au lendemain de la cessation d’activité du studio en 1962. L’époque n’est pas à la conservation ; la photographie n’intéresse pas encore les institutions françaises, encore moins sous la forme a priori banale d’une production locale. La tâche s’avère immense tant Blanc et Demilly furent prolixes. Des milliers de portraits sont sortis de leur studio où la bourgeoisie lyonnaise comme les artistes d’avant-gardes avaient leurs habitudes. Les travaux personnels des deux photographes sont tout aussi foisonnants. La variété des sujets, dont l’identification s’est souvent perdue, témoigne des goûts éclectiques des deux acolytes qui, ayant parfois travaillé séparément, refusèrent presque toujours de voir leurs noms dissociés.
L’exposition présente une partie de ce fonds reconstitué, en l’état. Les tirages originaux, altérés par le temps et l’abandon, sont difficilement datables. Les années 1930 se mêlent aux années 1950, unies dans une même recherche de poésie iconographique.
Amoureux de la belle image et à l’écoute du progrès, Blanc et Demilly varient les expressions, passant des accents pictorialistes au vocabulaire de la Nouvelle Vision. Leur usage précoce du Rolleiflex et du Leica, si maniables, leur confère une liberté de mouvement sans égale. Ils arpentent les rues de Lyon, les bords de Saône, la montagne et la campagne environnante où, tout à leur passion, ils n’hésitent pas emmener des groupes de photographes amateurs.
Si l’activité du studio est essentiellement tournée vers le portrait qu’ils modernisent en l’épurant de tout décor, leur curiosité, leur goût de l’expérimentation les poussent à investir tous les sujets, du plus poétique au plus formel. Blanc et Demilly revendiquent une pluralité de regards, tous soumis à l’émotion. Pour capter la vie dans ce qu’elle a de plus pittoresque, de plus inattendu, le sujet peut n’être qu’un rien, une ombre dont les lignes sobres et nettes sont traduites par une composition simple, presque abstraite, qui lui confère de la beauté, comme s’il s’agissait d’élever le banal au métaphorique. Ils mettent au jour des objets latents, des formes dans les lueurs étranges et les brumes vaporeuses du petit matin ou du crépuscule. Ces simulacres « atmosphériques » sont des filtres. Ils ont pour fonction de nous conduire à dépasser la réalité brute pour accéder à une certaine poésie visuelle. Le regard est appelé à s’égarer dans l’espace de l’image.
Ces photographies sont parfois déroutantes. Blanc et Demilly y collectionnent les lieux d’un « nouveau monde » dont il n’est pas nécessaire de connaître l’histoire. Ce qui est dissimulé là, silencieusement, fait partie de ces choses qui ne s’expriment que dans la promenade ou la solitude.
Mais cet éclectisme apparent n’est pas dispersion. Chaque image confirme qu’en allant au-delà de la simple vision, on peut apercevoir ce dont elle dispose de mystère et de beauté. Pour Blanc et Demilly, ce qui est accessible aux sens donne vie à une certaine vérité. Les photographies enregistrent et transmettent des vibrations, les moments indéterminés de la sensualité du monde. Elles sont des reflets. D’image en image, on débouche sur du nouveau. L’errance photographique, entre objets, portraits et paysages n’est qu’une pratique vagabonde et perturbatrice du regard. La modernité photographique offre cette possibilité de multiplier les points de vue, c'est-à-dire les expériences d’un « nouveau monde », une exploration du proche qui est aussi une connaissance de nous-mêmes.
Exposition conçue à partir du fonds constitué par Julie Picault-Demilly et coproduite avec Stimultania
, pôle de photographie.
Stimultania programme chaque année des expositions, résidences, actions de médiations, concerts et rendez-vous culturels variés.
Un livre accompagne l’exposition :
Blanc et Demilly, le nouveau monde
Textes de François Cheval, Céline Duval et Xavier Fricaudet
éditions Lieux Dits, Lyon, 2015
120 pages - 85 illustrations
ISBN : 9782362191183
27,00 €
Blanc et Demilly en quelques dates
Théodore Blanc (1891 – 1985)
Antoine Demilly (1892 – 1964)
1924 : Théodore Blanc et Antoine Demilly s’associent sous le nom « Blanc et Demilly » et reprennent le studio de leur beau-père Edouard Bron, photographe portraitiste à Lyon.
1933 : Ils participent à l’exposition « L’image photographique de Daguerre à nos jours » à la galerie Braun à Paris.
1933 – 1936 : Parution des Aspects de Lyon : 121 héliogravures réparties en dix fascicules.
1935 : Ils créent l’événement en inaugurant à Lyon l’une des premières galeries entièrement dédiées à la photographie. Ils y exposent les images d’amateurs ainsi que leurs propres travaux.
1938 : Ils obtiennent la médaille d’or dans la catégorie Portrait lors de la XVème exposition de la photo et du cinéma à Paris.
1942 : Parution de Charme de Lyon , illustré de cent-vingt sept de leurs photographies.
1947 : Ils exposent pour la première fois au Salon national de la photographie à la Bibliothèque nationale. Ils y participeront jusqu’en 1959.
1951 : Fermeture de leur galerie.
1962 : Vente du studio Blanc et Demilly, après quelques années de déclin. Le fonds de tirages est dispersé.
28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Patrick Zachmann
Mare, Mater
14 02 ... 17 05 2015
A travers l’image fixe et l’image animée, Patrick Zachmann confronte son histoire familiale à celles des migrants d’aujourd’hui. Il aborde leur rapport à la mer qu’ils traversent et à la mère qu’ils quittent. Le récit s’élabore autour de cette relation entre mère et fils, homme et femme.
Il s’agit d’un voyage, un voyage de mémoire et d’exils. Ce voyage tisse le fil de toutes les destinées que je croise; celles des migrants quittant leur pays de la rive sud de la Méditerranée, fuyant le chômage, l'ennui, l’absence d’avenir; celles des femmes, des mères, qui les laissent partir ou découvrent qu’ils sont déjà partis. Et moi, je pars à la recherche des racines de ma mère, celles qu’elle a voulu oublier.
Etalée sur une période de deux ans, cette aventure, partie de Marseille, m'a mis sur les pas d'Issam, jeune migrant algérien d'Annaba, arrivé depuis plusieurs mois sans papier, mais déjà dans un centre d'insertion ; puis de Nizar, Tunisien clandestin que j'ai connu dans la rue, tout juste arrivé de Lampedusa, dans un bateau de fortune. Ils racontent tous deux leurs périples mais surtout, les raisons de leur départ et, chacun à leur façon, le manque de leur mère. Cette mère, qui dans la culture judéo-arabe, est omniprésente, sacrée. En filigrane, on comprend qu'au delà de la misère, ils ont fui aussi un mode de vie, un étouffement et au final peut-être bien ces mères qui les adorent (qui les aiment trop?).
J'ai été là-bas, d'où ils viennent, pour comprendre et pour rencontrer leurs mères, qui racontent à leur tour ces départs, ces déchirements, cette longue séparation.
C'est l’histoire de la Méditerranée, l’histoire de la mer, l’histoire des mères. Parfois, les fils ne reviennent pas. Parfois, les fils périssent en mer. Et puis il y a aussi le rêve, le fantasme. Le rêve d’une Europe qui ne sera jamais aussi belle, aussi accueillante, aussi riche que vue de l’autre côté.
Ce projet est né également de la certitude d’avoir à affronter dans un temps proche la séparation définitive d’avec ma mère très âgée et malade. Sa disparition rendra impossible à jamais le comblement de ses silences sur son histoire. Cette séparation particulière d’un fils avec sa mère, à laquelle je me prépare, résonne avec la séparation que les migrants clandestins, que j'ai filmés et photographiés, imposent à la leur, traversant la mer au péril de leur vie pour gagner l'occident.
J’ai commencé à l’interroger et à la filmer, âgée de 90 ans et atteinte d’un début d’Alzheimer. Elle ne se souvient pas de grand chose et encore moins de détails concernant l'Algérie, mais se souvient à quel point elle voulait oublier.
Je n’avais ni photos- un comble pour un photographe-, ni récit de l'histoire familiale du côté de ma mère, juive séfarade. Elle voulait oublier l’Algérie, la pauvreté, oublier ses origines.
Aujourd’hui, je fais le voyage à l’envers. Je fais le voyage des origines perdues, de la part manquante, tue, cachée.
Je suis convaincu que c'est pour faire l'album de famille qui me manque, aussi bien du côté de ma mère, que de mon père dont les parents ont été déportés à Auschwitz Birkenau, que je suis devenu photographe. Pour me fabriquer des souvenirs.
Ce projet est donc le récit entremêlé de mes rapports difficiles avec cette mère dont j’ai voulu très jeune échapper à l’emprise et que d’une certaine façon je retrouve avant sa disparition annoncée, et la traversée de la mer au péril de leur vie de tous ces jeunes migrants qui laissent leur mère folle d’inquiétude sur le rivage de leur enfance. Les passerelles entre ces deux mondes, font écho à une réflexion sur les fondements de mon travail de photographe et de journaliste, sur mes rapports avec le temps et la mémoire, et sur ma quête perpétuelle d’identité.
Mer, mère, mare, mater… Une fois de plus mon travail photographique fait écho à ma propre histoire et tente d'en remplir les vides.
Patrick Zachmann
Exposition co-produite avec Magnum Photos dans le cadre de Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture et
Fotografia Europea, Reggio Emilia 2014.
Elle a reçu le soutien de la société CANSON et du ministère de la Culture et de la Communication.
Un livre accompagne l’exposition :
Patrick Zachmann, Mare Mater, journal méditerranéen
, préface de François Cheval, éd. Actes Sud, 2013.
ISBN : 978-2-330-02395-9
Prix : 39 € TTC


Patrick Zachmann : Biographie
Patrick Zachmann (né en 1955) se consacre depuis 1976 à des projets au long cours mettant en lumière la complexité des communautés dont il questionne l’identité, la mémoire et la culture. Après s’être plongé en 1982 dans l’univers violent de la police et de la mafia napolitaine, il se lance dans un longue réflexion personnelle sur l’identité juive : Enquête d’identité. En 1989, son reportage sur les événements de la place Tienanmen est largement repris par la presse internationale. Il reçoit le Prix Niépce. Son travail est celui d’un photographe-voyageur interrogeant les traces de l’Histoire ou en quête d’objets persistants.
Patrick Zachmann est membre de l’agence Magnum.
28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Durant de nombreuses années, l'historien et théoricien de la photographie Michel Frizot a collecté des images délaissées parce qu’elles étaient le fait d’anonymes, d’inconnus, d’amateurs, d’auteurs non proclamés ou non célébrés, traversant tout le champ historique de la photographie.
Echappant à la muséification et à la classification, glanées avant tout pour leur capacité d’étonnement, elles n’en sont pas moins généreuses, émouvantes et peut-être plus «photographiques» que d’autres.
C'est à une réflexion sur la part énigmatique de toute photographie que nous convie cette exposition.
Les images photographiques, parce qu’elles nous sont si familières, parce qu’elles sont partie prenante de notre espace visuel, passent pour immédiatement accessibles et intelligibles. Mais chacun aura éprouvé ce bref sursaut d’étonnement qu’elles suscitent : la suspension des mouvements, le rendu des couleurs, les coïncidences inattendues, les expressions brutalement figées, dès lors que nous y portons attention, provoquent le sentiment que nous sommes devant une interrogation tout autant que devant une forme d’évidence. Du reste, lorsque nous pouvons regarder une photographie aussitôt après l’avoir « prise », nous éprouvons d’emblée la distance entre ce que nous rapporte l’image et ce que nous avons pu observer de visu dans l’instant qui précédait. Et le constat de cette divergence assumée à chaque instant est propre au phénomène photographique. Nous reconnaissons à toute photographie une part de vérité, mais nous en soupçonnons l’indétermination, nous en pressentons les contradictions.
L’image photographique est un complexe d’interrogations pour le regard, car elle propose au regardeur des formes et des indices qu’il n’a jamais perçus sous cette apparence-là et qui sont en désaccord avec son registre de vision naturelle.
L’énigme serait donc constitutive du fait photographique en soi. Il ne s’agit ni d’un jeu d’esprit ni du mystère induit qui procéderait d’un effet esthétique, d’un style, d’un talent particulier, d’une incongruité délibérée (toutes choses qui adviennent aussi dans les photographies). Inhérente au processus photographique, elle résulte de la distance irréductible entre les sens humains et la captation photosensible d’un appareil, elle nait de la rupture entre la perception visuelle et le processus photographique.
Toute photographie fait énigme pour le regard.
Qu’elles soient entreposées dans les archives, dans les albums de famille, les agences de diffusion, ou jetées à la rue, les photographies sont des objets virtuels qui ne commencent à exister qu’en rencontrant un regardeur. La collecte sélective s’effectue donc « au regard », non pas le regard du connaisseur ou de l’historien mais le regard paradoxal qui s’insinue à contre-courant des critères de la « bonne » photographie canonique : un regard lent qui se laisse aller au plaisir de l’élection, à la poursuite de l’étrangeté irremplaçable. Un regard obstiné, en quête de ce qu’il ignore encore et, pourtant, perçoit comme la mise à nu du « photographique », l’échappée libérée dans le photographique « pur », dépouillé de ses éloquences. En réitérant les sélections, le regard découvre des propriétés inconnues de l’image photographique. Il repère des qualités d’énigme qui doivent se savourer dans le suspens de toute résolution. A bien y regarder, et comme un exercice d’application, ces photographies-là paraissent plus photographiques que tant d’images aux attraits convenus, bien vite émoussés. Elles ouvrent sur ce qui nous échappe dans la reconnaissance du monde, au-delà de ses figures photographiques répétées à satiété.
Se souvenir que la réponse à l’énigme du Sphinx, c’est l’homme : regarder une photographie, c’est aller à la rencontre de soi-même et de l’espèce.
Par l’écart et la discordance entre ce qu’elle exhibe et ce que nous éprouvons, la photographie témoigne plus que tout, à tout instant, de ce qu’est « être humain ». Et la part d’énigme d’une photographie est bien celle de notre présence au monde.
Michel FRIZOT
Extrait de « Toute photographie fait énigme
», Hazan, 2014
Directeur de recherche émérite au CNRS, Michel Frizot est venu à l’étude de la photographie en tant qu’historien d’art. Il a enseigné l’histoire et la théorie de la photographie (École du Louvre, 1990-2010, et Ecole des Hautes études en sciences sociales jusqu’en 2010).
Il a conçu et dirigé la Nouvelle Histoire
de la Photographie
(Bordas/ Adam Biro, 1994; Larousse, 1998) qui a marqué une rupture en intégrant à cette histoire des formes considérées comme mineures (photographie populaire, photographie imprimée dans les magazines et les livres, photographie anonyme et d’amateurs, photomontages, etc.) Auteur de nombreux articles sur les pratiques photographiques anciennes et modernes et de monographies et catalogues d’exposition (Etienne-Jules Marey, Hippolyte Bayard, Kertész, le magazine photographique VU).
Parallèlement à son activité universitaire, il a collecté avec persévérance les images photographiques délaissées par les historiens, les « collectionneurs » et les institutions, qui lui paraissent recéler des qualités photographiques indépendantes des ambitions esthétiques et des prescriptions documentaires.
Il partage ici un regard singulier voué au repérage de toutes les propriétés photographiques et à l’analyse de la réception des images.
Commissariat : Michel Frizot, avec la collaboration de Cédric de Veigy
Exposition co-produite avec la Maison Européenne de la Photographie, Paris et le Fotomuseum, Winterthur.
Un livre accompagne l’exposition :
Michel Frizot, Toute photographie fait énigme,
éditions Hazan, 2014.
224 pages, 170 illustrations, français/anglais
ISBN : 9782754107747
Prix : 39 €

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English

Jeffrey Silverthorne, The Precision of Silence
Rétrospective
18 10 2014 … 18 01 2015


Première rétrospective européenne, l’exposition met en lumière le travail de Jeffrey Silverthorne (né en 1946), photographe américain explorant avec constance depuis quarante ans les sujets les plus extrêmes. Des morgues, où dès les années 1970, il arrive à transcender la représentation de la mort, aux portraits crus de travestis et de transsexuels, la représentation du corps dans tous ses états demeure récurrente dans son œuvre. Les références aux grands maîtres de la peinture se mêlent aux expérimentations sur le médium photographique : superpositions, découpages, collages…
La mort, le sexe…l’artiste y scrute ses angoisses, ses obsessions et nous met face à des peurs viscérales pour nous aider à mieux les dominer.
Exposition co-produite avec le Fotomuseum, Anvers et la Galerie VU ’
Il a suffi qu’une nuit des années 1970, un travesti sorte d’un night-club de Providence pour que le photographe, à l’instant même fasciné, jette aux orties toutes les leçons de bon goût et la morale protestante. Jeffrey Silverthorne, sans oublier d’où il venait, sans renier ses maîtres en photographie, s’abandonne alors à l’incongruité de ce qu’il voit. Il admire ce paraître, cette construction d’une autre personnalité. Ces créatures, Rhonda Jewels, Joey, Dougie et Poulie exprimaient dans ce jeu sur elles-mêmes une liberté sans commune mesure dans la sclérose du monde. Dès lors, la frivolité retint son attention. De ce moment, illumination de jeunesse, il gardera l’évidence initiatrice des actes créatifs. Autre conclusion définitive : seule la photographie a le pouvoir de magnifier cet effet de présence des êtres rejetés par la société. Même les morts trouvent leur place dans ce spectacle qui n’a rien de dérisoire. Exister ou plutôt faire exister, - il n’y a pas d’autre preuve photographique -, c’est le privilège de n’avoir qu’à être là, différent, dans l’objectif du photographe. Tous les personnages de la troupe de Jeffrey Silverthorne se révèlent fascinants, même s’ils s’en défendent. Déficients mentaux, prostituées, clandestins, ils ne peuvent renoncer. Si tous sont passifs dans la réalité, ils obtiennent dans le cadre de l’image la reconnaissance qu’on leur a toujours déniée.
Le théâtre de Jeffrey Silverthorne est un étonnement réciproque. Le photographe et les sujets photographiés se prêtent tous à un récit auquel personne ne croit vraiment. Mais chacun est médusé par la présence de l’autre. Les personnages se conduisent selon les indications de l’auteur. Ils conservent cependant leurs attitudes habituelles parce qu’ils ne peuvent y déroger. Ils ne font que ce qu’ils savent faire, choses sur lesquelles on ne plaque aucun mot connu. Car aucun commentaire n’accompagne le récit de ces faits et gestes, comme d’ailleurs aucune analyse ne les explique : le photographe étant bien incapable de donner à ses actions des causes ou des finalités.
L’œuvre entière tourne autour du drame de la mort et des tentatives de l’homme pour cohabiter avec cette angoisse. Ici, la mort se montre paradoxalement pour ainsi dire toute nue, mais parée, voire ornementée. L’apparence est la seule consolation à la disparition de l’être. La nature réelle de l’homme se découvre dans l’organisation du simulacre. Aux prises avec la nuit du corps humain, nous n’avons d’autre échappatoire que le fard et la tromperie. On n’y comprend rien, alors on feint en recouvrant et en mystifiant, en nous apprêtant nous et les morts.
Extrait du texte de François Cheval
Publié dans le livre publié à l’occasion de l’exposition :
Jeffrey Silverthorne, RETROSPECTIVE
Textes de : François Cheval, Rein Deslé, Jeffrey Silverthorne
23 x 30 cm
Environ 160 pages, 160 illustrations
Français / Anglais
ISBN 978-3-86828-533-8
39,90 euros
Kehrer Editions, Octobre 2014

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Claude Batho
La poésie de l’intime
18 10 2014 … 18 01 2015


A travers ses photographies, Claude Batho (1935-1981) s’est attachée aux objets les plus simples qui constituaient son quotidien, aux paysages familiers, à son proche entourage. La simplicité apparente des représentations cède la place à la sensibilité, à une beauté silencieuse souvent associées aux tirages argentiques en noir et blanc. Cette simplicité se fait poésie et triomphe de la banalité. Geste de femme, la photographie de Claude Batho se lit comme un journal intime dont les sujets ne seraient pas les moments extraordinaires de l’existence mais bien les instants insignifiants et finalement immuables.
Exposition co-produite avec le centre d’art et de recherche GwinZegal, Guingamp
Maintenant que le temps s’est défait, on peut revoir sereinement les photographies de Claude Batho. Il y a dans ce rassemblement, qui n’a rien d’épars et d’hasardeux, un sentiment de durée au-delà des limites d’une vie. L’œuvre a singulièrement bien vieilli. On aimerait tant qu’elle et ses proches se retrouvent dans le nouveau portrait établi ici, plus de trente ans après sa disparition. Car tout paraît simple dans ces images. La photographie s’est voulue la copie conforme de la vie familiale ; une pratique empreinte de tendresse, faite de gestes quotidiens et humbles : quand les images s’attachent à une « réalité » pratique jamais très loin du songe.
[…]
Tel est l’effort instinctif de la photographe qui s’ingénie à discerner dans des figures nettes la beauté informelle du monde. C’est son grand mérite. Elle ne se décerne aucune vertu spécifique, ne s’accorde aucun privilège. Elle ne crée aucune situation originale qui ne soit en dehors du réel. Mais elle fait de l’acte photographique un objet original parce que claudiquant, en porte-à-faux. Spectateur, on se reconnaît dans ces images alors que l’objet restera à jamais unique. Le sort d’une photographie réussie est là. Tout est vrai et rien ne l’est. Cet univers unique et autonome a ses propres lois. Il s’impose à nous de telle sorte qu’on ne puisse le discuter.
Cet état que l’on veut protéger précède la catastrophe. L’avenir est une menace. Saisir un cadrage, c’est examiner ce qui nous appartient et dont on ne veut être dépossédé. Ce qui nous est en propre, ce sont ces objets dans leur disposition. Ils se tiennent en eux-mêmes et dans leur différence, ils sont un autre nous. De leur usage, on s’en moque. Leur sens nous échappe. Leur nudité seule importe. Par ce qu’ils convoquent, ils dépassent leur fonction utilitaire pour être simultanément chose et idée. Les objets entrevus portent en eux l’image ancestrale de l’offrande. Il n’y a guère de photographie qui ne soit pas un rituel, un hommage rendu quotidiennement aux puissances vitales.
Par là, Claude Batho se place non face à la nature mais en son centre. Elle pense l’acte photographique dans un face à face avec la perte, sans nostalgie, dans un camaïeu de gris mélancolique.
Extrait du texte de François Cheval
Publié dans le livre édité à l’occasion de l’exposition :
Claude Batho
Format 23 x 26 cm
Couverture toilée
92 pages en bichromie
ISBN : 979-10-94060-01-8
Co-édition GwinZegal, musée Nicéphore Niépce
30 €
28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
![Bruno Serralongue Centurion Risk Assessment Services 2002 [inventaire Fnac 02-925] Centre national des arts plastiques © Bruno Serralongue – Galerie Air De Paris Bruno Serralongue Centurion Risk Assessment Services 2002 [inventaire Fnac 02-925] Centre national des arts plastiques © Bruno Serralongue – Galerie Air De Paris](/var/ezflow_site/storage/images/exposition/futures/la-photo-contemporaine-du-cnap/la-photographie-contemporaine-dans-les-collections-du-cnap/21714-1-fre-FR/La-photographie-contemporaine-dans-les-collections-du-CNAP_smartphone.jpg)
Wonderland,
Collections photographiques du
Centre national des arts plastiques


Le musée Nicéphore Niépce dédie cette année encore une exposition aux œuvres issues du Centre national des arts plastiques (Cnap).
Résultat d’un partenariat entre les deux institutions, ce nouvel accrochage présentera une sélection d’œuvres de
Pierre Faure, Bruno Serralongue, Philippe Durand, Luc Delahaye, Claire Chevrier, Cécile Hartmann et Guillaume Janot.
La photographie se doit d’être toujours contextualisée. Dans les années 1990-2000, les artistes, s’ils explorent encore les potentialités plastiques de ce médium à l’aune de leurs prédécesseurs, s’attachent davantage à représenter le monde et l’actualité.
Les photographes présentés dans cette salle, devenus adultes dans les années 80, assistent à une évolution sociétale accélérée : changements politiques, révolution à l’Est, ultralibéralisme à l’Ouest, dislocation du corps social, multiplication des conflits dans le monde …tout concourt au sentiment d’insécurité et à la prise de conscience du danger engendré par le développement technologique et industriel de nos sociétés.
La photographie constate autant qu’elle informe, prenant diverses voies pour y parvenir, du regard froid à l’esthétisation volontaire. Elle dresse le portrait d’une société, « un monde merveilleux », avec son lot de solitude, de violence et de banalités.
Pierre Faure (born in 1965)
Théâtre du fantastique
2001
FNAC n° 01-880 à 01-882
La série Théâtre du fantastique
se situe parmi les premiers travaux photographiques de Pierre Faure. La ville y est présentée comme le cadre de situations, de gestes, de relations entre les individus. En captant des postures banales, des actions quotidiennes, des contacts humains, sans leur donner plus d’importance qu’à leur environnement, Pierre Faure invite à regarder ce qu’on ne voit plus, assaillis que nous sommes par le grand bazar du monde.
Bruno Serralongue (né en 1968)
Risk Assessment Services
2002
FNAC n° 02-923 à 02-927
La particularité du travail de Bruno Serralongue réside dans l’interrogation constante de l’objectivité de l’image, depuis sa production jusqu’à sa diffusion.
Il photographie – pour son propre compte - l’actualité, les événements portés à sa connaissance par voie de presse. Mais il se défie des méthodes du reporter professionnel. Bruno Serralongue s’attache à montrer les coulisses, tous les à-côtés qui n’intéresseraient pas ce dernier.
Pour la série Risk Assessment Services
, le photographe a infiltré un stage de formation « Environnement hostile et premiers secours », destiné aux journalistes amenés à travailler dans des pays en guerre et dans des zones dangereuses. Les milliers de journalistes ainsi formés voient leurs réactions sur le terrain dictées, uniformisées, au dépend probable de l’information.
Philippe Durand (né en 1963)
Still Life Armed Response
1998
FNAC n° 99050
Par petites touches, Philippe Durand glane les signes fugaces qui font l’identité d’un lieu.
A Los Angeles, son regard est happé par les panneaux des sociétés de surveillance privées, plantés en évidence dans le jardin des résidences. Ces mises en garde affichées traduisent l’ultra privatisation de l’espace dans la ville californienne. Elle signifie toute la violence d’une société individualiste et sécuritaire. S’il porte un regard critique sur cette réalité, Philippe Durand ne peut s’empêcher de l’embellir : la séduction de la 3D, l’environnement verdoyant et les buissons en fleurs semblent vouloir gommer le caractère péremptoire des panneaux.
Luc Delahaye (né en 1962)
Northern Alliance Fighters
2006
FNAC n° 06-258
Issu du photojournalisme, Luc Delahaye s’est distingué dans la couverture des grands conflits mondiaux. Si son travail est avant tout celui d’un reporter, il use des potentialités formelles du médium photographique afin de créer des images dévoilant l’aspect spectaculaire du quotidien. Son approche privilégie une proximité à l’évènement souvent périlleuse, doublée d’une distanciation émotionnelle. Pour autant, Luc Delahaye revendique la dimension esthétisante de ses photographies, tel ce vaste paysage d’où émergent les soldats de l’Alliance du Nord dans leur offensive contre les Talibans dans la région de Kunduz en Afghanistan, le 22 novembre 2001. Par son seul format, l’œuvre oscille entre le témoignage brut et l’image sophistiquée digne d’une peinture d’histoire.
Claire Chevrier (née en 1963)
Leeds
1995
FNAC n° 96-604
Images sans apprêt d’une réalité urbaine abrupte, les paysages de Claire Chevrier sont conçus comme des lieux de sédimentation où se superposent les strates historiques. Ici une centrale nucléaire aux allures de château fort est venue se greffer à une maison bourgeoise de Leeds au nord de l’Angleterre. Les différents plans semblent s’imbriquer, les bâtiments se confondre derrière quelques arbres dénudés qui participent à la morosité ambiante. L’homme semble absent, il est pourtant bien question de lui, du monde qu’il s’est construit et qu’il subit désormais.
Cécile Hartmann (née en 1971)
Inhabitant, Businessman, 2005
Inhabitant : Homeless, 2004
FNAC n° 08-699
FNAC n° 05-593
A travers la vidéo ou comme ici à travers la photographie, Cécile Hartmann tente de décrypter la vie dans l’ère hypermoderne qui est la nôtre. Elle s’attache à l’individu au sein d’une société de plus en plus fragmentée et en perpétuelle accélération. Dans la série Inhabitant
, elle saisit les individus isolément dans un moment suspendu, un instant d’abandon où ces derniers semblent justement ne plus « habiter » ce monde.
Guillaume Janot (né en 1966)
Sans titre (Manifestant)
2001
FNAC n° 02-989
Sans titre (La fleur / L’homme au parapluie)
2006
FNAC n° 07-232 et 07-233
Sans titre (La Chinoise)
2000
FNAC n° 02-990
Des photographies de Guillaume Janot émanent un calme et un silence trompeurs. La beauté lisse des tirages camoufle la trivialité de la chose représentée, ancrée dans la réalité urbaine contemporaine. Il exploite le pouvoir esthétisant de la photographie. Le « miracle » nait du choix de l’échelle, du cadrage serré, du flou presque poétique de l’arrière-plan. Cette photographie contient l’inquiétude comme l’un de ses modes. Il est difficile dans ces temps de fabriquer une image « plaisante » ou « émouvante » sans perturber à quelque degré. Le théâtre photographique est le lieu privilégié des passions contenues ; il est l’espace où s’affrontent le monde réel, la nature ou la ville et les passions.
28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Patrick Bailly-Maître-Grand
Colles et Chimères
21 06 … 21 09 2014
Les travaux de Patrick Bailly-Maître-Grand (né en 1945) ont été fondateurs pour toute une génération de photographes français. Depuis 1980, l’artiste n’a cessé de revisiter les techniques anciennes, les gestes originels de la pratique photographique, tout en leur appliquant un caractère purement conceptuel. Ses images, strictement argentiques, oscillent entre rigueur scientifique et poésie.
Fruit d’une généreuse donation de l’artiste au musée Nicéphore Niépce et au musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, deux expositions complémentaires, l’une à Chalon-sur-Saône et l’autre à Strasbourg, reviendront sur trois décennies de création photographique expérimentale.
Au début des années 1980, la photographie d’auteur erre à mi-chemin entre le constat brut et le rejet de la réalité. L’approche de Patrick Bailly-Maître-Grand fonde alors un parcours singulier et solitaire qui échappe à tous les regroupements. Il est convaincu que l’essence de la photographie repose sur son acte de naissance, un écart entre l’intention et le tirage. Ce faisant, il s’autorise la citation historique et nous oblige à repenser l’acte photographique dans sa totalité, de la prise de vue à la destination de l’image.
Patrick Bailly-Maître-Grand décide d’une redéfinition des fondements de l’image mécanique qu’il adosse à l’histoire scientifique de la photographie. Il s’attèle à découvrir et expérimenter les techniques anciennes, du daguerréotype à la chronophotographie : « Il faut percevoir en ce bricolage laborieux une quête nostalgique des années primitives de la photographie quant tout était à découvrir avec une boîte, un bout de verre, de la chimie et du hasard. »
Il pénètre dans l’acte photographique en faisant appel aux préceptes de la science. La photographie est comparable à ces jeux instructifs du XIXe siècle, ces formes cultivées et récréatives d’apprentissage de la connaissance scientifique. La méthode recourt constamment aux leurres. Patrick Bailly-Maître-Grand joue avec la lumière qu’il transforme en matière et la matière en lumière. Le photographe-physicien raisonne sur les paradoxes de la substance, de l’espace, du temps et du mouvement, ces données physiques et interchangeables essentielles à la constitution de l’acte photographique. L’optique et la chimie sont l’objet du geste expérimental. Chaque série est là pour vérifier empiriquement les intuitions des pionniers.
Si l’artiste a voulu aller à rebours, c’était pour mieux se délester de tous les discours qui encombrent l’image mécanique. La tentative de réconciliation avec les premiers gestes et les premières manipulations avoue son ambition : nettoyer la photographie des miasmes de l’utopie réaliste.
Exposition organisée en partenariat avec le Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg
En parallèle, un autre versant de l’exposition « Colles et chimères » de Patrick Bailly-Maître-Grand est présentée au Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg du 28 juin au 19 octobre 2014.
A l’occasion des deux expositions, publication d’un livre
aux éditions des Musées de la Ville de Strasbourg
Patrick Bailly-Maître-Grand – Colles et Chimères
Nbre de pages : 200 pages
Nbre d’illustrations : environ 300
ISBN : 978-2-35125-111-9
Ouvrage bilingue français-anglais
35 euros
Biographie
L’homme est assez peu disert sur les faits ayant émaillé sa vie. A l’évidence, pour lui, l’essentiel n’est pas là mais dans la confrontation qu’il entretient depuis une trentaine d’années avec la technique, et dans les images qui en résultent. Elles sont autant d’indices sur un personnage et ses obsessions, sur une histoire où la chronologie importe peu. Quand on l’interroge sur le sujet, voici cependant les moments qu’il retient.
Patrick Bailly-Maître-Grand est né le 1er février 1945 à Paris. Son nom, patronyme et non pseudonyme comme nombreux l’ont cru, lui vient de ses origines franc-comtoises. Une grande maison de famille dans le Haut-Jura est le décor de son enfance. Ce lieu fondateur contiendra en germe les principales facettes de sa personnalité. « Le souvenir de ma jeunesse est celui d’un enfant bien trop tôt adultisé par ses parents pour pouvoir échapper à leur terrible confidence d’un mal de vivre. » [1] . Afin de conjurer le mal être de ceux qui l’entourent, il fait très tôt l’expérience de son potentiel créateur. Il peint sur des matériaux de récupération, répare et bricole à l’envi. Lui vient aussi de cette demeure une attirance pour les objets beaux ou rares.
Dans ses jeunes années, une forte appétence pour les sciences et techniques le conduit à préparer le concours d’ingénieur des Arts et Métiers. Il y échoue mais garde cependant un souvenir précieux des cours de préparation où il découvre entre autres le dessin industriel, les machines-outils… Il poursuit ensuite un cursus à la Faculté des Sciences de Paris et obtient en 1969 une maîtrise en physique fondamentale. Ses années universitaires sont marquées par les évènements de mai 1968 au cours desquels il s’engage politiquement.
Au début des années 1970, des problèmes de santé le contraignent à changer de voie. Il choisit la peinture, à laquelle il se consacre pendant une décennie, développant une démarche hyperréaliste, froide et analytique. Il utilise des laques et acryliques à séchage lent pour produire des images en à-plat, sans perspective, qu’il dit influencées par l’Orient. « La tradition picturale japonaise ou chinoise, avec sa représentation contemplative calme et droite, me fascine. J’aime ces vides qui autorisent la respiration et où il n’existe aucune de ces lignes obliques, policières pour vous flécher vers je ne sais quel point d’habitation divine… » [2] .
Mais en peinture, Patrick Bailly-Maître-Grand se trouve rapidement confronté à une sorte d’épuisement. Le médium ne satisfait pas son goût pour la recherche de solutions technologiques. Il n’y trouve pas « d’échappatoire d’ingénierie » [3] . A partir de 1979, il chemine donc progressivement vers la photographie. Il s’empare des possibilités de cet outil en tant que plasticien, au même moment où Madeleine Millot-Durrenberger, avec qui il partage alors sa vie, découvre la photographie en tant que collectionneuse. Ils nourrissent un même goût pour le travail de Joseph Sudek.
Mais le seul « maître » que cite Patrick Bailly-Maître-Grand en tant que tel est Etienne-Jules Marey, père de la chronophotographie. Ce procédé permettant la décomposition du mouvement d’un sujet pose les bases techniques de la cinématographie. Si l’ingéniosité d’un tel pionnier est une raison de cette admiration, c’est surtout « la grande beauté et le caractère énigmatique des images » [4] qui retiennent l’attention de Patrick Bailly-Maître-Grand.
« Découvrir la photographie m’a donné le sentiment d’entrer dans un couloir jalonné d’une centaine de portes à ouvrir, et j’y suis encore ! » [5] . Cette phrase résume bien le caractère foisonnant de l’œuvre que Patrick Bailly-Maître-Grand construit depuis les années 1980. Poursuivant ses recherches en utilisant exclusivement les techniques argentiques, il explore cet espace métaphorique où l’acte photographique se nourrit autant de l’histoire du médium, de ses caractéristiques que de l’imaginaire du photographe.
Ses premiers sujets photographiés sont des fragments d’architectures, leurs ombres, des paysages urbains noyés de brume ou travaillés frontalement, de manière à les rendre quasiment abstraits. La figure humaine en est exclue (Les classiques, 1980-85). Ce travail à l’extérieur, sur le motif, se poursuit par une longue interprétation dans l’atelier. Les tirages prennent la forme de petits formats noir et blanc. Certaines épreuves sont rehaussées à la mine de plomb, rappelant sa formation au dessin technique (Les noirs au plomb, 1980). Sur d’autres il expérimente des virages par zones d’une grande subtilité (Les brumes, 1987 ; La Statues de la Liberté, 1984). Puis il consacre plusieurs années de recherches à la redécouverte de la technique du daguerréotype et ne tarde pas à être considéré comme l’un des plus importants daguerréotypiste contemporain (1983-1987).
Son goût pour la technologie continue de se traduire tout au long de sa carrière par l’utilisation de dispositifs ingénieux mis au service de sa réflexion sur le médium. « Je ne sais pas photographier simplement » [6] . Périphotographies (Formol’s band, 1986 ; Recto-verso, 2008 ; Trophées, 2008…), strobophotographies (Poussières d’eau, 1994 ; Eaux d’artifice, 2005), rayogrammes (La lune à boire, 1991-1994 ; Arts et Métiers, 1999 ; Pâtés d’alouettes, 2003…), solarisations (Digiphales, 1990 ; Romanes, 1993…), virages chimiques (Les croix, 1996 ; Mélancolies, 2004…), monotypes directs (Gémelles, 1997…), sont autant de moyens de s’approprier la photographie elle-même que de déjouer son apparente objectivité. Mais ces outils complexes sont aussi au service d’un imaginaire fécond nourrit de souvenirs, d’émotions et de sensations.
Abandonnant rapidement la représentation du monde extérieur, Patrick Bailly-Maître-Grand se consacre peu à peu exclusivement à l’observation de son univers proche. Les sujets sont cependant d’une grande variété. Parmi les nouvelles thématiques abordées, le vivant fait son entrée dans l’œuvre via la déambulation d’insectes dans des espaces clos ou à la table de l’artiste (Les araignées, 1991 ; Les mouches millimétrées, 1995 ; Vacances avec mes copines, 2003…). Puis l’empreinte dans de la gélatine alimentaire, le reflet dans le verre ou l’ombre de corps introduisent une forme d’autoportrait (Les anneaux d’eau, 1997 ; La main, 1998 ; Endroit en verre, 2003…). Le défilement du temps et le mouvement sont saisis comme un défi à la propension admise de la photographie à figer l’instant (Chronos, 2001). L’auteur interroge et réinterprète enfin certaines images archétypales de l’histoire de la photographie (Véroniques, 1991-1994 ; Maximiliennes, 1999…).
Les objets et leurs détournements occupent également une place croissante dans son travail. En esthète et chineur, il constitue une collection aujourd’hui organisée tel un cabinet de curiosités dans l’appartement strasbourgeois qu’il occupe avec sa compagne Laurence Demaison, elle-même photographe. Nombre d’entre eux sont le point de départ de séries photographiques, renvoyant à la thématique des vanités (Petites vanités, 1998 ; Le péripatéticien, 2006 ; Gueules cassées, 2009 ; Les verroteries, 2009…).
Les photographies « orphelines » , glanées sur les marchés aux puces, sont elles-mêmes objets de collecte et d’inspiration. « S’intéresser à la photographie anonyme (ou "chasser le hasard") est un jeu cruel de la dernière chance à l’égard de cette multitude de vignettes populaires, en exode serré, dans des boîtes à chaussures, à deux doigts de l’anéantissement. […] Et puis soudain dans ce torrent de banalité : la PEPITE. Un tout petit rien, en plus ou en moins des "autres", qui propulse brusquement une petite photo dans le monde de la poésie, de la musique » [7] . Il fait don de cet ensemble au musée Nicéphore Niépce en 2012.
Dans un même souci de préservation de la cohérence de son œuvre, alors que ses recherches photographiques se poursuivent, des extraits de travaux emblématiques de Patrick Bailly-Maître-Grand intègrent aujourd’hui les collections de deux institutions publiques majeures, le Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg et le musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône.
Anne-Céline Besson
Assistante de conservation, musée Nicéphore Niépce
[1] Patrick Bailly-Maitre-Grand, Petites Cosmogonies , p.12, 2007
[2] Patrick Bailly-Maitre-Grand, Petites Cosmogonies , p.13, 2007
[3] Patrick Bailly-Maitre-Grand, entretien, mars 2014
[4] Patrick Bailly-Maitre-Grand, entretien, mars 2014
[5] Patrick Bailly-Maitre-Grand, entretien, mars 2014
[6] Patrick Bailly-Maitre-Grand, Petites Cosmogonies , p.13, 2007
[7] Patrick Bailly-Maitre-Grand, Chasseur de hasard , p.XXX, 1995

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Roger Ballen, Asylum of the birds
21 06 … 21 09 2014
exposition prolongée jusqu'au 05 10 2014
Asylum : asile… Un lieu protecteur ou au contraire synonyme d’enfermement. Toute cette ambiguïté habite l’une des dernières séries photographiques de Roger Ballen (né en 1950). En 2008, il découvre à Johannesburg, dans l’Afrique du Sud où il réside, une maison singulière peuplée d’individus et d’oiseaux en liberté, où courent également les rats, les lapins et les canards. Les murs sont recouverts de signes et de dessins. L’endroit étrange oscille entre atmosphère surréaliste et pur installation d’art brut, tout comme les images de Roger Ballen entre pureté et chaos.
Un lieu étrange aux abords de Johannesburg abrite une communauté hétéroclite. Les hommes y cohabitent avec des animaux grouillant au milieu d’un amas d’objets démantelés et épars dont on cherche vainement l’utilité. L’endroit tient du repère de chiffonniers et de la réserve zoologique. Un lieu extraordinaire, idéal pour nourrir l’imagination singulière de Roger Ballen.
Implanté en Afrique du Sud depuis plus de trente ans, ce photographe d’origine américaine s’est fait connaître en 1994 en dressant le portrait vériste et pitoyable du monde rural sous l’Apartheid (Platteland, Images from Rural South Africa[1] ). Dès cette époque, Ballen dépasse le simple statut de photographe documentaire pour se forger un style unique et dérangeant. Il photographie les hommes en les mettant en scène dans leur environnement quotidien. Parallèlement il met en place un vocabulaire esthétique où foisonnent les signes graphiques, les éléments formels qui le relient à l’histoire de l’art et auxquels il donne autant d’importance qu’aux portraits proprement dits. Ses images au fil du temps offrent une lecture de plus en plus complexe, par l’accumulation des objets, des graffitis, la présence grandissante des animaux. Le regard se concentre sur le cadrage resserré du format carré et erre à la recherche d’une explication. Roger Ballen invente un langage et jette le trouble. En passionné de psychologie, il semble mettre en image notre subconscient.
« Mes meilleures photographies sont celles que je ne comprends pas
». L’homme marche à l’instinct, ne planifie rien. En 2008 il fait connaissance avec un univers à sa mesure, un endroit où s’entassent à l’écart de la société, des miséreux, des criminels et des malades mentaux, dans une infernale promiscuité avec des animaux de toutes sortes. Un bouge sordide et crasseux, aux murs tagués, un lieu irréel et malsain qui va servir de nouveau décor à l’univers esthétique détonnant du photographe.
Asylum of the birds, l’asile des oiseaux. Un refuge repoussant où règnent le chaos et la liberté, un point de rencontre entre vie et mort, entre humanité et animalité. Pendant cinq années, Roger Ballen agence les objets de rebut, carcasses, masques et figurines, compose avec les animaux en liberté. L’homme est présent mais souvent de façon fragmentaire : ici une tête hurlante, là cinq mains tendues…ici un corps sans tête, là un homme en cage, des figures masquées… Tous les symptômes de la folie sont rassemblés dans des images qui pourraient s’apparenter à des cauchemars. Les oiseaux omniprésents s’ébattent librement au risque de devenir les victimes de cette insanité. Symbole lumineux de liberté et de paix, les colombes se confrontent à la noirceur de l’humanité, la beauté à la laideur. La relation qui se profile ici entre l’homme et l’animal est bien celle de l’adversité.
Roger Ballen affirme explorer la face obscure de la psyché, les différentes couches du subconscient qu’il superpose dans ses photographies, à la manière de strates géologiques[2]. Son travail témoigne d’une vision du monde toute en ambigüité, où le noir n’est pas forcément synonyme de mal ni le blanc, de bien. Pour Ballen, « la vie vient de l’ombre (…) elle provient du néant ».
Livre :
Roger Ballen
Asylum of the Birds
Editions : Thames & Hudson, 2014
ISBN : 0500 544 298
Vidéo :
http://www.asylumofthebirds.com/
[1] Cette série a été exposée au musée Nicéphore Niépce en 2002.
[2] Roger Ballen est géologue de formation.
28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
La Fnac, Une collection pour l’exemple
21 06 … 21 09 2014
exposition prolongée jusqu'au 29 09 2014
En faisant de l’exposition photographique dans ses boutiques le relai privilégié de sa vente d’appareils photo, la Fnac a constitué une collection exceptionnelle comptant près de mille huit cents tirages où se côtoient Robert Doisneau, Edouard Boubat, Malick Sidibé, Antoine D’Agata ou Martin Parr. Diffusé dans toute la France en un temps où la photographie s’exposait encore rarement dans les musées, ce fonds a permis de sensibiliser le grand public à l’expression photographique.
Le musée Nicéphore Niépce l’accueille en dépôt pour plusieurs années et propose aujourd’hui une première exposition constituée d’une sélection de plus de cinquante images.
Dès sa création en 1956, la Fnac apporte une grande importance à la photographie : vente d’appareils, organisation de concours photo destinés à la clientèle, mise en place des galeries photos dès 1969... La circulation d’expositions itinérantes, l’organisation de rencontres avec les photographes, l’édition, vont imposer l’enseigne commerciale comme un acteur majeur de la photographie. Cette politique se poursuit dès 1978 avec la constitution d’une véritable collection institutionnelle. En soutenant la photographie, la Fnac prend l’initiative de montrer au public une forme artistique encore peu exposée, peu légitimée.
La collection couvre de nombreux champs de la photographie. La plupart des courants majeurs y sont représentés : photographie de guerre, avant-garde des années 1930, photographie de mode… Passage obligé, la poésie du Paris d’après-guerre s’exprime par la présence rassurante des humanistes français dont les figures tutélaires sont Robert Doisneau, Willy Ronis, Edouard Boubat.
La présence de nombreux photoreporters témoigne également la volonté de la Fnac de faire écho à l’actualité passée et contemporaine : l’apartheid vu par Abbas, la révolution sandiniste couverte par Susan Meiselas, les portraits du Che par René Burri, les manifestations contre la guerre de Vietnam sous l’œil de Benedict Fernandez ...
Le monde s’ouvre aux yeux d’un public encore peu habitué à voir la photographie s’exposer. Les errances d’Antoine d’Agata aux frontières du Mexique côtoient les fêtes joyeuses de Malick Sidibé à Bamako.
Première enseigne de vente de produits culturels, la Fnac ne pouvait enfin que s’intéresser aux images liées à la musique, au cinéma ou à la littérature : Marilyn par Douglas Kirkland, Ingrid Bergman par David Seymour, Anita Ekberg sur le tournage de La Dolce Vita , le jeune Truman Capote immortalisé par Henri Cartier-Bresson, William S. Burrroughs vu par le photographe de l’underground new-yorkais Gérard Malanga… Avec ces portraits d’acteurs mythiques, d’écrivains de légende présentés dans chacune des galeries, la Fnac envoie au public un message pour ainsi dire subliminal et le renvoie à ses rayons bien achalandés. Cette politique désintéressée d’expositions ouvertes à tous a des vertus incitatives, à n’en pas douter. Mais son principal mérite reste d’éduquer le regard du plus grand nombre, d’un public qui ne franchit pas toujours les portes du musée.
Déposée au musée Nicéphore Niépce, cette collection compte près de mille huit cent images reflétant une discipline artistique dans toute sa diversité. L’exposition en propose une première lecture axée sur quelques icônes de la photographie depuis les années 1950.

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Une photographie sous tension,
La collection de Florence et Damien Bachelot
15 02 … 18 05 2014
Amateurs d’art, Florence et Damien Bachelot se prennent de passion pour la photographie dès les années 2000, constituant une collection au gré des ventes aux enchères et des coups de cœur en galeries. Initiée à partir d’un fonds humaniste français (Brassaï, Doisneau, Cartier-Bresson…), celle-ci s’est également nourrie des riches heures de la photographie américaine (Lewis Hine, Sid Grossman, Bruce Davidson…), et des courants contemporains (Stéphane Couturier, Luc Delahaye, Mitch Epstein, Paul Graham, Edward Burtynsky…). Passant d’une image intimiste en noir et blanc à une poétique des ruines très actuelle, la collection semble de prime abord hétéroclite, dévoilant finalement un souci permanent du fait social et urbain. Elle témoigne d’une société en construction, en constant changement, autant que d’un monde en décomposition.
C’est un métier que de collectionner. Et, à entendre les collectionneurs, il faut plus que de l’argent pour s’installer de manière durable et originale dans le monde restreint du « vintage ». Toute collection, pour se différencier, doit être paradoxalement, un examen de la photographie et une distance vis-à-vis d’elle. Si ce rassemblement n’est fait que pour soi, il est évident que l’on attend des autres une reconnaissance de la démarche.
La puissance de la collection de Florence et Damien Bachelot, sa brutalité même, va de pair avec une clairvoyance au service d’une peinture de la « condition humaine ». L’empathie a gardé dans leur esprit des couleurs vives et intenses.
Cette passion privée est tout le contraire d’un regard satisfait et charitable. On y dénonce, on témoigne à charge. Même si tout cela ne change pas l’édifice, les tares de notre temps, le racisme, la pauvreté et la guerre apparaissent dans leur vérité crue : une injure à l’intelligence et au progrès. C’est dans le monde réel, avec ses aspérités, que se nourrit cette collection. Elle vaut bien toutes les sources d’informations modernes. Elle n’a d’autre fin que la morale et, disons-le, l’édification du spectateur !
La croyance dans la puissance créatrice et poétique de la photographie s’avère intacte. Le photographe est celui qui peut, par l’entremise de l’appareil, modifier le cours des choses. Il domine le réel plus qu’il ne l’enregistre. Il voit là où les autres errent en aveugle. Cette collection affirme sans aucun doute la différence de nature entre le preneur de vue et le reste du monde.
Reconnaissons encore un mérite à cette collection. Elle respire la liberté. Des noms reconnus, mais si peu d’icônes…
C’est, finalement, plus qu’un métier que de collectionner. Et à revoir encore ces images réunies patiemment, il nous vient un scrupule : celui de n’avoir pas suffisamment insisté sur ce qu’elles partagent, une gravité. Non, mieux : une tension.

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English

Kathryn Cook, Memory of trees
15 02 … 18 05 2014
Comment parler d’un meurtre de masse sans tomber dans des formes « compassionnelles » ou strictement documentaires ? Le génocide arménien, contrairement à la Shoah, s’est dévoilé dès l’origine au travers de la photographie. Dénoncés dès 1915 en tant que « crime contre l’humanité et la civilisation », les faits étaient largement connus et diffusés par la presse internationale.
Un siècle plus tard, Kathryn Cook s’empare de la question arménienne en la traitant avec poésie, par allusions. Elle utilise efficacement la métaphore, s’égarant entre le passé et le présent dans une indistinction assumée mêlant l’histoire et l’intime.
En signant le 24 avril 1915 un acte de déportation à l’encontre de la communauté arménienne, le gouvernement ottoman organisait le premier génocide du XXe siècle. Les Arméniens furent alors conduits à marche forcée à travers l’actuelle Turquie, sans eau ni nourriture, par des chemins difficiles, traversant terres désertiques, cols enneigés et plaines arides. Pour échapper à une mort certaine, beaucoup se convertirent à l’Islam, allant jusqu’à dissimuler leurs origines à leurs propres enfants.
La photographe américaine Kathryn Cook (née en 1979) a longtemps documenté les paysages qui furent le théâtre des marches forcées. Elle est partie à la rencontre des descendants des populations déportées, de leur histoire peu à peu dévoilée. Dans le village d’Ağacli en Anatolie (littéralement « le lieu des arbres »), où les Arméniens élevaient depuis des siècles les vers à soie, la tradition du tissage de la soie est aujourd’hui ravivée par les Kurdes. Seuls les mûriers ancestraux témoignent encore de la présence arménienne. Kathryn Cook s’est attachée à rassembler les traces d’un passé tragique. En interrogeant les conséquences des évènements de 1915, elle tente une impossible représentation de l’invisible souffrance, d’une vieille douleur inexprimée qui se doit d’être exhumée, discutée et partagée afin de construire un futur collectif.
La représentation du génocide arménien, épisode historique fondateur du meurtre de masse, questionne encore le médium photographique dans ses fondements, plus d’un siècle après les faits. On peut dire de cet événement qu’il a eu lieu. Il semble même « saturé ». Il en est même l’axiome. Peu importe que les particularités et les raisons du génocide soient obscures au plus grand nombre, l’hécatombe est sans conteste. Au bannissement de la raison répond le désintérêt pour les répercussions actuelles du massacre. Paradoxalement, cette conséquence inattendue est due à l’abondance de preuves.
Nous ne sommes pas dépourvus de documents. On dénombre, au moins, une vingtaine de collections publiques ou privées de par le monde qui détiennent des vues à jamais insupportables. Toutes confirment, s’il en est besoin, la réalité du premier génocide du XXème siècle : plus d’un million et demi d'Arméniens tués entre le 24 avril 1915, date des premiers carnages jusqu’en 1922.
La photographie ici, contrairement à la shoah ou à la destruction du peuple khmer, a exposé au plus près la politique de purification ethnique menée par les dirigeants turcs : destruction et pillages des villages, conversions de force à l'islam, déportation massive vers les déserts de Syrie, etc. Les massacres déjà désignés, dès 1915, comme des «crimes contre l’humanité et la civilisation», étaient largement connus et diffusés par la presse internationale. Premières traces de la violence de masse au XXe
siècle, à une échelle encore inconnue, la photographie a constitué et a rassemblé des preuves indiscutables des conséquences de l’alliance de la technique et de la barbarie.
La photographie de Kathryn Cook n’a pas besoin de témoigner. Venue de la presse, on ne sait pourquoi cette photographe américaine souhaite s’atteler au travail du deuil ! En interrogeant les conséquences des événements de 1915, elle tente une impossible représentation de l’invisible souffrance. Elle s’essaye à composer une forme pour le chagrin, à donner une figure à une vieille douleur inexprimée. A la manière d’un road-movie, - ou est-ce une quête initiatique ? -, hors de la tentation objective, la photographe explore les lieux de l’errance dramatique du peuple arménien. Plus apprentie qu’enquêteuse, on ressent un sentiment d’impuissance à rendre compte « objectivement » des traces du génocide. C’est la photographie documentaire, et sa mystique du fait brut, qui est remise en cause et se révèle inadéquate devant le silence, l’amnésie, à tout dire, l’abîme. A la recherche d’une voie originale dans le traitement de « la Grande Catastrophe », Memory of Trees assure que la raison doit se nourrir de l’acte poétique.
François Cheval,
extrait du livre
Memory of trees
, Editions Bec en l’air, 2013
Exposition co-produite avec Marseille-Provence 2013 et le MuCEM, Marseille
Kathryn Cook est membre de l’agence VU’



28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Ziad Antar, Au hasard de la pellicule
15 02 … 18 05 2014
La photographie est affaire d’intention. On pense que le photographe doit contrôler de bout en bout la chaine qui conduit de la prise de vue au tirage. Mais qu’advient-il quand la pellicule d’origine est obsolète? Avec la série Expired, le libanais Ziad Antar s’abandonne au hasard. L’utilisation de films périmés insérés dans des appareils argentiques parfois eux-mêmes endommagés rend l’aléa maître du jeu. A l’artiste de se jouer ensuite des coulures informelles, des taches, des restes d’une représentation. La photographie du réel décomposée, sans contrôle, s’assimile à la traditionnelle vanité ; elle fait disparaitre les corps et les architectures d’un monde qui a oublié qu’il était éphémère.
Depuis une dizaine d’années, l’artiste libanais Ziad Antar (Saida, 1978) s’abandonne aux aléas formels nés de l’utilisation de pellicules argentiques périmées. Trouvées chez son compatriote, le photographe Hashem El Madani, elles sont devenues à travers la série "Expired
" l’objet d’une expérimentation non seulement esthétique mais philosophique de l’image photographique.
Ziad Antar questionne la nature-même de la photographie, l’intention qui préside au déclenchement de l’obturateur. La chimie altérée du support interdit toute maîtrise préalable de la prise de vue. L’artiste laisse le hasard opérer.
Chacun sait que grâce à l’industrie, à la machine et surtout à la marchandise, conséquence de nombreuses expériences personnelles et d’épreuves quotidiennes, l’usage d’un appareil photographique ne requiert ni apprentissage, ni même grande application. La caméra que l’on nous offre aujourd’hui suppose une accoutumance rapide et le renoncement de toute autorité sur la machine. L’ingéniosité du geste technique n’a de justification dans le mode de production actuel que déployée simplement avec aisance par l’utilisateur.
Avec "Expired", Ziad Antar s’adonne volontiers à un jeu de dénégation de la posture technicienne. La procédure n’a rien de complexe. Elle ne demande qu’une pellicule obsolète, recueillie chez un vieux photographe libanais, insérée dans une camera argentique. Il ne faut plus alors que s’abandonner au hasard ! Il reste, néanmoins, que le refus de l’emploi « traditionnel » de la photographie par un illettré obstiné ne contredit pas l’acte photographique. Il inaugure un autre temps, quand, en quête d’une vérité révélée, on dépose la conformité de la belle image et les principes de la photographie d’art. Nulle ironie sur l’image « réussie », d’autres dans les années 1970 l’ont fait. "Expired" refuse le verdict de la vision préétablie par le dispositif technique et les recettes. La série s’amuse de la divergence entre la notice d’utilisation et sa corruption ! Là, où il ne devrait rester en fin de compte que des malentendus et des revers, on aboutit à un objet d’une stupéfiante beauté dont la fin n’est rien moins que la redéfinition de l’interprétation du photographique.
Extrait du texte de François Cheval "Expired ou le double décomposé"
publié dans le livre : "Ziad Antar - expired"
édité à l'occasion de l'exposition par les Beaux-Arts de Paris éditions et le musée Nicéphore Niépce.
28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Après l’obscurité :
Klavdij Sluban, une rétrospective (1992-2012)
12 10 2013 ... 12 01 2014
Pour Klavdij Sluban, la photographie est prétexte au voyage, favorisant l’expérience et la rencontre, une meilleure compréhension de la réalité de chacun. Le photographe, d’origine slovène, rend compte de ce qu’il voit, non de ce qu’il aurait fallu voir. Fuyant l’anecdote, il ne relate aucun événement, se tient en dehors de l’actualité, n’hésitant pas à capter des temps faibles où rien ne se passe. Aux quatre coins du monde, il photographie l’atmosphère d’une ville, la noirceur d’une geôle, la solitude d’une île. Un monde souvent chaotique où l’homme n’est jamais loin. Les images de Klavdij Sluban semblent volontairement hors du temps. L’usage unique du noir et blanc, l’aspect charbonneux et le grain marqué des tirages en font toute la beauté. La sensibilité du photographe fait corps avec la réalité du monde.
Cette exposition est la première rétrospective de vingt ans de travail de ce photographe, présent dans les collections internationales les plus prestigieuses.
Un compartiment de train, une prison et une île, c’est dans ces lieux clos que Klavdij Sluban rencontre le destin des hommes. Ces espaces prodiguent les sentiments de solitude, d’ennui et parfois de terreur. Dans une continuité sans écarts ni manquements à une certaine morale, Klavdij Sluban poursuit un chemin vers des régions que Dieu a abandonnées. Le voyage pour lui-même n’a pas d’intérêt. Il n’y a pas, non plus, de temps. Il n’y a que des portraits d’hommes et de femmes atteints du même mal que lui. Hagard devant l’Histoire, chaque visage est une interrogation, une question posée à sa destinée. La photographie se veut radicalement hors du temps, pourtant, elle se pose dans la matière même, grasse et charbonneuse, des faits. Elle constate et pressent. Pas une image qui ne nous fait entrevoir la catastrophe. A travers les vitres du wagon, derrière la glace de sécurité, on n’aperçoit que la grisaille et l’impossibilité de vivre. Simplement.
Parfois, à Cuba, en Haïti, les corps se révoltent et refusent le diagnostic. La beauté, car il y en a dans ce malheur, reste une nécessité. Beauté cadavérique d’un jeune détenu, d’un profil aperçu en Sibérie, d’une vieille dans un autocar, cette forme est celle de la mélancolie.
Le photographe n’est ni documentariste, ni auteur. Il ne participe en rien aux débats qui agitent la photographie. Les seuls bruits dont résonnent les images évoquent les vents froids ou la houle marine. Car ici, on se tait. On parle peu. Et il y a encore moins de confidences à livrer. Dans ce monde sans plaintes et sans récriminations, dans cet état obscur, le récit se fait court. C’est ainsi et on n’y peut rien.
Mais ce récit n’a jamais un caractère direct. Entre le réel et le photographe s’interposent une vitre, une fenêtre, une larme, et toujours une optique. Avant de s’embarquer pour une traversée, Klavdij Sluban sait déjà ce qu’il va trouver et ressentir. Retour à la case départ, aussitôt la frontière traversée, la porte de prison franchie, il se trouve plongé dans un monde connu, sans contrastes. La vie n’est pas ce puzzle que l’on présente, confus et contradictoire. Elle prend les formes tragiques et littéraires d’un animal à l’agonie, de vies prédestinées.
Il a trop vu de gens condamnés, entendu prononcer trop de sentences pour que la photographie soit un objet de controverses. On peut dire cependant de la photographie, telle que la pratique Klavdij Sluban, qu’elle est faite paradoxalement de sensualité, de tristesse et de sévérité.
Mais jamais l’envie de fuir ces images ne nous prend. Comme si la vision de notre conscience nous était offerte. Quelque chose qui nous saisit à la gorge ; un face à face avec ces enfants détenus, la grisaille de la ville, le dénuement de je ne sais quel pays de l’Europe de l’Est.
Et pourtant, cela reste beau ! Nous ne voyons pas d’autre qualificatif pour ces images. Nous ne parlons pas d’une beauté qui enjolive la douleur du monde ! Non ! D’une extrême beauté qui reflète la noblesse des attitudes et nous révèle le tragique de notre existence.
Il faut alors voir les trois séquences, le train, la prison et l’île, comme le même film qui se déroule et offre le récit d’une Passion sans Dieu, d’un monde livré à des forces supérieures. Il ne reste que l’image globale, stoïque, d’une interrogation sans réponse et surtout un attachement obstiné à relier beauté et mélancolie.
Cette œuvre patiemment construite depuis plus de vingt ans se montre sans illusions. Il est loin le temps où un seul cliché ouvrait les yeux et les consciences. D’ailleurs ce temps n’a jamais été. Mais ce qui fait la force de ces images, si peu nombreuses finalement, c’est cette impuissance qui n’est en rien de la résignation. Cette immobilité est un monument dressé, excusez du peu, à notre condition.
François Cheval

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English

Robert Burley
The Disappearance of Darkness
12 10 2013 ... 02 02 2014
L’argentique se meurt, l’argentique est mort. La technologie numérique a fait basculer la pellicule photographique dans le domaine de l’histoire et du patrimoine. Sa disparition a entrainé celle de toute la logistique industrielle et commerciale qui en assurait l’exploitation : usines, bureaux, studios, boutiques… Tout espace aujourd’hui déserté et voué à la destruction.
Le Canadien Robert Burley est parti dès 2005 à la découverte de ces lieux aujourd’hui vides, où semblent encore flotter le bruit des machines et des conversations. S’intéressant dans un premier temps à Kodak, il fixe les espaces désertés de l’usine de Toronto, les implosions médiatisées des usines historiques de Rochester et de Chalon-sur-Saône, avant de porter son attention sur d’autres fabricants : Agfa-Gevaert, Ilford, Polaroid…
Au-delà de la simple immortalisation de lieux emblématiques, les images de Robert Burley racontent la disparition d’une culture matérielle de la photographie.
L’exposition «Robert Burley, The Disappearance of Darkness » s'inscrit logiquement dans la continuité de celle que le musée avait proposée en 2012 autour des œuvres de Michel Campeau, un autre Canadien, qui inventoriait par l'image les dernières chambres noires de la planète.
Robert Burley documente depuis plusieurs années la fin de l'argentique à travers la désaffectation et la destruction des usines de fabrication de films. L'exposition, conçue en partenariat avec le Ryerson Image Centre (Toronto), se concentre sur le moment historique où les changements technologiques ont irréversiblement redéfini le medium photographique. The Disappearance of Darkness
traite de la disparition assez brutale d'une industrie centenaire. En 2005, Robert Burley recevait l'autorisation de photographier l'usine Kodak de Toronto, un complexe industriel dédié à la fabrication des pellicules, papiers et équipements photographiques divers. Durant un an, il a fixé l’abandon et la démolition de l’usine de Toronto, avant de se tourner vers d'autres fabricants dont les usines fermaient elles aussi progressivement : Kodak France, Agfa-Gevaert, Ilford, Polaroid. En 2007, il assistait à l'implosion de l'usine Kodak de Chalon-sur-Saône, ultime présence de la marque en France.
Photographe explorant habituellement les thématiques du paysage et de l'architecture, Robert Burley s’est naturellement intéressé ici à l’aspect compact de bâtiments dont l’architecture particulière permettait une production industrielle de masse. Les vues extérieures présentent des structures monolithiques imposantes et sans fenêtres, dénuées de toute présence humaine et de mouvement. Ces usines fantômes semblent avoir subi le feu nucléaire. A travers le vide et le silence, ces tableaux photographiques évoquent les conséquences économiques dévastatrices résultant de la révolution numérique.
Robert Burley (né en 1957) est professeur à l'Ecole des arts de l'image (Ryerson Université, Toronto).
Exposition présentée en collaboration avec le Ryerson Image Centre, Université Ryerson, Toronto, Canada.
Commisariat : Gaëlle Morel, Conservatrice pour les expositions, Ryerson Image Centre.
Un ouvrage en anglais accompagne l'exposition:
Robert Burley, The Disappearance of Darkness: Photography at the end of the analog era
Princeton Architectural Press, 2012
160 pages
isbn: 978-1616890957

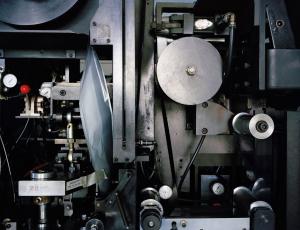
28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Charles Fréger
Uniforme(s)
15 06 ... 15 09 2013
Uniformes militaires, bleus de travail, combinaisons de patineuses ou costumes d’apparat constituent pour Charles Fréger le fondement de son travail photographique. Le strict protocole qu’il s’est fixé pour la réalisation de ses séries de portraits dépasse cependant largement la simple notion d’inventaire. Le caractère a priori documentaire est trompeur. Nous sommes face à des portraits psychologiques, où chacun affirme son appartenance à un corps social au travers de son uniforme.
Le musée Nicéphore Niépce soutient Charles Fréger depuis plusieurs années et lui consacre ici sa première grande rétrospective regroupant plus d’une centaine d’images.
Année après année, compulsivement, l’obsession persiste. Maintes expositions, accompagnées de catalogues et de livres conséquents, se sont succédées, et Charles Fréger nous offre étonnamment une série inédite et toujours plus insolite. Enrichis des connaissances de la sociologie et de l’anthropologie, nous pensions tout savoir des humains et de leur goût immodéré pour l’apparat et les accoutrements de toutes sortes. Et puis, avec Wilder Mann, rassemblement extravagant d’hommes nés avant l’invention de Dieu, le photographe nous a assuré de la folie de l’humanité dont l’instruction restera sans fin.
Cela a quelque chose à voir avec l’inventaire ou y ressemble. Mais il faudrait pour fonder un catalogue raisonné que l’auteur ait recours à une méthode typologique. Est-ce vraiment le cas ? Peut-on vraiment isoler des facteurs prédominants dans chaque série ? Autrement dit le port de l’uniforme fait-il l’homme ?
Les images sont trop complexes pour que la réalité soit simplifiée à ce point. Charles Fréger observe et nous met, au plus près, face à des phénomènes réels. Il nous livre ses considérations. L’entreprise se caractérise par la volonté de baliser tous les problèmes de la prise de vue grâce à une grille technique. Elle détermine aussi une méthode concrète visant à dégager les caractères de chaque groupe étudié. Paradoxalement, l’idée d’une typologie s’effondre car l’exercice de cette photographie ne recherche ni cause, ni explicitation de l’homme réel, concret.
Les sciences humaines ont peut-être établi un lien logique entre sumotoris japonais, patineuses synchronisées finlandaises, légionnaires « français » et Royal Highlanders. Le sentiment d’appartenance au groupe, la solidarité entre classes d’âge ou les rites d’intégration n’ont pas échappé à l’analyse « scientifique ». Très différent est le point de vue de Charles Fréger. Pour ce dernier, les séries photographiques composent, suite après suite, un discours cohérent, un fil conducteur dans la déraison du corps et du social.
Chaque épisode est un fait singulier construit en fonction du dispositif du photographe. En cela, nous sommes loin d’une simple saisie photographique, mais proche d’un niveau zéro de la description. Charles Fréger s’est vu lutteur de sumo, il a patiné à Helsinki, il s’est engagé et a boutonné ses guêtres.
En faisant abstraction du spectacle de ces défilés d’hommes en uniformes, de l’aspect cérémoniel des situations, nous nous apercevons que le seul événement réel est un regroupement factice, un rituel privé à l’usage exclusif du photographe. Laissons-donc de côté les références à August Sander, à la photographie allemande, à la Nouvelle Objectivité, aux références sérielles et penchons-nous sur le fonds de cette affaire, les obsessions du photographe.
Charles Fréger accentue unilatéralement le point de vue, il enchaîne une multitude de phénomènes isolés dont la finalité est avant tout esthétique. L’homme n’est pas formaliste, mais il est le premier fasciné par la scène qu’il organise. Les fonds sont primordiaux. Ils n’ont pas uniquement pour fonction de mettre en avant le modèle, ils installent l’idée d’une iconographie luxueuse, un recueil de chromos précieusement conservés. On pourrait le lui reprocher. Mais trop respectueux du spectateur, il lui livre un flux d’informations, de textes et de références cultivées. Ce surplus de mots n’éclaire en rien le propos si ce n’est l’aveu émerveillé et envoûté pour ces tableaux constitués de postures et de temps révolus.
Il subsiste des territoires où l'homme s’est trouvé et a gagné en harmonie et en perfection. Ce monde rejette l’ombre et se donne aussitôt sans retenue. Est-ce à dire qu’on ne trouverait pas de l’imparfait et du bizarre dans ces portraits d’humains ? La dramaturgie perfectionniste du photographe procure une satisfaction immédiate. Chacun trouve un plaisir évident à la géométrie, au brillant et à la palette des couleurs. Illusion que cette résolution des tensions et des contradictions du monde, artifice d’un lieu sans rugosité ! L'anxiété se lit sur tous ces visages. On entrevoit un danger immanent, une attente que l’organisation parfaite de la seconde peau serait seule en mesure de contrarier.
Entre le photographe et ses modèles, il existe une communauté de sentiments, de sensations et de craintes. Le photographe appréhende le manque ou la défaillance, avec pour conséquence le vide créatif. Voilà pourquoi il traque ses semblables et leurs formes accomplies. Photographe despotique, il s’imagine à la tête de la « Garde Fréger ». Avec sa machine photographique, instrument de contrôle social, il met en ordre, ou feint de coder le corps et le désir. Aux antipodes du document, s’éloignant définitivement d’une photographie descriptive, l’œuvre de Charles Fréger s’avère la forme la plus aboutie de la schizophrénie du monde moderne, une tentative illusoire et obsessionnelle de se libérer des tensions pour mieux attraper les humeurs, les angoisses et les débordements.
François Cheval
28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English
Ces photos qu’on ne jette plus…
Donation de la collection privée de Patrick Bailly-Maître-Grand
15 06 ... 15 09 2013
Le musée consacre une exposition à la donation faite par l’artiste Patrick Bailly-Maître-Grand d’une collection de photographies hétéroclites, glanées ici et là et le plus souvent anonymes. Composé de photographies amateurs ou professionnelles de toutes époques, cet ensemble dessine la psychologie de celui qui l’a constitué et pose la question de la destinée de ces images a priori banales, mais dont le pouvoir d’évocation et l’esthétique induisent la conservation à jamais. L’exposition explore le caractère « sacré » des photographies portant toujours en elles une part du vivant qui interdit leur mise au rebut.
Jetez, jetez, il en restera toujours quelque chose… ou presque.
Les photographies dites anonymes sont les molécules d'un océan de lieux communs visuels, de banalités, de codes sociaux standardisés, d'esthétiques rabâchées. Elles ne montrent rien de plus que ce que nous savons tous de l'esthétique, du temps qui passe, de la disparition: beaux couchers de soleil, gâteaux d'anniversaire, souvenirs d'Ibiza, mamie dans son jardin, ma moto rutilante, etc. etc.
Comment se fait-il alors qu'elles méritent aujourd'hui une telle attention et entrent sans pudeur dans nos musées qui, par définition, n'offrent leurs murs qu'à la rareté, l'originalité ? Élémentaire mon cher Watson : cette boue est aurifère ! Des citrouilles de papier cachent des carrosses dorés, des souliers de vair argentiques gisent dans des poubelles…
Tout collectionneur de photographie anonyme sait qu'il n'y a rien de plus déprimant et exaltant à la fois que ces heures de brocante à farfouiller dans ces boîtes à chaussures ramollies par la pluie, où s'amoncellent des vignettes fragiles, à deux doigts d'être jetées. Mais quelle récompense pour lui de dénicher alors dans ce chaos, l'accident sublime, la faute magique, le non-vu essentiel !
Toute collection en ce domaine est la mise en image des propres fantasmes de ce "chasseur de hasard". Par chance, il n'a rien à craindre des autres "chasseurs" puisque ceux-ci, comme lui, ne visent que le seul gibier de leurs désirs. Dans un lot où l'un peut apercevoir quelque chose de précieux, d'autres y sont aveugles. On ne voit que ce que l'on sait; l'émotion ressentie devant la découverte d'une de ces pépites argentiques et la résultante d'un savoir et d'une culture personnelle. Une collection de photographies anonymes est un authentique portrait psychologique et culturel de son collectionneur.
Et si une catastrophe était à venir ? Avec le triomphe des nouvelles technologies d'images numériques (sans trace réelle avant lecture sur une machinerie hyper évolutive), il n'est pas du tout certain que dans nos brocantes de demain, il puisse y avoir encore quelques " chasseurs" pour porter attention au sort de nos anciens CD devenus caduques, illisibles et dont la seule information accessible sera une écriture au feutre, mentionnant pathétiquement: " Photos d'Ibiza. 2010 "
…
Patrick Bailly-Maître-Grand

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English

Stanley Greene,
Sur la route d'une guerre
jusqu'au 01 09 2013
Depuis trois décennies, Stanley Greene parcourt les cinq continents pour témoigner : guerres et conflits, famines et destructions sont au cœur des images de ce photographe américain. De la chute du mur de Berlin à l’ouragan Katrina, de l’Afghanistan à la guerre en Tchétchénie, Stanley Greene documente les grands évènements du monde, œuvrant pour un photojournalisme sans concession qui fait désormais du photographe le centre du récit.
En 2013,
le musée Nicéphore Niépce et le photojournaliste, représenté par l’agence Noor, signent une convention de collaboration inédite entre un auteur, une agence de presse et un service public. Les archives du photographe données ou mise en dépôt au musée seront valorisées, le musée s’engageant à réaliser des séries d’inventaires, de numérisations et d’expositions de ce fonds.
Cette première exposition « Sur la route d'une guerre », présente des images réalisées en Tchétchénie entre 1994 et 1996.
« Mes photographies de ce conflit ne reposent pas sur la technique ou sur « l’art ». Elles sont le fruit de mon instinct, de ma volonté de révéler les vérités cachées. (…) Ma colère est totale. »
Stanley Greene
Le musée Nicéphore Niépce abrite désormais dans ses collections un important ensemble de photographies de Stanley Greene (New York, 1949). Celui-ci est aujourd’hui l’un des rares représentants du photojournalisme d’investigation. Ses reportages montrent son engagement, son indépendance et son besoin de témoigner et de convaincre. Ancien militant des Black Panthers, il fait de la guerre contemporaine le terrain privilégié de son action, s’impliquant dans des conflits dont la presse occidentale se désintéresse.
Tel est le cas de la Tchétchénie. L’invasion de cette jeune république indépendantiste par l’armée russe en 1994, qui devait être une opération éclair, s’est transformée en horreur de longue durée. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, une capitale – Grozny – n’avait été rasée, un peuple entier massacré.
Stanley Greene a parcouru cet enfer de 1994 à 2003. Ses photographies dénoncent un conflit disproportionné : l’immense Russie contre la minuscule Tchétchénie, une guerre totale menée dans un mouchoir de poche pour faire payer à cette population musulmane sa résistance vieille de deux siècles.

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English

[BLV] 5,
Finir en beauté
16 02 ... 19 05 2013
L’importance et l’éclectisme de la collection photographique de l’écrivain et critique d’art Bernard Lamarche-Vadel a autorisé de multiples présentations thématiques ou monographiques depuis le dépôt de celle-ci au musée Nicéphore Niépce en 2003. Reflet des engouements et des aspirations du collectionneur, elle offre une vision partiale de la photographie du 19e siècle aux années 1990 : de la poésie des anciens au caractère parfois hermétique de certaines créations conceptuelles, la collection de Bernard Lamarche-Vadel présente de nombreuses pièces représentatives de l’histoire de la photographie : Nadar, Alfred Stieglitz, Man Ray, Walker Evans, Bernard Plossu, Thomas Ruff, Bettina Rheims… Les photographes de notoriété internationale y côtoient des artistes mis en lumière par Lamarche-Vadel. Avant que ce fonds ne soit restitué à la famille du collectionneur décédé en 2000, une ultime exposition présentera une sélection des photographies les plus emblématiques. Pour finir en beauté.
S’il était possible d’imaginer une fin à un ensemble d’expérimentations menées depuis 2003 autour de la collection photographique de Bernard Lamarche-Vadel, il faudrait partir du titre.
La fin, le collectionneur l’avait déjà imaginée, en 1981, autour d’une exposition de peintures intitulée Finir en beauté
.
Il s’agissait de finir en beauté une période pour en commencer une nouvelle. C’est à ce moment qu’il devint collectionneur de photographies, collectionneur acharné.
Pour l’exposition BLV5, Finir en beauté
, la reprise de ce titre arriva comme une évidence et il devait occuper un espace à lui-seul, un espace non attendu dans la configuration normale des expositions au musée Nicéphore Niépce. Apparaître d’abord de loin et fonctionner comme un leurre. Avoir tout l’attrait d’une œuvre conceptuelle d’art contemporain sans en avoir la qualité. On aurait pu se contenter d’accoler à ce titre une citation rapportée du collectionneur, « Je vais partir mais dans un éclat », et les faire vivre dans une stricte intimité, en faisant l’économie des œuvres, de leur exposition même. Mais ce n’est pas non plus de cette fin-là dont il s’agit avec BLV5
.
C’est le TITRE et c’est la FIN. Puisque la collection s’en va, restituée à la famille Lamarche-Vadel.
Puisqu’elle a cheminé dix ans au musée Nicéphore Niépce en faisant l’objet d’une série de conversations entre œuvres, de jeux numériques lui ayant permis de voyager à Paris, à Lannion, en Arles, à Berlin.
Laissons-la se déployer à nouveau telle qu’elle est. Austère, sombre, mortifère, portée par le rouge et le noir, l’éclat et le malheur.
Arrimée à des piliers-cimaises formés de deux faces, on la verra selon l’envie, faite de sa litanie d’auteurs photographes de renom ou alors, on y reconnaîtra des paysages, des figures emblématiques du milieu de l’art et de la littérature.
Ainsi déployée, au moyen d’œuvres, exemplaires de la totalité des 1500 photographies, la collection de BLV arrive, contenue par de grands ensembles. De Joseph Beuys au singe castré de Bettina Rheims transparaît une même fixité troublante, un état de quelque chose qui n’est plus. Le temps s’est arrêté. Même le bonheur et les petits oiseaux semblent en être atteints. Mais la porte est ouverte et on entend les petits oiseaux, l’air est frais encore. Enfin, « nous sommes libres, le soleil est brisé, salut ténèbres. » (Alexeï Kroutchonykh, 1913)
Commissariat : Sonia Floriant
Cette exposition a été conçue à partir de la collection déposée au musée Niépce par la Succession Lamarche-Vadel et Lamarche
Liste des photographes exposés :
Félix Nadar, Jean-Philippe Reverdot, Josef Sudek, Gérard Dalla Santa, Etienne Carjat, Bettina Rheims, Umbo, Sophie Calle, Man Ray, Denise Collomb, Thomas Ruff, Bill Brandt, Brassaï, Philippe Bonan, Jérôme Schlomoff, Heinrich Kühn, Bernard Plossu, Berenice Abbott, Walker Evans, Lee Friedlander, William Klein, Weegee, Alfred Stieglitz, Lewis Baltz, Florence Chevallier, Jean-Luc Mylayne, Keiichi Tahara, Gérard Bustamante, John Coplans, Patrick Faigenbaum, Hamish Fulton, Lynne Cohen, Watkins.
Cette exposition clôt un cycle consacré par le musée Nicéphore Niépce à la collection de Bernard Lamarche-Vadel
2003 (musée Nicéphore Niépce), 2004 (Berlin/SITEM) et 2006 (Arles/Festival photo) / Corpus, installation numérique restituant les 1500 photographies de la collection.
2003 / BLV1, Hommage à Bernard Lamarche-Vadel, premier opus.
2004 / BLV2, Jean Rault (Unes) - Jean-Philippe Reverdot (L’Epreuve).
2008 / BLV3, Sélection dans la collection de livres photographiques de Bernard Lamarche-Vadel.
2009 / Dans l’œil du critique, Bernard Lamarche-Vadel et les artistes
, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
2010 (Imagerie de Lannion) et 2011 (musée Nicéphore Niépce) / BLV4 Conversations entre œuvres.
Un ouvrage
Inclinations, la collection selon Bernard Lamarche-Vadel
Textes : Isabelle Tessier, Danielle Robert-Guédon, François Cheval, Sonia Floriant, Michèle Chomette, Gaëtane Lamarche-Vadel
Filigranes Editions
ISBN : 978-2-35046-199-1
25 €
en vente à la librairie-boutique du musée.

28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English

Les Arts Associés :
La photographie au service du cinéma
16 02 ... 19 05 2013
Le lien unissant la photographie au cinéma n’est plus à démontrer. Le film se nourrit de la photographie. Progrès ultime appliqué à l’image via le mouvement puis le son, le cinéma a surenchéri dans le spectaculaire. Populaire dès l’origine – contrairement à la photographie qui demeura longtemps inaccessible au plus grand nombre – le cinéma étend très vite son hégémonie, affichant sa « supériorité » prétendue sur l’image fixe. Pour autant, il n’a pu se départir du rôle essentiel joué par le médium photographique dans son succès commercial. Photos promotionnelles dans le hall des salles obscures et photos de plateau dévoilant les coulisses d’un tournage sont autant d’images censées informer et inciter le public à devenir une clientèle. Ainsi le cinéma se retrouve–t-il paradoxalement sous la dépendance de l’image fixe et de récits photographiques ordonnés dans des revues ou placardés aux murs.
Le cinéma n’a jamais fini de payer sa dette à la photographie. Il en est l’émanation et croyant s’affranchir de la pauvreté de l’image fixe, il la regarde comme l’origine, une antiquité qu’on ne peut jeter mais que l’on a remisée au grenier. La photographie nuirait au cinéma. Le photogramme ou la photographie de plateau seraient incapables de rendre compte des effets de montage en se moquant du temps filmique. Eisenstein comparait les « belles » photographies de film « à un fatras décousu de jolies phrases
» ! Faut-il rappeler que ces deux médiums ont partagé et partagent encore des supports et des modes de diffusion communs. Même s’il a cru s’émanciper de la simplicité de l’objet photographique, il faut bien que le cinéma en convienne, il ne peut s’en passer. Objet promotionnel, en amont du film ou à sa sortie, à tous les moments de la vie d’un long métrage, la photographie assure l’existence du cinéma. Elle l’accompagne, lui donne sa cohérence médiatique et l’établit en l’inscrivant, par la photogravure et l’impression dans l’univers du magazine et du livre.
Les relations, certains parlent de friction, que les deux média entretiennent ont pris un caractère original et complémentaire à la fin des années 1920, grâce à la propagation de l’héliographie. Les maisons d’édition, mais aussi les producteurs de cinéma, ont vu dans la création de revues spécialisées la possibilité d’assurer le lancement et la publicité du film. En sens inverse, le caractère inédit de la narration cinématographique a largement participé à la réinvention de la photographie et du magazine à la fin de la Première Guerre mondiale.
En fin de compte, ces deux moments de l’image mécanique révèlent des significations complémentaires et procurent des plaisirs d’ordres différents.
Il nous faut désormais penser l’image arrêtée sur le cinéma, non plus comme une simple illustration promotionnelle, mais comme une distance, un « trop », qui révélerait ce qu’on ne voit pas sur l’écran.
Commissariat : François Cheval
Recherche documentaire : Emilie Bernard, Marie-Odile Géron
Scénographie : Christelle Rochette


28, Quai des Messageries
71100 Chalon-sur-Saône
tel / + 33 (0)3 85 48 41 98
e-mail / contact@museeniepce.com
Site classique / English